
Fabienne Vansteenkiste
enseignante
de 1979 à 2015
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 16.11.20

- Féminisme
- Carrière
- Numérique
- Vacataire
- Minorité
- Dévalorisation
- Mandarinat
- Silence et parole
- Écologie
- Directrice
- Relation aux étudiant·es
- Déséquilibres
Entretien de
Fabienne Vansteenkiste
enseignante de 1979 à 2015
le 16.11.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Lucile Encrevé
Je ne suis jamais revenue aux Arts Déco depuis ma retraite, j’avais un peu oublié… J’ai un souvenir de moi dans une manif, au début du millénaire, je m’étais fait une pancarte sur la discrimination sexiste aux Arts Déco, une pancarte pour moi toute seule dans une manif féministe je pense, ou une manif syndicale sur les salaires genre 1ermai. J’avais dû me battre pour obtenir des chiffres, ces informations étaient énormes sur les différences de carrière et de salaires au détriment des femmes. C’était le combat de moi, toute seule.
Tu as enseigné trente années à l’Ensad ?
Au moins… j’ai poussé la porte des Arts Déco l’été 1979 et je suis partie je pense en 2015. En fait je suis rentrée dans l’École par hasard, parce que j’avais fait de la vidéo avec le MLF[Mouvement de libération des femmes], à la grande époque où on faisait de la vidéo militante, et j’avais fait des films avec des copines à Montpellier, on avait fait un film sur l’élection très contestée de Miss Montpellier, un autre sur une manif de nuit de femmes. On avait des gros magnétoscopes, et pour pouvoir monter on nous prêtait du matériel dans un local, on avait le droit de travailler la nuit, sauf que ça tombait en panne et rien ne m’énervait plus que quand ça tombait en panne à 2 heures du matin et qu’on ne savait pas réparer et qu’il fallait attendre le lendemain les mecs qui venaient pour réparer. Je me suis dit, je suis ingénieure, j’ai un diplôme de Centrale, il faut que j’apprenne à réparer les magnétoscopes. J’avais assez travaillé pour vivre un an sans bosser, et quelqu’un m’a dit « Aux Arts Déco ils ont un atelier vidéo, tu pourrais peut-être aller voir ». J’ai débarqué aux Arts Déco, j’ai dit « Je ne veux pas faire des films, je veux apprendre à réparer les magnétos », le technicien responsable du studio m’a répondu « Ça tombe bien, tu es ingénieure, il y a des câbles dessoudés, si tu es prête à venir travailler sans être payée, aide-moi à préparer la rentrée, on a aussi un prototype de synthétiseur qui ne marche pas »… j’ai ressoudé les câbles, je me suis occupée du synthétiseur… la rentrée est arrivée, et je suis restée là. Je n’étais pas payée mais je faisais ce que j’avais envie de faire, j’aidais les étudiants. Je n’existais pour personne mais je n’en avais pas besoin, tant qu’on me laissait apprendre à réparer les magnétoscopes…
Et puis le technicien s’est cassé, et on m’a dit « Tu veux rester à sa place ? » ok. Je suis devenue technicienne au labo vidéo – c’était absurde, j’étais ingénieure, ça ne tenait pas debout mais c’est ce que j’avais envie de faire. Et parallèlement j’ai commencé à donner des cours dans les sciences exactes, c’était les tout débuts des ordinateurs, c’était des calculatrices numériques… et sur la géométrie, les pavages du plan, sur ce que je savais faire comme ingénieure et qui me passionnait. Je donnais ces cours comme vacataire. Et puis le numérique est arrivé, j’ai quitté le studio vidéo. J’ai démissionné, j’ai dit que je voulais faire du numérique et j’ai commencé à bosser au studio numérique [fig.1]. Progressivement j’ai fait de plus en plus de cours, le numérique devenait de plus en plus important, en 1983-84 il n’y avait pas beaucoup de gens qui savaient que ça allait exploser, on s’en doutait avec Pierre Hénon [enseignant]. Je suis devenue prof, j’ai fait de plus en plus de cours. L’animation en images de synthèse a démarré, et moi je savais faire, et je me suis mise à travailler dans le secteur cinéma d’animation essentiellement.
Mais je suis restée dix-sept ans vacataire. À l’époque il y avait des profs de plusieurs catégories. Tout en bas il y avait des vacataires, très précaires. Pour les contractuels, plus on montait, moins on avait de cours à donner et plus on était payé, c’était le principe. Au plus bas niveau des contractuels, il y avait les chefs de travaux pratiques : tu n’étais pas censé faire de cours, mais, de fait, tu faisais des cours, pareil que tous les profs. Moins payé. Assistant, tu devais faire 15 heures de cours hebdo, puis il y avait des P3, profs de 3ecatégorie, très peu nombreux. Les P2 et les P1 (profs de 2eet 1erecatégories), eux, devaient assurer 12 heures de cours. Les P1, c’était que des mecs, 100% de mecs. En 2ecatégorie il y avait quelques femmes. Parmi les assistants on avait encore plus de femmes et les vacataires étaient majoritairement des femmes. Et les femmes restaient vacataires beaucoup plus longtemps que les hommes. C’était un système par cooptation, à l’époque c’était une commission de recrutement composée de profs de l’École qui sélectionnait les candidats en fonction des besoins (décidés ailleurs) et, pour les profs déjà en place, proposait les promotions.
La commission était constituée essentiellement d’hommes ?
C’était quasiment que des hommes, tout le temps. J’avais dû être la seule femme, pendant les années où j’ai été élue. J’ai été élue une fois, sur un programme très clair, pour rééquilibrer. Je l’ai fait un peu mais à ce rythme on y serait arrivé au bout de 240 ans ! Je le dis dans le tract [fig.2][distribué dans les boîtes des professeurs au début des années 2000].
Et aux élections suivantes, j’ai été battue totalement. Clairement j’en faisais déjà beaucoup trop. Et la première décision des suivants, ça a été : tout pour les hommes. J’étais aussi en porte-à-faux dans cette histoire, non seulement j’étais une femme, ce qu’on ne me reprochait jamais (sauf quelques ancêtres, je me rappelle d’un prof qui m’avait dit : « Enfin, toi, tu es une femme, tu n’as pas besoin de gagner de l’argent », les femmes elles ont un mari, elles ont de l’argent pour s’acheter des colifichets… il était quand même marginal dans l’École) – pour la plupart si les femmes n’étaient pas promues, c’était officiellement parce qu’elles étaient moins compétentes, tout le monde aurait été d’accord pour que Louise Bourgeois soit prof aux Arts Déco, ça ne fait pas l’ombre d’un doute… Moi je n’étais pas Louise Bourgeois, je n’étais pas une artiste, j’étais ingénieure… sauf que des mecs ingénieurs, il y en avait plusieurs dans les profs, et à eux personne ne le leur reprochait. Un collègue qui a eu une carrière à peu près parallèle à la mienne, qui est mon copain, il a gagné deux fois, trois fois plus d’argent que moi sur l’ensemble de sa carrière. C’était évident, ça allait de soi, moi j’étais ingénieure donc je ne valais rien, mais lui comme d’autres, qui étaient aussi ingénieurs, d’une école moins prestigieuse que la mienne, eux ils étaient justifiés d’être là.
Toi, tu as pu monter jusqu’à quel grade ?
Je suis restée assistante tant que les assistants existaient. J’avais été un an ou deux cheffe de travaux pratiques, ç’avait été assez vite pour passer assistante, c’est pour ça qu’on m’a dit que j’avais eu une promotion express, parce qu’après avoir été 17 ans vacataire, je ne suis restée que deux ans cheffe de travaux pratiques… Puis parmi les contractuels, ils n’ont plus fait que deux catégories, 2eet 1erecatégories. Alors je suis devenue prof de 2ecatégorie, et je suis restée là.
Pour toi, c’était lié au fait d’être une femme ?
Pour moi oui, c’était très clair, j’avais une base de militantisme féministe qui me permettait de m’en rendre compte. Mais au plan personnel il y avait tout le temps des moments où je me remettais en question en disant : « Je ne suis pas une artiste », je culpabilisais. Alors que j’avais un diplôme d’une des plus prestigieuses écoles d’ingénieur françaises. Et ce que je voulais faire ça avait toujours été ça, travailler avec des artistes, c’était un choix, mais je n’étais jamais très sûre, je me disais après tout peut-être qu’ils n’avaient pas besoin d’ingénieurs dans les milieux artistiques.
Et est-ce qu’il y avait d’autres femmes autour de toi ?
Oui, il y avait quelques enseignantes, en particulier des femmes qui ont débuté dans le numérique, je veux parler de Françoise Courbis[enseignante depuis 1990], elle avait été une des premières étudiantes qui étaient venues travailler dans le labo numérique, où je bossais à moitié bénévolement, rémunérée sur des sessions de formation permanente… je ne sais pas le nombre de fois où j’ai arrêté de gagner des sous… j’en trouvais ailleurs. À un moment où j’en avais vraiment marre d’être vacataire, je ne faisais plus que de la formation permanente, plus rien avec les élèves de l’École, alors je me suis mise à travailler comme ingénieure, j’ai été embauchée dans une boîte où on a fabriqué des logiciels de composition et de mise en page, ça n’a pas marché, la boîte a fait faillite et je suis entrée dans une autre boîte et là on a fait quelque chose qui a marché, dont je suis très très fière, j’ai fait les premiers systèmes de transmission de photos sur le réseau, je faisais ça au moment où mes enfants naissaient, vers 1988. J’ai travaillé comme ingénieure à temps partiel pour pouvoir assurer des cours aux Arts Déco, j’aimais cette ambiance, travailler avec des artistes. J’adorais ça.
Ça paraît fou que vous vous remettiez en question, alors que vous étiez ultra compétente.
Même si j’étais quelqu’un pour qui l’argent n’avait pas vraiment beaucoup d’importance, si tu n’es pas payée, tu en déduis que tu n’es pas bonne. Comme ingénieure, j’ai gagné des cents et des mille… là j’étais en position de force. Aux Arts Déco, toujours en position de faiblesse.
Et avec les autres femmes, il y avait une entraide ?
Parfois, pas tant que ça. Il y avait certaines personnes féministes, plutôt du côté de l’administration. Par exemple Marie Planques, étudiante avec laquelle j’ai travaillé, m’a été envoyée par quelqu’un de l’administration, parce qu’elle voulait faire un mémoire sur l’art féministe radical alors que ses profs étaient des machistes primaires [Quel(s) art(s) pour les luttes féministes ?, 2007]. [fig.3] Ça a été génial notre collaboration, j’ai adoré. Au moment du tract que vous avez retrouvé, j’étais très triste, je voyais bien que la grande majorité des profs ne voulait pas que les femmes montent. L’enseignement était en train de se dévaloriser, les profs des lycées et collèges qui avaient été des gens importants étaient devenus des moins que rien. La féminisation égale la dépréciation du boulot, et donc ils tenaient à ce que les profs restent des hommes, parce que si ça se féminisait, ça voulait dire que ça vaudrait beaucoup moins. Notre arrivée les menaçait, parce que tout ce qui se féminise, les infirmières, les professeurs du secondaire sont payés des clopinettes et n’ont plus de prestige social, ils allaient perdre leur prestige si certaines femmes venaient. Certains l’ont dit : « Faut que tu comprennes, on est menacé si ça se féminise ». Le pouvoir d’achat des profs de l’Ensad avait déjà nettement diminué. Pour moi, ça fonctionnait dans l’autre sens, c’est parce que les métiers avaient commencé à être dévalorisés que les hommes les laissaient tomber et que les femmes en acceptaient les conditions. Moi j’ai accepté toute ma carrière de travailler pour des clopinettes, mais si tu ne demandes pas assez cher, c’est que ton travail ne vaut pas cher. Toi-même tu l’intériorises.
Tu étais dans le secteur animation, qui est un secteur encore très masculin.
J’étais très marginale, j’étais plus numérique, les responsables étaient sur l’animation traditionnelle. À part moi tous les profs qui avaient des contrats étaient des hommes. Il y a eu une grande artiste, Florence Miailhe [enseignante de 2001 à 2016], une réalisatrice de films d’animation reconnue, qui est restée très longtemps, peut-être bien toujours, vacataire. Il y a un pouvoir mandarinal aux Arts Déco, les responsables de secteurs ont un poids énorme, il y a un système de cooptation qui maintient un statuquo. On sait que la cooptation est un système qui est dramatique pour les femmes, qui reproduit toujours l’existant.
Est-ce que tu avais le sentiment d’être entendue, dans les réunions ?
Pas du tout, dans le secteur animation j’avais l’impression d’être systématiquement mise à part, mais je pense que c’était parce que je travaillais dans le numérique.
Mais si vous aviez été un homme, on vous aurait écouté ?
Je pense qu’on m’aurait beaucoup plus écoutée. Quand je vois comment mon collègue et ami a été écouté… Il a été le ponte de l’image numérique aux Arts Déco. Je reconnais qu’il était très fort, et surtout très bosseur et très acharné.
Et est-ce que vous vous exprimiez ?
Je me suis exprimée, le tract [fig.4], ça n’a pas dû être le seul. Des fois, j’ai dû laisser tomber, me consacrer à des combats et des passions en dehors de l’Ensad. En 2001, j’ai fait de la politique locale à Montreuil, sur des objectifs écologiques; en 2008 on a gagné les élections, j’étais adjointe à l’Espace public, j’ai eu une implication moins forte à l’Ensad. Jusqu’en 2001 j’étais extrêmement présente à l’École, je me suis impliquée énormément dans les plateaux [projets transversaux organisés en début de cursus]. On restait la nuit, on était déchaîné. J’ai fait avec des élèves un gros projet en collaboration avec le ministère de l’environnement, un autre avec la sécurité routière.
Et dans les instances ?
Je pense que j’étais au CER du temps de Gallot [Geneviève Gallot, directrice de 2008 à 2013], on était très peu de femmes dans les instances, les trucs se décidaient au dehors, les coordonnateurs c’était des petits directeurs d’école dans l’École. Il y avait un coordonnateur, c’était le roi, s’il décidait que c’était comme ça dans son secteur, qui faisait un tiers de l’École, c’était comme ça; il n’y avait pas une instance qui allait imposer quoi que ce soit à cet homme-là. L’arrivée de Geneviève Gallot c’est un souvenir très marquant, très fort. Elle a fait une double révolution. Elle est arrivée, c’était pour la première fois une femme directrice de l’École, et pour la première fois quelqu’un qui n’était pas une artiste. Avant c’était des artistes, à qui on donnait cette position et souvent ils ne dirigeaient pas l’École – Richard Peduzzi [directeur de 1990 à 2002] il a permis qu’on fasse des choses extraordinaires en numérique, parce qu’il nous a laissé faire, au fond ce n’était pas son sujet de diriger l’École, il ne cherchait pas à tout contrôler. Gallot, elle a eu une vraie volonté de promotion des femmes. Elle a vraiment voulu faire quelque chose pour la parité dans l’École. Elle le disait. Moi au départ j’étais folle de joie : « Je vais enfin avoir ma place dans cette École ». Il y a évidemment eu un côté sexiste : on l’attendait au tournant. Elle a été dure, elle a essayé de remettre de l’ordre. Les Arts Déco, c’était un bordel absolu, tu faisais ce que tu voulais, ça a permis des choses, une liberté gigantesque. Il y avait des artistes reconnus, c’est important, ils apportent énormément aux élèves, mais certains venaient faire cours quand ils n’avaient rien d’autre à faire. Gallot avait probablement un certain manque de souplesse, elle a été vite détestée, forcément après des directeurs qui laissaient faire tout ce qu’on voulait faire. Elle a été particulièrement détestée parce qu’elle était une femme. Je l’ai ressenti. « C’est pas une artiste et c’est une femme, on n’a pas besoin de ça chez nous. »
Tu menais des projets féministes ? Tu transmettais comment le féminisme aux élèves ?
Je poussais vraiment les filles à oser. « Vous faites des études pour être les meilleures ». J’avais tendance à privilégier des créations féminines. En direction de mémoires, on venait me chercher pour diriger des mémoires en rapport avec les femmes [fig.5]. J’ai dirigé un mémoire sur les réalisatrices féminines au cinéma [Kalinka Weiler, Femmes cinéastes, 1984].
Est-ce que les étudiant·es t’écoutaient à l’égal d’un homme ?
Oui, je crois que oui. Aux débuts de l’ordinateur, j’ai eu des étudiants qui découvraient ce qu’était une souris. Moi je savais, j’ai pris le truc de l’informatique au tout début. Les étudiants étaient impressionnés par mon savoir numérique. Mes collègues eux ne se rendaient pas compte à quel point le numérique allait être important. Je n’ai pas eu d’impression de discrimination par les élèves, je l’ai eu très fortement par l’institution et par mes collègues.
Est-ce que les femmes étudiantes attendaient quelque chose de particulier parce que vous étiez une femme ?
Oui très nettement dans les directions de mémoires, les élèves qui sont venues me chercher c’était beaucoup celles qui travaillaient sur des histoires de femmes, liées à la place des femmes dans la création.
Est-ce que vous avez senti l’arrivée de plus d’étudiantes durant votre carrière ?
Ça a été une évolution progressive, pas majeure. Même quand je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup d’étudiantes. J’avais beaucoup fréquenté des milieux très masculins, dans mon école d’ingénieur, il y avait trois-cents mecs et on était quatre filles. Le MLF, ça avait été en plus de la lutte, le bonheur d’être enfin avec des femmes. Mes loisirs aussi : je jouais aux échecs, c’est que des mecs, je faisais du bateau, c’était beaucoup des mecs. Aux Arts Déco, je me sentais dans un lieu équilibré, avec un peu plus d’étudiantes que d’étudiants. Quand je me suis battue contre la domination des hommes dans le corps enseignant, j’ai fait remarquer que ce n’était absolument pas logique, car ça ne reflétait pas nos étudiants, nos futurs professionnels. On n’était pas dans une école de mécanique.
En animation, c’était surtout des étudiantes.
C’était à peu près équilibré, c’était un petit secteur.
C’était où dans l’École ?
Moi j’étais au service informatique en mezzanine Érasme, là où étaient tous les ordinateurs. C’était un endroit ouvert à toute l’École. Le secteur animation proprement dit était à un autre étage. Ça aussi, ça a contribué à m'isoler du reste du secteur.
Tu te sentais bien partout ?
Je n’ai pas souvenir de pressions sexuelles ou quoi que ce soit. Jamais. J’avais une façon d’être, de me tenir, de m’habiller qui était très neutre, peu sexuelle. Vers 50 ans, je me suis dit que j’avais très envie de devenir une bombe sexuelle, donc je le suis devenue entre 50 et 60 ans, et je me souviens d’un collègue et ami qui m’a dit à ce moment-là : « Depuis le temps qu’on travaille ensemble, je n’avais jamais pensé que tu pouvais être une femme ». À 50 ans, je me suis dit, j’ai envie – les talons hauts, la jupe courte, et ce qu’il y a de génial aux Arts Déco c’est que tu peux t’habiller comme tu veux, tant que tu ne viens pas à poil, on te fout une paix royale. Je suis passée de la robe informe à la mini-jupe : pas de remarques, les gens étaient seulement étonnés d’après ce qu’on m’a rapporté plus tard.
Tout à l’heure, tu disais que tu avais eu des enfants, est-ce que c’était facile d’avoir des enfants à l’École ?
Ça a été très facile. Ça n’a jamais été un problème que je sois enceinte, j’avais besoin de sous, je n’allais pas prendre un congé maternité… Et j’ai eu des enfants avec un mari qui s’est beaucoup occupé de nos enfants. J’ai été plus comme un mec qui a des enfants, ça a peu impacté ma vie professionnelle. J’ai des souvenirs d’être venue enceinte de ma fille avec mon fils bébé aux Portes ouvertes des Arts Déco, puis j’ai souvent fait les Portes ouvertes avec eux.
As-tu été témoin d’actes ou de propos sexistes ?
Oui, et là je me dis que je n’ai pas remué le ciel et la terre pour lutter contre. Il y avait au début des années 2000 un type devenu prof, plusieurs élèves se sont plaintes qu’il se penchait sur elle, qu’il avait une façon de les toucher, ce genre d’attouchement gluant. Il y a eu des accusations assez précises contre des profs, contre une personne qui travaillait en lien avec la direction technique. Il n’y a jamais eu une étudiante qui est venue se plaindre à moi en privé, je l’ai su par la rumeur ou j’en ai entendu se plaindre dans des groupes. J’ai probablement laissé passer des choses. Il y a eu des histoires sur des profs un peu trop tendres physiquement. Je m'en veux maintenant de ne pas m'être assez insurgée contre ces comportements. D'avoir laissé faire par mon silence. De ne pas avoir systématiquement cru les filles qui se plaignaient. D'avoir considéré comme un élément à décharge le fait que l'agresseur dénoncé n'avait jamais eu de comportement équivoque avec moi. Maintenant, nous avons évolué. Aujourd'hui je me dis que je fais plus de mal en ne croyant pas une personne réellement victime d'attouchements qu'en croyant une affabulatrice. Mais à l'époque, même les féministes, nous n'étions pas à ce stade de réflexion.
Et des propos déplacés ?
Oui, sans arrêt : « Celle-là son projet est vraiment pas terrible mais qu’est-ce qu’elle est mignonne » ou dans l’autre sens. Il y avait toujours pour une fille ce besoin de préciser si elle était mignonne, si elle ne l’était pas. Ça se faisait tout le temps, mais pas devant les étudiantes. Au concours d’entrée, aussi. Un collègue masculin me dit aujourd’hui qu’il a entendu des horreurs, qui le mettaient très mal à l’aise. Il est probable que lorsqu'une femme était dans le jury, les hommes se retenaient de faire des remarques trop ouvertement sexistes, et donc que je n'ai pas entendu le pire… j’ai quand même des souvenirs de discussions entre les membres de jury. On vient de recevoir quelqu’un, on parle après. Et pour une fille, on précise si on la trouve jolie ou pas. Tu ne peux pas vivre avec les gens en étant sans arrêt en train de les reprendre, sinon tu n’as plus de relations, donc tu fermes ta gueule.

Mona Hackel
étudiante
depuis 2019
avec
Alexandra Piat
le 06.11.20

- Déséquilibres
- Hommage
- Ignorance
- Parole
- Langage inclusif
- Manque de collectif
- Engagement
Entretien de
Mona Hackel
étudiante depuis 2019
le 06.11.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
J’ai vingt-deux ans et je suis une femme. Je suis arrivée en équivalence, en deuxième année d’Image imprimée. Aujourd’hui je suis en troisième année. Ça fait seulement un an et demi que je suis là. Je n’ai pas une expérience très longue au sein des Arts Déco de Paris, mais j’ai déjà connu une autre école d’art avant celle-ci, l’Esal d’Épinal où j’ai déjà pu constater des choses plus ou moins sympathiques au sein de l’institution « école d’art ».
Qu’est-ce qui te vient à l’esprit quand on te parle de ton expérience en tant que femme à l’école ?
Quand j’ai vu votre annonce, ça m’a remplie de joie, parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Pour moi, la posture des femmes dans le milieu de l’art est très intéressante à questionner.
Spontanément, ça m’a fait penser à plusieurs choses dans mon vécu au sein de mon autre école et des Arts Déco. Je constate qu’il y a beaucoup de femmes en école d’art, ou qui ont accès à ces cursus, mais dans le paysage des artistes médiatisé·es issu·es de ce milieu, finalement il y a assez peu de femmes. C’est cela dit en train d’évoluer j’ai l’impression. Ça me fait penser qu’avant d’arriver aux Arts Décoratifs de Paris j’étais très heureuse et fière de rentrer dans cette institution-là et j’imaginais un établissement qui serait très au fait des sujets de société. C’est le cas, dans le sens où sur le papier et dans les discours, il y a pas mal de choses amorcées par le directeur, l’équipe administrative et l’équipe pédagogique pour sensibiliser les gens aussi bien aux questions environnementales qu’aux questions féministes. Mais dans les faits, j’ai été déçue de constater par exemple que l’écrasante majorité de mes professeur·es en section Image imprimée sont des hommes. Ça m’a déçue parce que ça conditionne selon moi beaucoup de choses dans les rapports profs-élèves. J’ai constaté, comme dans mon ancienne école, que certains de ces professeurs en poste depuis longtemps monopolisent énormément la parole. Ce n’est pas le cas de tous, encore une fois, il y a de la nuance à apporter, mais il en existe (trop) malheureusement.
Pas plus tard qu’hier justement je me disais que les professeures de l’équipe pédagogique sont inspirantes. J’ai l’impression que certaines professeures comme Lucile Encrevé que j’ai eu en cours magistral ou Elsa Boyer que je rencontre cette année pour un studio, ce sont des femmes qui ont appris à prendre la parole dans ces équipes pédagogiques où c’est difficile d’avoir sa place. C’est le sentiment que j’ai en tant qu’étudiante.
À quel moment dans ta pratique, ton expérience de l’école te renvoie à ton genre ?
Par rapport à mon travail et à ma voix en tant que créatrice, j’ai l’impression qu’il y a une écoute de la part des professeur·es et de mes camarades. En revanche, j’ai senti parfois une écoute plus « molle » de certains professeurs quand j’évoque mes projets teintés de réflexions sur des problématiques féministes. Concernant certains de ces professeurs, qui sont des hommes, plus vieux et en poste depuis longtemps, j’ai senti qu’ils n’avaient pas forcément d’avis sur ces sujets. C’était plutôt une logique du genre « On est contents que tu te saisisses de ces enjeux-là dont on ne connait pas grand-chose ». Pour la plupart ils n’étaient pas aptes à me renvoyer vers des lectures, à nourrir cette réflexion, mais en tout cas ils avaient l’air plutôt enthousiastes.
Pour donner un contre-exemple, j’ai rencontré l’un de mes professeurs, Paul Sztulman, avec qui j’ai eu de longues discussions sur les questions féministes. On a échangé au dernier confinement lors de réunions zoom, sur des ouvrages, des lectures, des podcasts. Cela m’a rendue très enthousiaste de savoir que dans cette équipe pédagogique, majoritairement composée d’hommes, il pouvait y en avoir certains concernés et acteurs de ces débats de société.
Est-ce que dans ta pratique on t’a déjà renvoyée vers des clichés féminins ?
Ma pratique se situe entre l’illustration, la radio, la musique et l’écriture et à aucun moment je n’ai eu l’impression qu’on me disait « Ce que tu fais est estampillé féminin ». Je suis aussi consciente que la radio est un médium de pouvoir qui permet de décider de prendre la parole ou de la distribuer. Il y a quelque chose de l’ordre du réempouvoirement dans le fait de faire ça. Dans ce que je peux faire en dessin, en bande dessinée, dans les histoires que je développe, il y a toujours la question du langage qui revient, et ça aussi : parler du langage de façon critique aide à penser le monde de façon inclusive. J’ai l’impression que mon travail questionne directement certains rapports de dominations qui peuvent exister. Jusqu’à maintenant personne n’a invalidé ouvertement les idées que je soutenais.
Je me suis déjà posée la question de savoir si mon dessin était genré. Sur mon compte instagram, il y a plus de 70% de femmes qui suivent mon travail et je trouvais ça à la fois intéressant et un peu bizarre car justement les thématiques que j’aborde sont souvent empreintes de questionnements en lien avec les luttes féministes. Cela me rend triste parce que je me dis « Est-ce que ça ne concerne que les femmes ? ». Cela rejoint ce que je disais sur le fait que les professeurs hommes de l’école m’encouragent à m’engager à ce niveau-là, mais qu’ils n’ont pas l’air concernés et engagés…
Tu as des projets féministes ?
J’aimerais commencer une bande dessinée sur la thématique de la pilosité féminine, parce que j’ai l’impression que ce sujet regorge d’histoires chouettes et beaucoup moins marrantes à raconter. C’est un sujet épineux qui est plus politique qu’on ne le pense !
C’est très intéressant le thème de la pilosité. Pour parler personnellement, l’école ça a été le lieu où j’ai vu des femmes qui « portaient leurs poils avec fierté ». Cela m’a permis de me sentir plus libre de l’afficher et c’est grâce aux filles de l’école.
Pareil ! C’est grâce à l’école d’art dans laquelle j’étais avant où j’ai pu apprendre à m’accepter avec mes poils. Quoique, l’école d’art n’est pas forcément un lieu safe. J’ai déjà eu des commentaires de mecs de la classe sur le fait que je n’étais pas épilée sur les jambes. C’est un vaste sujet…
Tout à fait ! Les poils et les cheveux des femmes sont un vaste sujet.[Depuis cet entretien Mona a réalisé le fanzine BB [fig.6] comme une réponse à la presse féminine, le premier numéro abordant le lien entre les femmes et la nourriture, avec Chloé Delchini].Est-ce que dans tes cours à l’école, que ce soit en création ou en théorie, il y avait généralement une bonne représentation des créatrices ? Est-ce que tu pouvais t’identifier ?
Oui. Je me rends compte à quel point c’est important en tant que femme d’avoir des modèles « féminins » pour qu’on soit représentées. Ça n’invite qu’à se faire sa place à son tour. Cependant, j’admire aussi bien des hommes que des femmes, peu importe leur genre. J’admire les gens pour ce qu’ils transmettent comme message. Je pense que certains hommes qui ont fait l’effort de se remettre en question sont importants comme alliés de nos luttes.
Est-ce qu’à l’inverse, parfois tu as manqué de représentation « féminine » et pour quelles raisons ?
Oui ça m’a manqué et ça rejoint l’exemple dont je te parlais tout à l’heure de Elsa Boyer et Lucile Encrevé. Je me suis fait la réflexion, en les écoutant, que je les trouvais fortes. Fortes parce qu’intelligentes, assurées et inspirantes. En ça, je les admire, elles me donnent envie de faire pareil. Cela m’est absolument insupportable d’assister à trois heures de cours non-stop où un prof homme fait sa tirade en bloc et que toutes les fois où on tente d’intervenir, cette personne-là revient soit à sa pratique, soit sur le strict contenu de son cours sans prendre en considération nos remarques. C’est au contact de Elsa Boyer, Lucile Encrevé ou encore Géraldine Gourbe, que j’ai senti qu’elles y attachaient de l’importance et par conséquent, l’écoute faisait partie intégrante de leur pédagogie.
Il y a un manque d’échange dans la manière d’enseigner de certains hommes ?
C’est comme ça que je le ressens. Après je n’aime pas l’idée d’associer l’écoute, à quelque chose de forcément « féminin ». Ça m’embête de penser les choses comme ça, j’aimerais qu’elles soient agenrées.
Étant dans une classe où il y a une majorité de femmes j’ai constaté que quand on aborde des sujets féministes, les mecs de ma classe sont complètement en retrait. Ils ne font aucune remarque. On ne demande pas qu’ils se positionnent en disant « oui je suis d’accord », mais juste qu’ils nous fassent part de leurs interrogations. Je me souviens d’un moment en deuxième année où on a parlé du Chef d’œuvre inconnu de Balzac. On devait se servir de ce texte-là pour l’illustrer. La nouvelle raconte l’histoire d’un peintre qui tombe en fascination devant une muse, sauf que cette muse « appartient » à un jeune homme qui est son amant. Le peintre va demander l’autorisation à ce jeune homme pour faire le portrait de cette femme. Je me souviens qu’à sa lecture cela a créé un débat dans la classe. On se disait « c’est quand même hardcore l’absence du consentement et le manque de la voix de cette femme ». Même s’il y a un contexte historique à cette nouvelle, que ce sujet soit proposé comme lambda, ça nous répugne nous, en tant que femmes. Nous étions plusieurs à nous positionner en disant « On peut peut-être questionner ça ensemble non ? ». À ce moment-là, aucun mec de ma classe ne s’est positionné, et le prof à l’initiative de ce projet semblait assez désemparé.
Pour lui l’excuse du contexte historique suffisait ?
Je ne pense pas, mais il tombait de haut. Il a souligné que notre remarque était pertinente et que c’était intéressant et important de questionner les choses avec notre regard contemporain, mais il n’a pas du tout alimenté le débat. Ça me pose problème que cette remise en question ne soit pas généralisée. On peut être homme, prof aux Arts Déco et sensible aux questions féministes. Surtout, on peut avoir un véritable dialogue qui dépasse le simple rapport prof/élève et qui permet de questionner ensemble le monde dans lequel on vit. Je crois que j’aime mieux penser la pédagogie comme ça, dans le sens où on peut s’apporter réciproquement peu importe notre genre, notre classe, notre sexualité, notre âge.
Dans cette grande école où se côtoient plein de profs, de gens de la culture, d’intellectuel·les, l’écriture inclusive trouve parfois une certaine réticence à l’usage. Pourtant ça ne leur enlèverait pas un bras de faire cet effort-là ! Une professeure en Image imprimée nous parlait d’une illustratrice et « auteur ». Elle ne disait pas « autrice » et se justifiait en disant « Ça m’écorche l’oreille ! » Un autre prof nous a dit « L’écriture inclusive, je trouve ça quand même affreux !! ». Ça m’énerve ! Parce que pour beaucoup de personnes c’est important, pour moi évidemment.
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé à l’école ou dans ton travail de ne pas être prise au sérieux parce que tu étais une femme, en cours, dans les ateliers ou autre ?
Non je ne pense pas.
Est-ce que tu as eu la sensation d’être abordée différemment quand tu viens demander ou faire quelque chose ?
Il y a peut-être un atelier où c’est extrêmement désagréable de me rendre, et je ne sais pas si c’est lié à mon genre, mais en tout cas c’est l’endroit où se cristallisent toutes mes appréhensions et mes peurs. Bon nombre d’étudiantes partagent mon avis. Quand je viens voir ce technicien et que je lui pose des questions, parce que je suis nouvelle — en plus ma deuxième année a été une demi-année à cause des grèves et du Corona — j’ai l’impression d’être la plus stupide des personnes de cette Terre. Je comprends sa situation, il a une école avec je ne sais pas combien de gens qui viennent lui rendre visite pour lui poser tout le temps les mêmes questions, mais en tout cas, j’ai l’impression à son contact d’être débile et ce n’est pas normal. À part ça, dans l’ensemble ça va.
Est-ce que l’école te semble un endroit où tu peux te sentir un peu plus forte, un endroit où tu te sens « empouvoirée » ?
C’est une très bonne question. Je me la suis posée cet été. J’étais assez peinée qu’au sein de l’école il n’y ait pas de lieu de discussions, de rencontres pour se fédérer et réfléchir ensemble à plein de questions qui s’imposent à nous et à notre génération. Cet été, je m’étais dit que ce serait chouette qu’on fasse un espace de parole. Je ne sais absolument pas à qui proposer ça, à qui ne pas proposer ça, je ne savais pas trop comment ça pourrait s’organiser… Il pourrait y avoir aussi bien des profs, des gens de l’administration, que ce soit ouvert à un maximum de gens. Je me disais que si l’école servait à ça, à se rencontrer, à penser les choses ensemble, alors oui ce serait un fabuleux lieu d’empouvoirement. En tout cas moi je sens que ça me permettrait de me sentir encore plus à ma place.
Récemment il y a une étudiante, Rose Vidal [étudiante], qui nous a envoyé un texte du séminaire de Virginie Despentes [écrivaine et réalisatrice française] pendant le cycle de conférences de Paul B. Preciado [philosophe espagnol]. J’ai sauté de joie de voir qu’elle a utilisé cher·es tous·tes [mailing liste des étudiant·es de l’école] à ces fins-là. Que ce lieu, même s’il est numérique, puisse être un lieu justement d’échanges, d’empouvoirement, de réflexions communes sur ces sujets. À l’école, c’était dur pour moi de me sentir pleinement bien en si peu de temps parce que j’avais l’impression que c’était un lieu qu’on traversait, un lieu dans lequel on venait se remplir de savoirs, mais qu’il n’y avait pas de moments de véritables échanges. C’est un lieu où on est tous·tes dans nos secteurs, dans nos têtes et dans nos vies. C’est pour ça que je vous ai parlé de Paul Sultzman et Rose Vidal avec qui les échanges étaient chouettes. C’est juste très dommage que ça se fasse juste d’une façon numérique. [Depuis cet entretien Mona a réalisé des affiches [fig.7] reprenant le discours de Virginie Despentes du 16 octobre 2020 lors du séminaire de Paul B. Préciado Une nouvelle histoire de la sexualité, avec Charlotte Genser]
Tu seras sûrement contente de savoir qu’on est en train de créer une association féministe à l’école avec d’autres étudiant·es.[fig.8]
Trop bien !
On est plusieurs à avoir réfléchi à une structure d’association et à avoir écrit les formes que ça pourrait prendre. C’est intéressant de voir qu’à l’école il manque cet esprit de communauté, d’échange et notamment dans la pédagogie. Avec une autre interviewée, on parlait un peu du lien entre cet individualisme, ce manque d’échange, d’empathie, etc. et l’esprit assez patriarcal de l’école.
Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu parlais de l’idée de créer une communauté, de pallier le fait que c’est un lieu que l’on traverse et où les étudiant·es sont des courants d’air et je me disais que ce serait bien de penser les choses de façon horizontale au maximum. C’est-à-dire que cette notion de prof/élève soit un peu moins marquée.
Est-ce que tu as l’impression dans l’école en général que l’engagement, les luttes sociales, c’est quelque chose qui mobilise plus souvent les femmes ?
Très bonne question. Ça rejoint complètement ce que je te disais sur mon envie d’avoir un lieu où on se retrouve, on parle, on repense le monde ensemble. En comparant mon expérience dans une autre école d’art, à ce que j’ai découvert aux Arts Déco, j’étais très triste et en colère de constater que les luttes féministes ne sont pas suffisamment, selon moi, mises au centre des débats. Que l’école en tout cas n’est pas, comme je le ressens, un lieu où il y a une démarche collective de s’emparer de ces sujets politiques. Je m’en rends compte en te rencontrant, qu’il y a des réseaux sous terrains de gens qui œuvrent dans ce sens. Mais les luttes féministes, écologiques sont portées par des femmes, et en même temps, peut-être que c’est logique, dans une école où la majorité des personnes qui rentrent sont des femmes.
J’ai l’impression que, par rapport à l’autre école où j’étais avant, les débats de société infusent assez peu la production des étudiant·es. Moi dans ma classe, par exemple, il y a très peu de gens qui feraient spontanément des fanzines féministes ou décoloniaux par exemple…
Est-ce que tu as déjà été témoin ou victime de sexisme ou d’agression verbale ou physique, de situations gênantes ou problématiques ?
Je n’en ai jamais vécu et je touche du bois. Ni témoin, aux Arts Déco non, pas à ma connaissance. J’ai entendu quelques étudiantes qui se plaignaient de profs qui étaient lourds, cassants à leur égard, mais j’ai cru comprendre qu’elles en ont parlé autour d’elles et qu’elles ont trouvé du soutien auprès d’autres étudiant·es.
[fig.8]
Roxane Jubert
ancienne étudiante,
enseignante depuis 1997
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 13.11.20

- Carrière
- Racisme
- Histoire des créatrices
- Sexisme
- Mobilisation
- Minorité
- Concours
- Rôles genrés
- Silence et parole
- Écologie
- Relation aux étudiant·es
- Aura masculine
- Épanouissement
- Dévalorisation
Entretien de
Roxane Jubert
ancienne étudiante, enseignante depuis 1997
le 13.11.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Lucile Encrevé
Qui es-tu dans l'École ? Peux-tu nous retracer ton parcours ?
On m'a sollicitée quand j'étais très jeune pour faire des cours à l'École. À l'époque c'était un cours du vendredi soir je crois, cela représentait très peu de temps par rapport à ma pratique professionnelle. J’étais graphiste à plein temps. Avec le temps, il s'est passé ce qui s’est passé avec un certain nombre de vacataires : on vous sollicite pour de plus en plus de cours, jusqu'à ce que vous arriviez au plafond ; à ce moment-là vous devenez un prof à part entière tout en n'ayant pas ce statut-là. Pour moi, ça a duré très longtemps.
Cette question de ton statut longtemps précaire, tu l’associes au fait d’être une femme ?
À ma connaissance, la seule personne, une femme, qui avait fait quelque chose au sujet des déséquilibres flagrants entre hommes et femmes était Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015], au début des années 2000. Elle avait fait un document, qu'elle avait mis dans les boîtes à lettres, que j’ai conservé du fait de la rareté des traces sur ce sujet ou des expressions qui restent, où elle essayait d'analyser la situation.
Je crois qu’il en ressortait qu'il y avait très peu de femmes enseignantes, et qu’elle faisait apparaître qu'une femme attend deux fois plus d'années qu'un homme pour pouvoir espérer quelque chose. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de se retrouver dans ce statut de vacataire, qui ne correspond à rien lorsqu’on est longtemps dans l’École en s’y impliquant, et de n'avoir aucune idée de l’avenir.
Tu intervenais où dans l’École ?
Je suis d’abord intervenue en 1ereannée (c'était bien avant que ma recherche devienne visible, j’ai démarré ma thèse à peu près quand j’ai commencé à enseigner à l’École). Il s’agissait d’un cours lié à la vidéo, au montage d'images, à l'image en mouvement. Et puis il y a eu des besoins en typographie. Je pense que c'est René Lesné [ancien enseignant et directeur des études] qui a dit que j'étais dans les murs et qui m’a proposé un cours de typographie. Je me souviens qu’il y a eu pour cela une commission, à laquelle je suis venue présenter mon book. Je n'avais jamais envisagé d'enseigner et puis j'ai trouvé passionnant l'enseignement : le lien avec les étudiants, la confrontation avec les questions qu'ils se posent, le rôle très particulier qu'on peut avoir. J'ai accepté ce cours. De fil en aiguille, j'ai fait des cours de typographie en 1ereannée, puis en 2e année Design graphique [DGMM]. Par la suite ça s'est étendu, et je suis intervenue en Design objet [DO] et en Design textile [DT]. C'était une période très heureuse, très paisible, avec des relations humaines très positives de manière générale. Ensuite est arrivée la fin de ma thèse et sa publication sous forme de livre. J'en parlais peu à l’École (hormis avec quelques personnes) car c'était une période où on détestait les universitaires, ce qui a beaucoup changé. Au moment où j’ai soutenu ma thèse, suivie de près par la parution de mon livre, je me suis retrouvée à une rentrée avec des cours uniquement hors du secteur DGMM, ce qui s’est poursuivi sur beaucoup d’années. J'ai alors été en textile, qui est un très beau secteur dans l'École, en DO et je suis restée en 1ereannée où j'ai été très longtemps et que je trouvais extrêmement intéressante du fait qu’on avait le temps d’y faire de la pure expérimentation typographique. À l’extérieur, beaucoup de personnes qui m’interrogeaient année après année sur le secteur DG ne comprenaient pas que j’aie pu ne pas y avoir été pendant si longtemps.
Ce chemin, que tu décris comme une ostracisation par rapport au secteur DG, est-ce que ça a un lien avec le fait d'être une femme (puisque tu m’as dit un jour que des hommes ont vécu la même chose) ?
Ça a un lien, oui et non. Là où il y a un lien, c'est que je suis consciente que je ne suis pas une totale inconnue dans mon champ, je n'ai pas non plus souhaité que mon travail sorte de l'ombre comme cela a été le cas du jour au lendemain. Je pense que quand on est une femme et qu'on fait une chose qui n'est pas maîtrisée par la corporation masculine à laquelle on est censée appartenir (et alors qu’elle régit largement la profession, dont son enseignement), alors ça peut devenir quelque chose d'impossible. Plus encore lorsque l’on se trouve dans un lieu de jeu de pouvoir réglé par et pour des hommes, où les femmes n’avaient pas vraiment de légitimité à exister indépendamment de cela. Je me souviens que, deux ans après la sortie de mon livre Graphisme, Typographie, Histoire [fig.9] [Paris, Flammarion, 2005], j’ai croisé à la bibliothèque un important enseignant de Design graphique, au tempérament généreux, que j'aimais beaucoup. Il m’a dit qu’il venait de découvrir mon livre, m’a félicitée, et m’a demandé comment il était possible qu’il n’ait pas été au courant de sa parution. Dans la discussion qui s’en est ensuivie, nous nous sommes dit que si ça avait été le travail d'un homme, il en aurait été autrement. Je me souviens que, lors de cette conversation, il m'a dit : « On aurait dû faire une fête ».
Qu'est-ce qui dans ton livre a pu faire qu'on ne veuille pas t'écouter ou est-ce seulement le fait que tu t'exprimes et fasses un ouvrage important qui posait problème ?
D’abord, il y a manifestement le fait de faire un travail tellement fouillé sur l’histoire d’une pratique et d’une profession (qui a fait si peu de place aux femmes). C’est une façon de vouloir voir le monde, de faire, et une vision des choses, qui est exactement la même que celle que j’ai à l’école. Je ne distingue pas mon travail de ce que j’ai fait ou dit à l’école, c’est-à-dire à un moment donné : tirer au clair, savoir ce qu’il se passe et ce qu’il s’est passé, mettre de la lumière là où il n’y en a pas ou peu. Quand j'ai travaillé sur la partie du XXe siècle, j'ai été confrontée à une chose : il y avait extrêmement peu sur les périodes des deux guerres mondiales dans l’histoire du graphisme. Pour moi, il n'était pas possible de ne pas traiter ces périodes au même titre que les autres, parce que la communication visuelle a de toute évidence partie liée à la propagande, mais aussi à la Résistance. Qu'ont fait les graphistes durant la guerre, durant la collaboration ? Il y a eu tout au long du XXe siècle en France l'expression d'un très fort nationalisme en typographie. Par exemple, Maximilien Vox, une grande figure de la typographie en France, n'a pas eu un comportement très vertueux durant la seconde guerre mondiale, j'ai fait état de ça, je suis allée consulter à la bibliothèque Sainte-Geneviève Nouveaux destins de l'intelligence française, un livre édité au début des années 1940, dans lequel Maximilien Vox a publié un texte. Ce livre est préfacé par Charles Maurras, qui y écrit des lignes profondément racistes – ce que j’ai mentionné dans mon livre. J'ai été très surprise de découvrir que le livre Nouveaux destins de l'intelligence française contenait un texte de Jacques Adnet, qui a été directeur de notre école [1959-1971], même si ces textes en eux-mêmes pouvaient ne pas être impliqués dans des questions de collaboration directe.
Dans ce livre, comme dans ton enseignement, est-ce que les femmes sont mises en valeur ?
Quand j'ai fait mon livre, il n'y avait pas les sources qu'on a aujourd'hui. L'accès à l'apport des femmes était très restreint. En revanche, à chaque fois que j'ai rencontré des travaux de femmes – je prends l'exemple du début du XXe siècle, où elles ont été nombreuses dans les avant-gardes —, j'ai indiqué leurs noms que ce soit Käthe Kollwitz, Grete Stern, particulièrement méconnue, ou Sophie Taeuber-Arp (à part les femmes artistes ayant à la fois une place dans l’histoire de l’art et un rôle dans le graphisme, je n’avais jamais entendu parler des noms que je découvrais les uns après les autres). Une des toutes dernières choses que j'ai faite pour la remise du dernier chapitre de mon livre, c’est une note sur la question des femmes, de leur absence, pour fournir une ébauche de bibliographie recensant des textes faisant place aux femmes. C'est la note la plus longue de mon livre, qui m’a demandé énormément de travail. Le simple fait d'avoir entrepris ce travail d’histoire générale en étant une femme, pour moi c'était déjà le début de ce sujet, je touchais à quelque chose qui n'était pas évident. Lorsqu’on me questionnait sur ma thèse, j’ai aussi eu quelques remarques, très peu, comme celle d’un directeur d’une école d’art me disant : « C'est très ambitieux », sous-entendu pour une femme (un homme n’aurait probablement pas reçu cette remarque sur le même ton). J'ai fait ce travail parce que j'ai compris, durant mes études, qu’il y avait en France une trop faible culture historique dans le champ du graphisme et de la typographie, la typographie m’ayant alors semblé être plus encore un micro-milieu masculin, en comparaison du graphisme.
Tu as senti une évolution dans le temps dans les équilibres hommes/femmes dans le secteur DG ?
Oui, j'ai vu par exemple récemment un changement du côté des élèves. J'ai été impressionnée par l'attitude et les propos des étudiants et des étudiantes, surtout des filles. Elles ont des exigences et des questionnements nouveaux. Cela se voit dans leurs sujets de mémoires, dans les cours qu'elles choisissent. Aussi dans le fait que certaines choisissent des cours assurés par des femmes, et qu’elles expriment ouvertement ces choix, ce qui était du jamais vu. Mais je suis aussi étonnée par un désemparement fortement exprimé par certaines étudiantes, ce qui est un phénomène assez récent. Sur le volet positif, je suis surprise par les étudiantes et étudiants de ce secteur, leur énergie, la transformation de leurs comportements. Je suis en certains cas aussi surprise par leur maturité et la façon dont ils investissent des sujets qui les intéressent et dont ils s’y impliquent car cela fait sens pour eux. Je trouve que les étudiantes donnent beaucoup de signes d’une émancipation tout à fait nouvelle. Le secteur a connu l’an passé un soulèvement actif et impressionnant de ses étudiants et étudiantes de différentes années. Leurs expressions de contestation témoignent, entre autres, d'une volonté et d'une exigence de transformer un monde dont ils ne reconnaissent plus ni les pouvoirs genrés ni une telle distribution des rôles. Alors que ces pouvoirs sont par endroits restés la norme.
Et chez les enseignantes dans et hors du secteur ?
Depuis le courant des années 2000, il y a de plus en plus de femmes dans le corps enseignant de l’École. Au début j'étais très souvent seule avec des hommes, par exemple dans le CER [Conseil des Études et de la Recherche] ou les réunions, il y a longtemps – la directrice adjointe de l'époque me disait « Quand vous n'êtes pas là, je suis la seule femme ». C'était vraiment une autre époque. Dans les réunions en général, c'était « normal » d'être entourée d'hommes. D’ailleurs, j’ai souvenir de certaines réunions, où je me trouvais, et où j’entendais régulièrement « Messieurs » quand l’un d’eux s’adressait à tous. Je me souviens aussi que, dans des discussions informelles où nous étions trois ou quatre, l’un d’eux pouvait nous parler en disant « eh les mecs » ou de petites formules comme ça, que je n’ai plus entendues depuis longtemps.
Je me souviens d’un épisode lié au concours [d’entrée en 1ereannée], quand tu as été rapporteure ?
Depuis le courant des années 2000, il y a de plus en plus de femmes dans le corps enseignant de l’École. Sur le concours, quand on m'a demandé d'être rapporteure, j'ai demandé les rapports des dix dernières années pour pouvoir les étudier. J'ai parcouru tous les rapports, et l’une des premières choses dont je me suis rendu compte, c'est que c'était pratiquement toujours la femme qui était rapporteure.
C’est-à-dire : c’est elle qui écrit le rapport.
Tu as toujours un binôme, un vice-président et un rapporteur. Sur toute la période que j’ai étudiée, il y a un seul binôme où une femme a été vice-présidente, c’était Vonnik [Hertig – enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016]. On comprend bien qu'on est préposées à l'écriture, à faire le gros du travail (je dis ça indépendamment du fait que cela m’a beaucoup intéressée de faire ce rapport). Il y a eu des rapporteures qui ont été aidées par les vice-présidents hommes, il y en a pour lesquelles ça n'a pas été le cas. Quand je me suis rendu compte de cette distribution des rôles quasi systématique, je me suis dit : « Qu'est-ce que je fais avec ça ? ». J'ai choisi, plutôt que de le mettre dans le rapport, d’en faire état dans les dernières réunions de commission concours que l'on a eues. La dernière réunion s’est déroulée dans le bureau du directeur des études. J’ai dit que j’avais un sujet à soulever. J’ai fait état du fait qu’une seule femme avait été vice-présidente sur la décennie en cours, en pensant que ça allait débloquer la situation. Quelque temps après, on a eu une réunion de préparation aux instances, on attendait encore des personnes, on m’a annoncé : « ça y est, on a fait le prochain binôme du concours, vous allez être contente. » J'y croyais, puis je m’entends dire : « On a pris deux hommes ». Je suis tombée des nues : je pensais que c'était une provocation, mais ça n’était pas une plaisanterie. Il m’a fallu du temps pour comprendre, grâce à des collègues, que ce choix semblait vraiment avoir été considéré comme une réponse au problème que j’avais soulevé : c’est un problème qu’une femme soit rapporteure ? Pour solutionner cela, il suffit de mettre un homme à cette fonction… À ma connaissance, il y a eu seulement une personne, un homme, qui a ensuite été parler au directeur à ce sujet. C'est un enseignant, Denis [Pérus]. Ça a fini par être entendu, deux ans après. Le jour où il pourra y avoir un binôme de femmes, et même où on ne se préoccupera plus de cela… On continue la lutte, mais cet épisode a été désespérant.
Est-ce que des petites phrases sexistes tu en as entendues dans l'École ?
Oui, mais j'ai envie de dire que dans la vie il y en a tout le temps. Beaucoup moins qu'avant. Et le problème d'avant, c'est que c'était « normal. » Le contexte n'était pas du tout le même. Je trouve aussi que les hommes de l’École ont beaucoup changé à notre égard, je les trouve pour la plupart très respectueux.
Tu as dit une phrase dans un mail écrit à Lucile qui nous a beaucoup marquées « Le sujet commence dans la parole qui n'a pas lieu ». [fig.10] Lors d'une réunion, sur des sujets où j'aurais pu m'attendre à ce que tu t'exprimes, tu ne disais rien. Je voyais que tu ne pouvais pas t’exprimer.
Pour situer le contexte, j’ai écrit cette phrase dans un commentaire sur la question de la parole dans votre projet. Tu as raison, je me suis parfois trouvée dans des situations telle celle qui n’a pas échappé à ton attention. Mais il m’arrive aussi, sciemment, de ne pas m’exprimer, par exemple lorsque j’estime que la situation n’est pas fluide (ce qui est rare, mais qui peut arriver), ou que les propos que j’entends sont trop artificiels. Le silence parle aussi, ça a du sens, en tous cas pour moi.
On sent qu'il y a une relation qui s'est tissée entre vous deux. Au sein de DG, sens-tu que tu apportes quelque chose de spécifique aux étudiantes – et elles, comment te regardent-elles, par rapport aux hommes ?
On a eu une étudiante Erasmus l'année dernière, par exemple, qui m'a écrit un long mail pour me remercier de lui avoir fait découvrir qu'on pouvait poser des questions environnementales à travers le graphisme, que ma pédagogie avait changé sa vision et allait beaucoup influencer sa carrière professionnelle. C’est un fait qu’Alexandra [Piat] fait partie des premières étudiantes (hormis de très rares cas antérieurs) qui est venue vers moi avec un faisceau d’interrogations que je ne pouvais qu’entendre et comprendre, lui ayant alors indiqué le canal des élèves élus pour relayer en instance leur parole étudiante. Je crois que c'est depuis que j’ai eu la classe d'Alexandra que les étudiantes n'ont plus le même regard sur nous, de façon très nette, c’est-à-dire depuis trois ou quatre ans. Avant elles allaient plutôt vers le modèle dominant masculin, vers les hommes. De la même manière, je peux prendre l’exemple d’un garçon, qui consulte un de mes collègues homme et moi, et qui vient finalement vers moi pour son mémoire. C'est du jamais vu pour moi (non pas de diriger le mémoire d’un garçon qui vient spontanément vers moi, mais de savoir par eux qu’ils le font après avoir effectué un choix). Un garçon qui fait son choix en fonction de ce qu'il entend sur du contenu, et qui ne juge pas par rapport à la question du genre.
Et hors de DG, dans l'École, en tant que femme as-tu senti qu'on te mettait dans des cases, par exemple en 1ere année ? Ou dans d'autres secteurs ?
J'ai plutôt un bon souvenir de la 1ereannée. J’y ai beaucoup travaillé avec Laurent Ungerer [enseignant], qui a ce côté très chaleureux, très accueillant, très positif. Mais ça remonte maintenant. Le Design textile, c'est le paradis sur terre. C'est comme la bibliothèque, ce sont des îlots un peu de bonheur – à la bibliothèque toutes ces chaises colorées, à l'atelier de tissage cet espace avec toutes ces bobines colorées qui tapissent les murs : ce sont des lieux magiques, très beaux [fig.11]. En Design textile, j'ai toujours été très bien accueillie, et respectée par les enseignants, les coordonnateurs, et toute l’équipe.
Est-ce qu'intervenir en Textile, c'était dévalorisé ?
Oui. L'histoire du « secteur chiffon »…, j'ai entendu cette expression dans des jurys. Elle provenait d’un corps enseignant masculin âgé. J’ai beaucoup aimé enseigner dans ce secteur, comme en 1ereannée, donc ça ne m’a pas dérangé. Mais on peut tout de même s’interroger sur le fait que c’est à moi que sont revenus ces cours, de longue date, plutôt qu’à un collègue masculin, sachant qu’il y a par endroits une espèce de « cote » des cours (secteurs, mais aussi années), qui n’est pas vraiment formulée publiquement mais qui est bien présente.
Durant tes études tu as été étudiante à l'Ensad. As-tu des souvenirs comme femme ?
C'était dans les années 90. Le secteur DG, qui était alors nommé « communication visuelle », était encore un joyau de l’École… J’en garde un excellent souvenir. L’ambiance était très vivante, très créative et chaleureuse. On était tout le temps occupés par la création et l’expérimentation. Je crois qu’on ne parlait jamais des questions de genre, du moins je ne m’en souviens pas… Margo Rouard [enseignante de 1978 à 2008]enseignait dans le secteur. Je n'ai été à l’école que durant deux ans et demi, après l’école Estienne, et avant l’Atelier National de Création Typographique pour me former au dessin de caractères et qui a été une expérience exceptionnelle.

Orsina Visconti
ancienne étudiante
et enseignante
depuis 1998
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 30.11.20

- Épanouissement
- Accueil
- Vacataire
- Déséquilibres
- Mandarinat
- Invisibilisation
- Hommage
- Sexisme
- Racisme
- Intersectionnalité
- Relation aux étudiantes
- Enfants
- Silence et parole
- Aura masculine
Entretien de
Orsina Visconti
ancienne étudiante, enseignante depuis 1998
le 30.11.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Lucile Encrevé
Depuis combien de temps travailles-tu à l’École ?
Je suis là depuis vraiment très très longtemps, puisque je suis entrée comme enseignante en 1998. Et je suis une ancienne étudiante des Arts Déco, je fais partie de ce système ancien qui consistait à avoir une situation de huis-clos familial, où les anciens élèves étaient rappelés au bout d’un moment par leurs profs pour enseigner. L’École a été une constante dans toute ma vie en France. Quand je suis entrée comme étudiante, j’étais en France depuis deux, trois ans, après j’ai commencé à travailler à l’extérieur mais avec une particularité : à la fin de mes études, j’ai commencé une histoire de couple avec un prof de Sciences-Humaines en scéno, donc toutes les années où je n’ai pas étudié ou enseigné, j’étais très proche des Arts Déco par lui, comme il continuait d’enseigner – certains enseignants maintenant ont été soit étudiants avec moi soit les siens… Après, j’ai été appelée par mes profs en secteur Textile pour enseigner, en 1998.
Tu étais étudiante pendant quelles années ?
Je suis sortie officiellement en 1987. L’École, à l’époque, c’était quatre ans : il y avait deux ans de tronc commun et deux ans de spécialité, c’était plus libre. La 1ereannée était un peu contraignante, scolaire, c’était un peu le redoublement des années de prépa, la 2e année était fabuleuse, complètement libre, tu prenais à la carte tout ce que tu voulais, tu t’en donnais à cœur joie. Et après on postulait à un secteur. Je suis allée en Textile. Aujourd’hui, je suis très touchée par la solitude des étudiants aux Arts Déco, je suis bien placée pour l’avoir vécue en tant qu’étudiante, je trouve que ça, c’est une chose qui ne change pas. Le regard des autres était très dur – tu te sens jugée tout le temps, sur tes capacités artistiques, sur tes capacités intellectuelles, sur tes capacités à répondre. C’est très difficile de faire communauté, de faire groupe, ce n’est pas très évident dans cette école. Beaucoup d’étudiants n’osent pas dire qu’ils sont fragiles, n’osent pas aller vers les autres pour de l’aide. Je vois les Erasmus tous seuls, je suis très sensible aux étudiants étrangers. On pourrait vraiment mieux faire. Il faudrait des lieux où on puisse plus échanger, avoir des moments de convivialité, j’aimerais ça.
Comme enseignante, tu es entrée dans le secteur en retrouvant la même équipe ?
Oui, et là ça a été très très difficile pour moi, j’étais dans l’équipe de mes enseignants, le directeur du secteur était un homme avec qui j’avais eu beaucoup de problèmes en tant qu’étudiante. En arrivant, je me sentais la petite jeune qui devait prouver que maintenant elle était prof.
Tu étais vacataire ?
Oui, mais vacataire pour moi ce n’était pas une histoire d’homme ou de femme, il y avait des hommes vacataires.
Le coordinateur, dans ce secteur très féminin, c’était donc un homme ?
Pour moi, c’était assez aberrant. Tout le secteur était féminin, sauf lui, et un autre homme, qui était un copain à lui. Il y avait ce paradoxe d’avoir un homme qui gère tout, comme à l’époque on gérait les sections (c’est-à-dire « bon dieu le père » qui décide de tout), et toutes les femmes sous lui, c’était complètement paradoxal. C’était quelqu’un d’hyper dévoué à l’École, qui faisait des cent et des mille. Mais il était assez dur avec lui-même, avec tout le monde. Il régnait sur un groupe complètement féminin, à une exception près. Les grands pontes, les grands directeurs des secteurs, ont toujours été des hommes, ça a beaucoup changé avec toi et Francesca [Cozzolino – enseignante depuis 2013] à la direction de HTC [Histoire Théorie Critique] – je me rappelle très bien du déconcertement quand vous avez annoncé ça, c’était une grande révolution, jusque-là c’était toujours des hommes.
Et après lui, ça a été qui ?
C’est le comble, ça a été l’autre homme du secteur qui a repris, sans en avoir grand goût. Il était très sympa, extraverti, drôle. Il y avait Nathalie [Brès - enseignante de 1985 à 2010] qui était la prof de tissage qu’on avait toutes poussée à prendre la direction mais elle a toujours refusé. La coordination était écrasante, elle ne voulait pas – elle faisait son job à côté, du tissage à la main, elle était très créative, elle travaillait pour la Comédie Française, pour Dominique Picquier. Madame « chiffon », tout le monde l’adorait. [fig.12] Elle a enseigné vingt-cinq ans je crois dans l’École, mais elle n’a eu aucune reconnaissance officielle… alors qu’elle a énormément donné à l’École. C’est quelqu’un qui n’apparaît pas dans l’histoire des Arts Déco, jamais. C’était une vraie femme forte, passionnelle, un peu brusque, elle te boostait dans le fait de prendre ta place, prendre des initiatives, elle encourageait les filles à prendre des positions, elle te légitimait dans le fait d’être fière d’être là. Elle a beaucoup contribué à l’affirmation féminine.
Avant, le tissage à l’École, c’était des petits échantillons. Et elle a dit : « Il faut tisser en grand » – au lieu d’avoir un échantillon de 10x10, invisible, on avait un tissu de 2m par un 1m40. On allait tisser chez elle sur des grands métiers, il n’y en avait pas aux Arts Déco, et ça a donné une légitimité et une visibilité énorme à notre métier, ça a changé tout – pour mon diplôme, j’avais quatre, cinq tissus de 2m de haut, qui existaient. Avant elle, c’était Geneviève Dupeux [enseignante de 1975 à 1985], je l’ai connue très brièvement, en 3eannée, sur un semestre. C’était aussi une femme très forte, très impressionnante, elle avait un bureau de style. Nathalie, à qui elle était en train de passer la main, était une très jeune prof et on s’est retrouvées, au début de l’année, avec elles deux, toutes les deux habillées en noir, on avait l’impression de deux sorcières puissantes.
Et comme enseignante, vous poussez toujours les étudiantes vers cette dynamique-là : faire en grand ?
Oui, je continue de le faire. Si tu restes avec des échantillons, tu restes dans les coulisses. Il faut une visibilité, ce n’est pas pour rien que le métier Jacquard, qui est là depuis quatre ans, est en train d’ouvrir le tissage aussi à d’autres secteurs, parce que c’est grand, c’est visible. La taille, l’affirmation, ça reste important.
A ce moment-là, tu étais toujours vacataire ?
Oui, je faisais des cours un peu à l’écart, j’enseignais le vendredi, je ne voyais jamais les autres profs. Ensuite on est repartis sur des meilleures bases, Vonnik [Hertig – enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016] a été à l’écoute, elle m’a tendu la main – j’ai fait un cours avec elle, on a croisé nos deux cours, sur les mélanges optiques de la couleur, par le fil. Après ça, ça a été beaucoup mieux.
Quand la coordination a été assurée par Isabelle Guédon [enseignante de 2001 à 2012], tu as senti un changement ?
Oui, Isabelle a donné un vent de renouveau, parce qu’elle était jeune, qu’elle était femme. Elle était très dirigiste, elle organisait vite. C’était plus contemporain, c’était infiniment plus efficace sa gestion. Après, on a eu Roland [Schär]et c’est là que ça a vraiment changé dans la collégialité de la gestion : pour moi, l’écoute de la parole de tout le monde a vraiment changé à ce moment-là, il écoutait beaucoup plus. Je me suis sentie quand même beaucoup plus à l’aise dans le groupe avec la gestion de Roland, qui laissait de l’espace de parole à chacun.
Tu as senti une évolution dans l’écoute, est-ce que tu as senti une évolution dans la façon dont le secteur était perçu ?
Je pense que maintenant on a une image plus positive, mais en même temps on est considéré comme gentils, bons, inoffensifs, on revendique peu, il n’y a personne avec un grand ego, on est un secteur qui fonctionne bien, mais quand il s’agit de mettre en avant l’École, ils ne savent pas très bien où nous mettre. C’était pire avant. Il y avait moins d’attention aux aspects que j’appellerais humains, attentions aux minorités, aux femmes, au social, au monde en général, à l’écologie, ou encore au collectif, que DTM [Design textile et matière] peut incarner.
Il y avait d’autres figures de femmes comme Nathalie Brès en Textile ?
Il y avait Béatrice Saalburg [enseignante de 1969 à 1998] qui avait une histoire personnelle assez fascinante (on disait que les petites filles, les modèles de Balthus c’était elle et ses sœurs), beaucoup de culture, elle était très bienveillante, on sentait une aisance. C’était la grande dame, mais ce n’est pas quelqu’un qui s’affirmait, c’était quelqu’un qui existait, qui dégageait une aura.
Vous étiez où dans l’École ?
Quand j’étais étudiante en tissage, la salle était dans le bâtiment côté Érasme au dernier étage, sous verrière. C’était assez confortable, ça allait. À côté, il y avait Mobilier, c’était essentiellement des hommes, ils se moquaient de nous, on était « les petites tisserandes » mais on était copains. Après, l’atelier est passé au 2e étage, toujours côté Érasme, une toute petite salle, c’était assez infernal, je faisais cours en hurlant. C’était l’époque où la moitié de l’École a été à la manufacture des Œillets à Ivry. Après l’atelier a été dans le local actuel [fig.13], beaucoup plus grand, il s’est constitué d’un coup et n’a jamais bougé, c’est resté la même structure.
Il y avait des petites phrases comme les « petites tisserandes » ?
Les dames « chiffon », ça a toujours été dit, on a toujours été considérées comme les dames « chiffons ». Mais moi, aux Arts Déco, je n’ai jamais été attaquée en tant que femme. C’était plus difficile comme étant la petite italienne, c’était un mixte – c’était pas mal dans l’air, c’était un racisme bienveillant ( « Oh, j’adore ton accent », « Ah, Venise ! » ), qui te miniaturise.
Vous l’avez retrouvé ce ressenti avec des étudiantes racisées ?
Ma plus grande tristesse, c’est de voir que si tu viens d’un milieu défavorisé socialement, associé à une origine étrangère, tu n’y arrives pas. On a eu très peu d’élèves avec la peau foncée, ils ont eu beaucoup de difficultés. Je me rappelle d’une étudiante, c’était d’une tristesse l’histoire de cette fille, mais terrible, venant d’un milieu très défavorisé, sans avoir des dons tels qu’ils la soutiennent à travers tout, avec des conditions matérielles sinistres et vivotant dans le secteur – elle a eu son diplôme à peine et elle n’en a rien fait. C’est une chose qui me trouble. Comment c’est possible qu’une grande école n’arrive pas à t’aider à surmonter tout ça ? Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Ces étudiantes, elles vivent des micro agressions – comme quand les gens n’arrivent pas à prononcer leur nom.
Ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler, de même qu’on doit faire un travail sur soi quand un étudiant qui change de sexe t’annonce que maintenant c’est « elle » et tu as vachement de mal de passer de « il » à « elle », tu fais un effort pour y parvenir. Si tu considères que c’est important, tu fais un effort : et c’est important, donc tu fais un effort.
Et les petites phrases, il y en a eu dans les jurys, envers les étudiantes ou envers toi ?
Dans les jurys de concours [d’entrée à l’École], il y a cette parole savante, sans fin, de ces grands mecs qui parlent, qui parlent, qui parlent et en imposent, qui vient comme un rouleau compresseur et te laisse peu de place, même avec des hommes que je trouve très sympas par ailleurs. C’est le moment où je me sens le plus écrasée en tant que femme. Il y a une appropriation masculine de la parole, je l’ai encore ressentie cette année en tant que vice-présidente, peut-être dans une moindre proportion (il y a aussi des hommes plus attentifs, plus réglos). Jamais je n’ai vu une femme monopoliser la parole à ce point. C’est écrasant en tant que femme. Des moments, dans les jurys, je me sentais un peu « décorative », je sentais qu’ils étaient très contents d’avoir une femme qui accepte son rôle de poser la question gentille, des moments condescendants. Mais, dans le courant du jury, j’arrivais à redresser la situation, il fallait imposer le respect, ajuster le tir, que tu voulais bien être la gentille de la situation mais que tu n’étais pas dupe, que tu n’étais pas une potiche… Après, ça se passait très bien… Quand il y a une autre femme, souvent c’est différent, deux femmes et un homme, c’est très différent – quand deux femmes sont en phase dans un jury, je trouve que ça prend une autre tournure. Cette parole savante, c’est écrasant pour les membres du jury à côté et surtout pour l’étudiant. Moi je suis partisane de laisser dans les entretiens l’étudiant mener son raisonnement les dix premières minutes, tu te tais, tu le laisses s’exprimer.
Est-ce que ça se produit plus quand c’est des étudiantes que quand c’est des étudiants ?
Quand il se passe ce genre de phénomène, c’est très difficile pour le candidat, tu as ceux qui tiennent bon (et ils peuvent se faire écraser), ceux qui se braquent et ceux qui perdent leurs moyens – c’est souvent des filles mais il y a des garçons aussi… plus de filles peut-être.
Est-ce que tu as l’impression que comme femmes les étudiantes attendent quelque chose de toi qui soit spécifique ?
Oui, oui, absolument, mais j’essaie de faire attention à mon excès de maternage. Plus tu t’éloignes en âge de tes étudiants, plus ils ont l’âge de tes enfants. Dans ta tête, tu fais un amalgame, tu as envie de les porter, de les aider, d’être bienveillant. C’est lié au fait d’être mère, d’être femme. Mais honnêtement quand je vois quelqu’un comme Roland, qui est un homme, qui n’a pas d’enfant, je vois la même qualité d’écoute.
Et les étudiantes, elles t’écoutent autant que Roland ?
Elles ont tendance à plus écouter Roland, à aller plus vers lui, quand il s’agit d’aller chercher un apport culturel ou professionnel. Est-ce que c’est parce que c’est un homme, ça je ne sais pas. Le problème aussi c’est d’être perçue comme un exécutant plus que comme un créateur. Être prof de tissage, c’est vraiment enseigner quelque chose de matériel, de très technique, même s’il y a une dimension culturelle. Sur mes heures, j’ai le choix entre transmettre de la technicité ou tout un substrat culturel, c’est un dilemme…
Dans mon secteur, on s’est plaintes du manque d’apport technique, on ne l’avait pas parce que pour les hommes ce n’est pas valorisant de nous l’apprendre.
Tu ne peux pas faire de la conversation dans une langue que tu ne connais pas. J’ai décidé que je veux transmettre quelque chose de concret, que les gens puissent se l’approprier. Je veux donner des outils aux gens qui sortent de l’école, c’est mon rôle.
Pour revenir au maternage, tes enfants tu les as eus quand tu enseignais déjà à l’École ?
J’ai eu une fratrie mixte, deux garçons et une fille. Le premier, je n’étais pas à l’École, le deuxième, on m’a demandé d’enseigner à l’automne 1998 et mon fils est né le 3 octobre 1998 donc j’ai commencé en janvier avec un enfant qui avait trois mois. La troisième, j’ai eu un congé de six mois, à l’époque j’étais vacataire, on a réaménagé l’emploi du temps sans trop de tracas, on va dire. Combien de fois mes enfants étaient aux Arts Déco en Vêtement en train de coudre pendant que moi je faisais cours, c’était vraiment important, c’était très sympa, ça ne dérangeait personne. Mes enfants ont des souvenirs très beaux, ils allaient tisser dans l’atelier tissage, ils allaient coudre dans l’atelier vêtement, ils voyaient leur mère faire autre chose que « la mère ». Tu arrivais à la crèche, on te disait : « elle est fermée », tu prenais ton enfant et tu l’emmenais à l’École, il y avait toujours quelqu’un, il y avait une porosité des populations. C’était moins codifié, plus libre. La première fois où ça a posé problème, c’était quand il y avait une personne très dure à la direction technique : j’étais à l’accueil avec mon fils, elle m’a fait un scandale épouvantable – c’était un changement d’époque.
Pour finir, tu peux nous parler de ton expérience au CA [Conseil d’Administration] ?
J’ai été six ans au CA comme suppléante de Christophe Naux puis d’Annabel Vergne [enseignante depuis 2006], je trouve ça assez éprouvant comme expérience. Les premiers trois ans, on se demandait quel était notre rôle. Après, Simon Garcia [ancien directeur des services, qui a co-rédigé la Charte égalité des genres] est arrivé, ça a été un grand moment, il nous a proposé un entretien, où il nous expliquait ce qu’on allait voir comme papiers, il nous a fait de vrais cours, ça a été un vrai changement. Mais je n’ai plus envie d’être au CA, on a trop peu de marge de manœuvre… tu entérines des décisions, c’est un lieu très politique.

Merveille Ngeyitadila
étudiante
depuis 2017
avec
Alexandra Piat
le 11.12.20

- Classes sociales
- Travail étudiant
- Racisme
- Sexisme
- Résister
- Intersectionnalité
- Soutien
- Représentation
Entretien de
Merveille Ngeyitadila
étudiante depuis 2017
le 11.12.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Merveille, je suis une femme noire, cis [cisgenre, dont l’identité de genre correspond au genre qu’on lui a assigné à la naissance]. Je suis française et mes parents sont d’origine congolaise. Je suis rentrée aux Arts Déco en 2017 en deuxième année. Avant ça j’avais fait deux ans en BTS en Design de mode à Duperré et j’ai rejoint la section Vêtement des Arts Déco en deuxième année. J’y suis rentrée parce que je voulais vraiment explorer mon univers créatif et je pensais que c’était un endroit qui me donnerait assez de temps pour pouvoir le faire. Là je suis en cinquième année.
Est-ce que spontanément, avant que je te pose des questions, tu as des choses à dire sur ton parcours aux Arts Décoratifs sur ton vécu en tant que femme et/ou en tant que femme noire ?
Oui, pour moi c’est une question hyper vaste parce qu’on peut dire plein de choses. Je viens d’abord d’une école de mode et surtout,à la fin de ma dernière année à Duperré, pendant mon projet de diplôme, mon travail s’est vraiment tourné vers la question des identités. Cette question commençait à ressortir de manière très forte au sein de mes projets et notamment dans ces questions des identités au pluriel, des rapports qu’il peut y avoir entre différents types de personnes dans la société, notamment française, les rapports de domination entre dominants et dominés. Je me demandais quelle était ma place dans la société en tant que personne noire avant même de dire « femme noire ». C’était une question qui revenait vraiment beaucoup et que j’avais envie d’explorer à l’Ensad. Je voulais explorer tous ces types de questions quand je serais à l’Ensad, pour que d’une certaine manière, si jamais il y avait quelque chose à dire d’important ou de militant, je me sente armée, armée dans mes connaissances, mais également dans ma démarche créative. Et pour moi, l’Ensad c’était un peu une terre nouvelle parce qu’une école de mode et une école d’art je trouve que c’est très différent. Je me disais qu’à l’Ensad j’aurais plus de liberté, qu’il y aurait différents types de personnes et différents types d’identités, encore plus que ce qu’il peut y avoir dans la mode. Pour moi, l’arrivée à l’Ensad a été une désillusion parce que je me suis rendu compte que c’était pas plus ouvert que Duperré. Je me suis rendu compte qu’il y avait quand même quelque chose de l’ordre d’une élite. C’était vraiment très « bourge ». Je pensais qu’il allait y avoir plus d’identités, plus de gens qui venaient de là d'où je viens, de banlieue. Juste un peu plus de brassage. Et au contraire le fonctionnement à l’Ensad mettait en avant un type de personnes menant un type de vie assez privilégiée. Je pense notamment à ma vie en tant qu’étudiante. J’ai une situation de vie qui est un peu précaire de temps en temps et qui fait partie pour moi d’une normalité. J’ai plein d’amis, par exemple, qui vivent en banlieue, qui vivent avec leurs parents mais qui partagent le loyer, qui ont un job étudiant à côté en vingt-cinq heures, etc. Et je me suis rendu compte qu’à l’Ensad, en tout cas dans ma filière, avoir un travail à côté et travailler vingt-cinq heures ça n’était pas possible. Alors que moi je me sens privilégiée, j’habite toute seule à Paris, je paie mon propre appartement, ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte que si tu veux vraiment être très concentrée dans ton travail et bien travailler, être studieuse et être à la hauteur des exigences, et bien il fallait que tes parents aient plutôt de l’argent, que tu restes chez toi, que tu n’aies pas de travail à côté. C’est plein de petites choses comme ça. On m’a fait comprendre que le fait que je travaillais beaucoup à côté (je fais quinze heures) était un problème, qu’il fallait que je consacre plus de temps à l’école alors que financièrement ce n’était pas possible pour moi.
Est-ce que tu penses que le fait d’être une femme dans ta section, ça avait un impact particulier, ne serait-ce que dans ta relation soit à tes camarades, soit à tes profs ? En tant que femme et en tant que femme noire.
Alors dans mon secteur on est plutôt à égalité, parfois un peu plus de femmes parfois un peu plus d’hommes. Mon expérience de femme avec les professeurs et entre élèves, s’est quand même plutôt bien passée. Je n’ai jamais vraiment ressenti une forme d’hostilité, de patriarcat ou autre chose qui allait à mon encontre ou qu'on me jugeait moindre ou quelque chose comme ça.
Sauf à un seul moment, qui m’a beaucoup touchée. Un jour, on devait passer devant une sorte de jury avec un commissaire extérieur à l’école. Et à ce moment-là, j’ai été face à quelqu’un qui a eu une manière de se comporter face à moi qui était tellement… comment dire… un peu méprisante. Je travaillais en groupe avec trois autres filles, qui étaient toutes les trois également racisées [qui appartiennent à l’un ou plusieurs des groupes sociaux subissant le racisme]. Et la manière dont il nous avait parlé et dont il se plaçait au-dessus de nous. Non seulement il y avait un problème parce que les propos qu’il pouvait avoir étaient discriminatoires, pas nécessairement racistes, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, qui était vraiment dégradant. Dans sa manière de nous parler, on sentait qu’il se mettait tellement au-dessus de nous. Et c’était tellement différent par rapport aux profs qu’on peut avoir d’habitude en Design vêtement. On nous a rarement traitées comme ça. On avait vraiment l’impression que c’était destiné à moi et mes amies. Trois jeunes femmes racisées. Il y avait vraiment ce côté patriarcal du genre « Ces filles-là, je vais leur enseigner quelque chose ». C’était un moment très dur.
Vous aviez l’impression d’être dévalorisées, diminuées ?
Oui, et ça m’a vraiment touchée. C’était en troisième année, on devait participer à un événement sur le thème de l’immigration dans le cadre d’une exposition. Et je me sentais bien dans l’idée de faire ce projet-là. Je me sentais un peu dans mon élément, parce que je suis une fille d’immigrés. Je me sentais également très connectée à mes amies grâce à cette histoire de filles d’immigrés, de deux générations différentes. Je suis allée sur le lieu de l’exposition et ce que j’ai vu m’a beaucoup touchée, notamment le traitement de l’image qu’il pouvait y avoir des personnes noires et même de l’idée qu’on avait de la colonisation. Je connais l’histoire de la colonisation, de l’esclavage, mais de voir graphiquement comment on hiérarchisait les différents peuples colonisés m'a marquée. On pouvait lire aussi qu’il y avait beaucoup d’artisans, des gens super intelligents en Asie. En philosophie ou en mathématiques, on constatait les choses que les Arabes, les Maghrébins ont apportées à la France. Cependant, quand on voyait ou lisait des informations sur les peuples Noirs, c’était dégradant. À chaque fois, on les voyait tous nus etc. Bref, j’ai décidé de faire mon propre projet qui parlait de ça et d’un vêtement qui était un peu manifeste. Qui parlait de régénération, de guérison par rapport à cette image dégradante des personnes noires de l’Afrique subsaharienne qui m’était beaucoup revenue quand j’étais petite. Cette image m’a beaucoup traumatisée. Donc je parlais de comment on pouvait guérir de ça. Ça prenait la forme d’un manteau en cuir que j’avais gravé un peu comme des scarifications, j’avais utilisé des signes de la tribu de mes parents. Ça symbolisait la guérison.
C’est ce que j’ai présenté à ce monsieur lors de ce jury. Il a très bien compris mon sujet. Sauf qu’il a commencé à me poser certaines questions, notamment par rapport à la monstration de mon vêtement, et qui pouvait porter mon vêtement si jamais il le faisait porter par des personnes. Il m’a demandé si une personne blanche ou asiatique pouvait porter ce vêtement-là. Je lui ai dit « Non parce que ça parle quand même d’une guérison, ça reste quand même adressé aux blessures portées par certaines personnes noires, donc si jamais vous voulez le faire porter par un de vos chanteurs, il faut absolument qu’il soit noir ». C’est là que ça a mal tourné parce qu’il a commencé à dire que c’était peu moderne, que par exemple dans la haute couture, il y avait plein de gens qui avaient par exemple utilisé du wax, comme Stella McCartney, et qui utilisaient des personnes blanches pour le porter. Que les personnes blanches pouvaient aussi se sentir touchées par ça parce qu’on est tous le mélange de quelque chose. Qu’il y a des gens qui sont parisiens et bretons et que quelqu’un pourrait faire un projet sur la re-connexion à ses racines bretonnes. Donc, à ce moment-là j’insiste, je lui dis que c’est important par rapport à mon histoire et que ce n’est pas la même chose. On parle pas simplement de se reconnecter à ce qu’on a perdu de vue, mais on parle d’une identité qui a été déformée. Là, il me dit qu’il faut que je me détache de mon projet, parce qu’en vérité, qui va réellement comprendre ? Il me dit « Quand les gens viennent ils ne comprennent que 30-50% de ce qu’ils voient », mais que ma cible, donc les personnes noires, « si jamais ils viennent… Est-ce-que t’es vraiment sûr qu’ils vont comprendre au moins un petit peu ? »… Il sous-entendait le désintérêt des personnes racisées par rapport à l’art et surtout, une certaine, incapacité à comprendre l’art. Donc j’ai insisté, j’ai dit « Je ferai en sorte qu’on comprenne les signes. Je mettrai des pancartes pour expliquer ce que cela signifie, mais je ne diminuerai pas la portée de mon projet ». Et il me répond « Tu sais après ton truc, la couleur c’est un peu marron, tu as utilisé des anneaux, on dirait presque des chaînes. Ça fait un peu trop ethnique et ça fait trop référence à l’esclavage. Nous on veut pas trop d’un truc comme ça, d’un truc lourd ». Au final, il finit par me dire que je suis trop proche de mon propos, trop attachée émotionnellement. Il avait besoin de me dire que j’étais trop sensible et surtout, il me répétait « Vraiment tu es très naïve. » Et c’est ça qui m’a beaucoup énervée. Il me disait « Tu te rends pas compte de ce que les gens vont comprendre ou ne pas comprendre. Tu ne sais pas ce que c’est, tu ne sais pas. ». Et à chaque fois, il me coupait. C’était comme si je devais me battre contre lui. Je voyais l’inaction de mes professeures, mais je voyais aussi qu’il coupait mes professeures, qui étaient également des femmes. Je voyais comment il s’érigeait comme quelqu’un qui était omniscient : il pouvait me parler mieux que moi de ma propre communauté. Il savait mieux que moi qui irait voir ça. Il savait mieux que moi que c’était bien ou pas bien de mettre des personnes noires etc., il savait tout mieux que moi. Et puis le pouvoir que cet homme avait. J’ai senti que mes professeures ne voulaient pas trop parler car c’était un commissaire.
Il n’y a vraiment rien qui va dans cette histoire, c’est choquant. Je trouve ça horrible que tu aies eu à vivre une « conversation » pareille !
Et c’était devant toute la classe et même mes profs, arrivé à un moment elles ne disaient plus rien. Moi je me suis battue jusqu’au bout. On a pris vingt minutes alors que c’était cinq à dix minutes par personne. Et il a fait presque la même chose aux deux autres personnes qui étaient après moi, une de mes amies qui est métisse et une autre qui est arabe. Il a bien insisté pour nous dire qu’on était des femmes naïves, etc. Mais après, pour le reste de la classe, qui était principalement des hommes, et des personnes blanches ça a été. Je me suis juste sentie comme si je m’étais battue pendant vingt minutes. Je suis sortie de la classe, il y a une de mes amies qui était là, mais qui ne faisait pas partie de mon projet, elle me dit « Merveille tu t’es bien battue, moi je suis fière de toi ! » Et à ce moment-là, je n’avais pas encore compris ce qui c’était passé. Et c’est après quand on mangeait, une de mes potes arrêtait pas de ressasser et elle mettait en avant tout ce qu’il avait dit. Je ne m’étais pas rendu compte de tout. Quand je suis remontée à l’étage, j’ai vu ma prof et en fait, j’ai fondu en larmes. J’ai jamais pleuré à l’Ensad pour un projet mais ce jour-là, c’était vraiment dur. Mes profs étaient super gentilles, elles sont venues me consoler. Ça les a touchées que je craque. Et puis quand tu vis quelque chose qui te touche dans ton identité féminine et dans ton identité raciale… J’étais comme rincée, pendant une semaine je n’étais pas bien. Pendant une semaine, j’étais vraiment vidée de toutes mes forces et elles l’ont senti. Au final, elles ont fini par lui en parler et j’ai reçu un mail de sa part où il s’excusait. C’est déjà ça.
Et je pense que tu vois, moi je fais souvent de l’homme en vêtements, et je suis beaucoup axée sur la question des noirs en général en fait, pas de la femme. Et là ça m’a bien rappelé ma place de femme, que je suis une femme naïve, une femme sensible, que je suis trop sensible pour l’art. Je me suis rendu compte que déjà être une personne noire ce n’est pas facile, mais que je suis aussi une femme. Encore une raison de plus de me dominer.
Est-ce que par la suite ça t’a démoralisée, au point que t’as pas trop eu envie de ré-aborder des questions similaires ? Ou au contraire, d’en faire plus ?
C’est clair que ça m’a démoralisée pendant un moment, mais quand même je me suis dit qu’à un certain moment il faudrait trouver un moyen de nous donner une plateforme à nous. Pas simplement les personnes racisées, mais tous ceux qui font partie d’une minorité. Parce que les personnes qui font partie de la classe dominante et qui ont le pouvoir, et l’accès aux institutions dominantes, qui ont une certaine visibilité et bien, ils ne nous donneront une visibilité que quand ils le voudront et comme ils le voudront. Donc je me suis dit que j’espérais plus tard avoir la possibilité de créer une plateforme ou quelque chose comme ça.
Est-ce qu’à l’école tu as le sentiment d’avoir pu parler de ces questions avec certaines personnes ? Tu as des amies racisées dans ta classe, qui sont des femmes aussi mais dans l’école en général est-ce que tu as l’impression qu’il y a un peu de soutien entre les femmes en général et aussi entre les femmes racisées ?
Oui, vraiment. Il y a quelques semaines on a fait un groupe avec certaines femmes racisées pour pouvoir parler entre nous de nos projets, notamment de cinquième année et pouvoir débattre de certaines choses qui nous concernent. Donc, oui, oui il y a de la sororité. Ne serait-ce qu’entre femmes, mais surtout au moment du mémoire, j’ai vraiment été suivie par deux merveilleuses personnes : Marlène Van de Casteele et Guénolée Milleret [enseignantes]. Et mine de rien, surtout avec Guénolée, j’ai vraiment pu exprimer quelles étaient mes préoccupations en tant que personne noire, mais également en tant que femme. Même si je ne l’ai pas abordé dans mon mémoire, ça m’a vraiment fait du bien de pouvoir lui parler à elle, surtout que c’est quelqu’un d’autorité dans l’école, c’est une enseignante. De pouvoir lui dire qu’en tant que personne noire c’est difficile d’arriver à l’école et de devoir présenter des projets à des gens qui n’auront jamais ton expérience de vie. Et en tant que femme, c’est peut-être un souci que j’ai avec moi, mais je prends beaucoup de distance, je suis quelqu’un de très réservé et c’est difficile pour moi de parler de la femme. De mes problèmes surtout de femme noire. Parler des hommes noirs, ça va. Ça me touche. Ça me touche énormément, mais parler de la femme, c’est ultra difficile parce que je parle de moi et je parle de mes souffrances de tous les jours. Et le fait que, quand j’en ai parlé à Guénolée, elle a su entendre ces choses-là, elle a su entendre même les choses les plus subtiles, notamment par rapport au colorisme. Ça m’a touchée parce que parfois, il y en a qui sont complètement hermétiques à ça.
C’est génial que tu aies pu trouver des enseignantes de l’école qui puissent t’écouter sans remettre en question ton vécu ou ton ressenti.
Oui et mine de rien le mémoire, c’est aussi un bon moment pour ça. Après, tout dépend des gens que tu trouves en tant que directeur ou qui t’aident. Mais c’est un moment où tu peux te livrer à l’école et ça permet aussi aux profs d’en apprendre plus sur nous, nos réalités et de changer de regard sur nous. Marlène et Guénolée me disaient tout le temps les mêmes choses, qu’elles apprenaient les mêmes choses quand elles me lisaient ou des choses comme ça. Et je me suis dis que c’était bien, que pour ceux d’après, elles seraient plus aguerries sur certaines questions.
C’était sur quoi ton mémoire ?
Alors mon mémoire, il s’appelle Entre intégration et distinction. La réinvention du corps noir du XXe siècle à nos jours [dirigé par Guénolée Milleret, 2020], c’est un livre iconographique qui s’articulait autour de la question des représentations des personnes noires en Occident. La première partie tourne beaucoup autour de cette question de ce qu’est l’image des personnes noires en France, en Occident, hommes comme femmes. Et ensuite, mes deux dernières parties parlaient vraiment de comment, après la colonisation et l’esclavage, les personnes noires en Occident se sont réappropriées leur corps, réappropriées leur image dans les médias, notamment à travers le vêtement. J’ai traité cette question, surtout chez l’homme, comment le vêtement a eu un rôle social, qui cherchait à intégrer, mais également à distinguer une personne au sein d’une société.
Est-ce que dans l’école en général, tu t’es sentie libre d’aller partout ou de travailler partout ? Dans les lieux, les ateliers, les cours, etc.
Oui, après j’ai quand même remarqué qu’il y a ce truc bizarre et que tout le monde dit à l’école, où pour les femmes c’est plus facile de travailler avec des techniciens hommes que des techniciennes femmes, vice versa.
Est-ce que la raison de cette facilité de travailler avec des hommes, c’est dû à un rapport de séduction qui se met un peu en place, ou est-ce que c’est tout simplement parce que tu les as trouvés plus sympas ?
Je pense qu’il peut y avoir des deux. Il y en a vraiment qui sont super sympa et on rigole bien. Après, il y en a d’autres, je ne dirais pas nécessairement qu’il s’agit de séduction, mais d’un côté paternel.
Est-ce que ce côté paternel a été parfois paternaliste ?
C’était plutôt correct je dirais. Les techniciens ça va, tous les techniciens ça a été super, certains m’ont appris vraiment plein de choses. Ils ont été trop gentils. Pour moi, ça a plus été certains profs…
En dehors de ce que tu m’as déjà raconté, est-ce que tu as été témoin ou victime de propos, gestes sexistes ou déplacés, ou des renvois à des stéréotypes féminins ?
Je n'ai pas vraiment retenu de propos sexistes à proprement parler. Après, s’il y a vraiment quelque chose que je dois dire, j’ai dit plus tôt que j’ai ce rapport au féminin trop proche de moi et ce n’est pas que je ne veux pas en parler, mais que je ne suis peut-être pas encore prête à parler de la condition de la femme noire. Et bien mes profs voulaient a-bso-lu-ment que je parle de la condition de la femme noire au sein de mes projets. C’est un peu drôle, ils pourraient simplement me parler des conditions des personnes noires, mais si je touche un peu aux conditions de l’homme noir, il faut que je parle de la condition de la femme noire.
Est-ce que tu dirais qu’à l’école, ce qui t’a le plus interloquée, choquée, gênée ou même fait de la peine, c’est plus souvent du racisme que du sexisme ?
Oui, ça a été ça et aussi le rapport aux classes sociales. Et il y a toujours ce twist, autour de ma féminité, comme quand on me fait comprendre que je suis naïve et que je ne sais pas ce qui est mieux pour moi. De toute façon, même si c’est un sujet que je fais exprès d’éviter, quoi qu’il arrive il me revient toujours en pleine face.
Et dans le rapport de classe sociale c’est plutôt dans ton rapport aux autres élèves que ça apparaissait ?
Non. C’était par rapport aux profs. J’ai un professeur qui m’a dit, quand je travaillais et que je ne pouvais pas venir « Soit tu veux une vie professionnelle, soit l’école. Tu ne peux pas enchaîner. Tu ne peux pas faire et l’école et un travail ». J’ai un professeur qui m’a dit « Mais tu ne peux pas faire un prêt ? ». Et quand j’en ai parlé à l’assistante sociale, elle m’a dit qu’en réalité, aux Arts Déco en général, on travaillait beaucoup. En fait, avoir un travail à côté, ce n’est pas quelque chose d’évident. Ce qu’il fallait, tout le monde me le disait, tous mes profs, c’est de réduire mes heures, que cinq heures c’était bien mais que dix c’était trop. J’en faisais quinze.
Tu es en Design vêtement, le monde de la mode a un rapport particulier avec les femmes et j’imagine aussi les femmes noires, est-ce que dans l’enseignement qu’on t’a donné, tu as l’impression qu’il y a un rapport particulier aux vêtements pour les femmes, est-ce qu’on pousse vers un corps standardisé ?
Il y a eu des petits moments comme ça. Il y a eu un moment où je faisais des vêtements sur mon propre corps. Je travaille souvent le vêtement homme, et souvent du oversize, je n’aime pas travailler sur des petits trucs. Travailler sur du 34 pour moi ça n’a pas de sens… En tout cas c’est assez intéressant de voir que ce n’est pas mon corps, ce n’est pas moi qu’on appelle quand on a besoin de dessiner quelque chose. C’est clair qu’il y a un corps standardisé et même pour aller un peu plus loin, le vêtement du corps de la femme il est adapté au corps d’une femme qui est quand même plutôt mince mais qui est également blanche. Et ça il faut le dire. Tous les corps sont différents, ça je suis hyper d’accord et même au sein de l’Afrique, que ce soit l’Afrique du Nord ou subsaharienne. Même en Afrique subsaharienne, il y a une diversité des corps, c’est sûr. Mais après, il y a quand même des petites choses qui reviennent.
Et si tu prends mon corps par exemple, je suis quelqu’un de cambrée, avec des fesses. Ça c’est problématique et toute ma vie j’ai toujours vu des femmes noires porter des robes qui rebiquent au niveau du creux du dos, parce on a cette chose qu’on appelle l’hyperlordose. C’est commun. C’est pas du tout une maladie mais ça peut te disposer à avoir des problèmes de dos. Il y a ce trait-là qui revient chez les femmes noires. Tout comme chez les femmes maghrébines, qui ont des hanches souvent larges. Moi quand je porte un jean, je suis obligée de porter une ceinture parce qu’il y a toujours un espace de trois petits centimètres, entre mon bas du dos et mon jean où je peux mettre tout ce que je veux. J’aurais beau chercher la bonne taille il y sera toujours. C’est très très rare que je puisse porter une robe prêt du corps et que ça ne rebique pas dans mon dos, et c’est pareil pour toutes les femmes de ma famille. Trouver un patron de vêtement adapté à mon type de corps à l’atelier, c’est difficile.
Est-ce que les profs l’abordent un peu ? Ou est-ce que c’est plutôt le standard 34 et c’est tout ?
Oui, c’est plutôt ça en général. Après, il y a des personnes qui font en sorte que ça change. Je pense par exemple à Sophia [Lang, étudiante], grâce à elle, je crois qu’on va avoir des commandes de mannequins grandes tailles. Mais oui, il n’y a vraiment que ce corps-là. Après je ne veux pas particulièrement insister sur le corps de la femme racisée parce que ce ne sont que des détails comparés par exemple aux problèmes que peut avoir Sophia ou des personnes handicapées. D’ailleurs, le vêtement pour les personnes handicapées, on n’en parle pas. Ça ne fait pas partie de nos apprentissages.

Pascale Lagautrière
responsable
de l’atelier sérigraphie
depuis 2007
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 12.01.21

- Relation aux étudiant·es
- Silence et parole
- Modèle
- Agissements sexistes
- Déséquilibres
Entretien de
Pascale Lagautrière
responsable de l’atelier sérigraphie depuis 2007
le 12.01.21 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Lucile Encrevé
Quand es-tu entrée à l’École ?
Je suis arrivée le 1eroctobre 2007, pour travailler dans l’atelier de sérigraphie en binôme avec une femme [Monique Schouller] qui est partie à la retraite et a été remplacée par mon collègue actuel Géronimo Martin. Avant, j’ai travaillé sept ans dans un atelier de sérigraphie d’art, l’Atelier d’Éric Seydoux, où j’ai eu l’occasion d’imprimer les travaux d’artistes comme Garouste, Zao Wou-Ki, Pierre et Gilles, Nan Goldin, Pol Bury, Yayoi Kusama, Pierrette Bloch, Shirley Jaffe, Monory, Viallat, Loustal, Sempé, Savignac… Quand j’ai appris qu’il y avait une place de technicien de sérigraphie qui était disponible, j’ai postulé et j’ai eu le poste.
C’était un poste de fonctionnaire ?
Pour les recrutements dans les ateliers, il me semble que c’est la même chose que pour tous les autres postes, la priorité est donnée aux fonctionnaires, s’il n’y a pas de fonctionnaire qui convient, ils élargissent le recrutement aux contractuel·les. En ce qui me concerne, je suis contractuelle. Actuellement dans l’École, seuls trois responsables d’ateliers sont fonctionnaires.
Et tu as toujours été où tu te trouves aujourd’hui, au 4e étage, en sérigraphie ?
Oui, c’est une des difficultés de l’École pour les responsables d’atelier : quand on est quelque part, pour aller ailleurs, c’est un peu compliqué. J’ai eu cette velléité à une époque, j’avais envie de changer, d’aller à la bibliothèque, cela m’a été refusé : la direction m’a dit, « Mais que savez-vous faire de mieux que la sérigraphie ? ». Ils n’avaient pas lu mon CV, j’ai été secrétaire de rédaction, j’ai travaillé dans le tourisme, j’ai fait des études de sociologie. C’est dommage, je trouve que quand on est trop longtemps sur un poste, on rentre vite dans des routines, on finit par s’y ennuyer, même s’il y a de la diversité grâce aux étudiants.
En tant que femme, est-ce que tu as l’impression d’avoir eu des expériences spécifiques ici ?
C’est compliqué de répondre à cette question, je ne me la suis jamais posée, et je ne pourrais pas dire si ce que je vis à l’École est genré ou non mais je pense que dans la vie tout n’est pas genré. Peut-être qu’en tant que femme j’ai plus entendu d’étudiants venir me raconter leurs histoires et leurs mécontentements, j’ai plus recueilli leur mal-être. Mais est-ce que c’est une question de personne ou une question de genre ? Je ne peux pas le dire. On peut être un homme et être empathique. J’ai des collègues hommes qui recueillent aussi des petits oiseaux blessés dans leurs ateliers.
Ce sont plus des étudiantes qui se confient à toi ?
Non, autant des étudiantes que des étudiants, pour des problèmes liés à l’École ou pas. Peut-être que les filles se confient plus, se livrent un peu plus, qu’elles sont plus aptes à se libérer par la parole. On est là au moins 35 heures par semaine, avec les étudiant·es on finit par être un peu comme à la maison, on finit par avoir des relations de confiance presque familiales.
Alexandra m’a raconté que tu la massais.
Parce que je le demandais.
Oui, je l’ai massée une fois à sa demande, c’était le rush pour eux juste avant les diplômes et elle avait très mal à l’épaule. À l’atelier, je leur propose de l’huile essentielle de menthe poivrée lorsqu’ils ont des migraines, en massage sur les tempes, ça marche très bien. J’ai aussi des pansements, et une fille qui a besoin d’un tampon hygiénique sait qu’elle peut venir me voir. Je dépanne. Ils pourraient être mes enfants. J’ai 60 ans.
Tu as l’impression d’être un modèle ?
Je ne peux pas répondre à cette question, il faut leur demander. Il y a quelques jours, une étudiante m’a dit qu’elle voulait vieillir comme moi. Peut-être que c’était une blagueuse… Je pense que je suis un soutien, une oreille.
Les étudiants te renvoient une image sexiste de l’École ?
Pour certains, oui, bien sûr. Il y a des comportements sexistes dans certains secteurs, dans certains sous-sols. Là, il y a des combats à mener. C’est insupportable que des étudiant·es soient dévalorisé·es, soient maltraité·es. Plus que tout, ce qui est important, c’est le respect de l’autre. Un prof de graphisme, à qui j’ai parlé de la difficulté que les étudiantes rencontraient à avoir des rendus devant un aéropage d’hommes, a reconnu qu’effectivement le fait d’être en groupe et d’être plus nombreux, ça faisait remonter des comportements qu’ils n’auraient pas forcément eus individuellement. Aux étudiants, je leur dis de se défendre, de se mettre en collectif, de faire, si ça se passe si mal, le siège de la direction jusqu’à ce qu’elle trouve une solution. La plupart des élèves ont tellement peur qu’ils n’osent même pas raconter ce qui se passe. Je les encourage tout le temps à parler, en étant mesurés, bien sûr. C’est important de libérer la parole, après c’est à nous les encadrants, techniciens, profs, direction, de trier, d’analyser et d’agir si nécessaire. Pour une fois, depuis que je suis là, la direction de l’École est à l’écoute et a envie de faire bouger les choses. Et il y a une nouvelle instance, le CFVE [Conseil de la Formation et de la Vie Étudiante] : là j’ai l’impression que les étudiants commencent à prendre la parole.
Toi, tu n’as pas subi de sexisme à l’École ?
Non, je n’ai pas souvenir de ça.
Aujourd’hui, tu te sens bien partout dans le bâtiment ?
Oui, parce qu’à ma connaissance, les problèmes, quand il y en a, sont des abus de pouvoir entre adultes encadrants et étudiants. Je ne me sens pas vulnérable, et si je me sentais agressée je saurais comment réagir, d’autant que j’ai pris des cours de self-défense.
Sinon, parmi les responsables d’atelier, tu as l’impression que c’est équilibré ?
Il faut savoir que la féminisation de nombreux métiers de l’artisanat est assez récente, et que notre École était à l’image de la société, et pour moi, que les ateliers aient été tenus majoritairement par des hommes n’a rien de choquant. L’École évolue avec son temps, et de plus en plus de femmes occupent les postes de responsables d’atelier. Quand je suis arrivée, les ateliers du -2 et du 4e étages étaient très masculins, là on est presque à la parité. Parce que, quand je suis arrivée au 4e [fig.14] en 2007, il y avait deux femmes en sérigraphie – j’ai remplacé une femme [Marie-Claire Corbel] mais en gravure, en pré-presse, en moulage, en animation, c’était des hommes. Maintenant, on rééquilibre. Ça change, je pense que ça évolue dans le bon sens.
Quand vous étiez seulement deux, c’était difficile ?
Non. Je sais survivre dans un milieu majoritairement masculin… Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte : il y a la personnalité, il y a l’âge et l’expérience. Dans le milieu où je travaillais avant, c’était très masculin : je me suis un peu aguerrie. Et tous les hommes ne sont pas insupportables à vivre… Je fais partie d’une génération qui ne se posait pas trop de questions comme ça.
Est-ce que parmi les responsables d’atelier, il y a eu de la solidarité entre les femmes ?
De mon point de vue et en ce qui me concerne, je n’ai pas particulièrement besoin de cette solidarité avec les autres femmes dans les ateliers car j’ai des relations non genrées avec mes collègues féminines et masculins. J’entretiens des relations amicales et particulières avec certaines et certains mais c’est une question d’affinité plus qu’une question de solidarité.
Quelles relations tu as avec les enseignants ?
J’ai assez peu de rapports avec eux. Un enseignant qui demande pour un cours un accès à l’atelier, j’ai l’impression qu’il demande un espace plus qu’il ne s’adresse à une personne.
Il ne vient pas chercher tes compétences ?
Non, il y a quand même un problème de reconnaissance des compétences dans cette école. J’ai même parfois l’impression qu’une partie du corps des enseignants considère les responsables d’atelier comme étant d’une classe inférieure à la leur. Mais ce n’est pas une question de genre et ça n’a rien à voir avec le sujet.
Avec les femmes enseignantes, ce n’est pas plus facile ?
Non, certaines femmes sont pires que des hommes. Mais il y a des enseignants hommes et des enseignantes femmes avec qui ça se passe bien.

Natacha Nisic
étudiante
de 1985 à 1991
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 07.01.21

- Liberté
- Déséquilibres
- Insouciance
- Conscientisation
- Transmission
- Culture féministe
- Protection
- Engagement
- Collectif
Entretien de
Natacha Nisic
étudiante de 1985 à 1991
le 07.01.21 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Natacha Nisic, je suis artiste et cinéaste. Les Arts Déco, pour moi, c’est une période lointaine. Je ne sais même plus exactement l’année où j’y suis rentrée. Je pense que ça doit être 84-85. J’avais 19-20 ans, j’avais fait des mathématiques à Jussieu avant, et après une année préparatoire j’étais rentrée aux Arts Déco. J’y ai passé mon diplôme, mais je n’y suis restée que trois ans puisqu’après je suis partie à Berlin, à la Deutsche Film und Fernseh Akademie. Je ne suis pas vraiment rentrée finir le cursus, j’ai juste passé le diplôme. Je mets le souvenir des Arts Déco, en tout cas, dans ma mémoire et dans ma pratique, systématiquement en balance ou en regard de mon expérience berlinoise de l’époque. Qui était autrement différente et autrement importante.
Par rapport à notre sujet d’étude ici, est-ce qu’il y a des choses qui vous viennent spontanément, dont vous avez envie de parler ?
En fait, si j’essaie de me replacer à l’époque — c’est peut-être important aussi dans un contexte donné — ce n’est pas que la question de la place de la femme n’était pas posée, c’est qu’elle me semblait tellement « épouvantable » qu’il ne fallait pas la poser. Qu’il fallait, « s’affirmer comme une personne » avec ses qualités et ses défauts, avec ses revendications. Et que c’était cette personne là qui existerait. Il me semblait que le débat — il a beaucoup évolué et a beaucoup changé depuis — ne pouvait pas se placer au cœur de la question des genres. C’était la question « d’exister », point. Et cette existence — serait d’autant plus difficile, complexe, difficilement transmissible parce que j’étais une femme. La question n’était pas posée en premier en fait. Il y avait déjà quelque chose d’une grande difficulté à s’affirmer. Est-ce que c’était féminin ou masculin, je ne sais pas. Au sein des études, je ne sentais pas forcément une forme de discrimination. Je savais par contre qu’à la sortie, les choses seraient plus difficiles. Mais ça ne prenait pas vraiment la bannière féministe. C’était comme une espèce de féminisme rentré, revendiqué intérieurement.
Dans l’école, y avait-il des difficultés et comment ça se présentait ? Des difficultés à s’exprimer, à faire, à pratiquer ce que l’on voulait ?
En fait, paradoxalement, il y avait avec les jeunes étudiantes qui étaient là aux Arts Déco dans mon souvenir, une ambiance plutôt sympathique et plutôt relativement affranchie dès la première année. La première performance à laquelle j’ai participé, il s’agissait de se retrouver toute nue sur la scène à faire un spectacle avec un masque. On s’était beaucoup amusé à faire ça et ça a été, je crois, des premiers indices d’une forme de naïveté puisque, on a fait ce spectacle, on était plutôt contentes, on avait l’impression d’être un peu (même si ce n’était pas nouveau) dans une transgression, une provocation, une revendication aussi, de notre place. Et le prof de scéno qu’on avait à l’époque nous a fait remarquer qu’en fait, il s’était bien rincé l’œil. Ça avait été un vrai gros choc. C’est à dire qu’en fait on n’était pas du tout arrivées à s’affranchir d’aucun des clichés et voilà, il avait bien apprécié de voir des jeunes filles à poil. Et il a eu une façon de nous le faire partager qui nous a immédiatement mises là où on était, c’est à dire dans un écart de générations, de genre et de pouvoir. Peut-être ai-je été plus que d’autre « choquée » par ces propos. En tout cas, ce n’est jamais sorti du groupe, encore moins à la direction. Cela n’aurait pas eu de sens d’ailleurs à ce moment-là, le machisme était de bon aloi, tout le monde en riait, même un peu jaune.
Et vous pensez que c’est le contexte de l’école d’art qui vous avait donné ce sentiment de liberté, qui vous avait fait penser que vous étiez à l’abri, en sécurité ?
Oui ! Moi j’étais là dans les années où je crois que l’école était complètement déstructurée. Des années très flottantes, les années de grèves, les grèves de Malik Oussekine [étudiant frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986], les premières lois Devaquet. Donc la première année des Arts Déco, j’ai passé beaucoup de temps dans les manifestations à faire des interventions dans la rue, et je me sentais vis à vis de l’école, liée par un contrat moral un peu léger. Je ne me sentais pas devoir être ni plus présente, ni moins. Je ne sais pas comment les choses ont évolué, c’est peut-être un peu plus rigide maintenant. Mais à travers ça, finalement, il y avait quelque chose d’assez flou. Et on avait la sensation aussi que de là où on en était, c’est à dire un pied dedans un pied dehors, on pouvait réinventer des choses. On allait aussi réinventer ces relations-là, notre place… C’est à dire que jamais, mais vraiment jamais, j’ai eu la sensation qu’on était des victimes. On était des actrices. On avait vraiment envie de faire quelque chose. C’est pour ça que je disais, au-delà de la question du genre, c’était la question de notre place en tant que personne qui était importante.
Vous étiez en Scénographie, c’est ça ?
J’ai fait un an en Scéno et après je suis allée en Vidéo l’année d’après.
Est-ce que vous aviez beaucoup de profs femmes ? Quel était l’équilibre ?
Dans mon souvenir, il n’y avait pas de professeure femme et il y a eu une seule femme qui est venue, qui était « conférencière », qui m’a beaucoup appris. Elle a fait des cours d’art contemporain, qui m’ont beaucoup stimulée. Mais elle était là très peu, elle n’était pas du tout titulaire. Il n’y avait pratiquement que des hommes autour de nous, vraiment. C’était que ça et ça semblait être le paysage naturel. C’est ça qui est fou, c’était le paysage tel qu’il était.
Est-ce que c’est ça qui vous a fait un peu penser qu’après l’école, ça allait être plus compliqué ?
Oui, parce que je savais que c’était extrêmement masculin, l’enseignement, mais surtout moi si je voulais faire — je n’étais pas complètement claire — de l’art ou des films, ou les deux, ce serait très masculin. Et je n’aurais pas ma place, ça me semblait évident que ça allait être très difficile.
Est-ce que ça a eu d’autres impacts spécifiques sur votre scolarité ?
À l’époque moi, je trouvais que l’école ne fonctionnait pas. Il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Peut-être ce truc très masculin, d’une grande rigidité des horaires, des cours. Et quand je suis allée à Berlin, dans le fond, c’était encore un peu masculin, mais beaucoup, beaucoup moins. Et surtout, là, on était dans une revendication extrêmement politique et politisée du champ artistique et de la place des femmes. C’est à dire qu’il fallait que je prenne position, il fallait que ce soit une revendication, il fallait que je m’inscrive à l’intérieur d’une histoire. On était vraiment dans le post-féminisme, marqué de façon très clair et très important. Ce qui fait que si je compare les deux, ce n’est pas simplement l’école, mais aussi le regard social ou la société qui n’avait pas le même fond, on n’était pas du tout dans les mêmes paradigmes. Et ça, je l’ai vraiment vécu à Berlin de manière très, très sensible.
Vous aviez une plus grande conscience de tout ça ?
Oui une conscience et une pratique. Moi j’ai atterri à la DFFB [Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin] qui était un peu le creuset de toute la pensée politique du cinéma allemand, je ne savais pas que c’était si important avant d’y être. C’est l’école de Harun Farocki, c’est là que les Straub-Huillet ont tourné Antigone, c’est une école qui a été fondée après 68, rien ne pouvait échapper à un champ de revendications : la place de chacun dans l’affranchissement face aux modes de production, face au genre, etc. Évidemment, il y avait une grande conscience de la place des femmes, ou en tout cas elle était très combattante ! Les filles avec qui j’étais dans des groupes que l’on formait, étaient des filles extrêmement revendicatives, extrêmement militantes, on était dans le militantisme.
Pas du tout aux Arts Déco ?
Pas du tout. Non les Arts Déco, je ne veux pas dire que c’était de l’inconscience, pas du tout, mais c’était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus… Comment dire ? Les gens avaient l’impression, ou les filles avaient l’impression que ça allait marcher, qu’il suffisait de faire ces performances, d’avoir un travail qui s’intéressait à la cause des femmes pour que ça suffise. Mais en fait, c’est en sortant… Si je fais le bilan des femmes qui sont sorties dans les années dans lesquelles je suis partie, ça doit être abyssal celles qui ont continué à faire de l’art. Le nombre de filles qui sont tombées enceintes après leurs études… Je le savais, mais les chiffres, j’imagine, sont assez durs.
Quand vous étiez à l’école vous aviez peut être l’impression que le simple fait d’être là, de faire cette école allait suffire ?
Oui, exactement. Je crois qu’il y avait encore une espèce de confiance un peu naïve dans l’institution, même si l’institution — de mon point de vue parce que j’étais extrêmement critique, j’étais un peu mauvaise élève parce que j’étais rebelle — me semblait ne pas fonctionner du tout. Et maintenant, a posteriori, je vois effectivement combien c’était vraiment masculin, complètement rigide. Il n’y avait pas de place pour nous en fait.
Est-ce qu’il n’y avait pas des profs femmes en sciences humaines ?
Non, je ne me rappelle plus des noms mais non je crois que ce n’était que des hommes.
Est-ce que face aux discours des profs vous étiez capables de vous exprimer ? Vous étiez beaucoup de femmes dans les étudiantes ?
Dans les élèves j’imagine que ça devait être à peu près 50/50. Nous on n’avait pas l’impression en arrivant que quelque chose était discriminant parce qu’il y avait le même nombre de garçons que de filles, chacun faisait un peu les choses qu’il voulait… Et pas mal de filles faisaient des travaux sur des questions… post Annette Messager, sur la place des femmes, est-ce qu’on peut avoir une pratique artistique en tant que femme, etc. Il y avait vraiment des choses, ce n’était pas une forme coercitive comme ça, majeure, non. Je ne pense pas du tout. Mais je crois que puisqu’il y avait peu de discours sur ces questions, il y avait une forme d’aveuglement sur comment les choses allaient se passer en vrai. C’est à dire que l’école fonctionnait comme une espèce de cocon un peu idéal, un peu protecteur, très masculin, mais ça ne semblait pas si gênant que ça puisqu’on avait l’impression de renouveler les choses puisqu’on était nous la jeune génération, qu’on était à 50% filles, 50% garçons. Donc on allait transgresser quelque chose, passer au-delà, etc. Mais personne n’était préparé à affronter la suite avec ce bagage-là, qui n’était pas du tout assez important, ni théorisé et politisé.
Ayant fini mes études cette année, il me semble un peu que ça dénote d’une sorte de naïveté puisque si on regarde aujourd’hui, on a toujours énormément de profs hommes, moins qu’avant mais la proportion pose toujours problème, et on est plus nombreuses encore parmi les étudiantes. On a nous-même aussi parfois l’impression que les choses vont changer de soi, alors que ce n’est pas le cas.
Oui, c’est très paradoxal cette situation. À Berlin, je n’avais pas du tout cette sensation, on était déjà des acteurs de dedans et de dehors, on avait moins cette sensation d’être dans un cocon comme les écoles françaises. Aussi, maintenant, je ne sais pas ce que vous vivez ou la façon dont les choses sont faites, mais on ne nous a pas appris à comprendre comment faire les choses pour ne pas se retrouver discriminées dans les années à venir. Des choses très simples de l’occupation du temps, à partir du moment où on choisit d’avoir des enfants. Des discriminations dans les modalités de travail, surtout dans — maintenant ça change un peu — tout ce qui est vidéo-cinéma qui est très hiérarchisé, il y a des tâches qui sont très masculines et encore maintenant. Trouver sa place pour une femme, c’est s’imposer, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup plus de force et c’est un combat. Il faudrait un entrainement de combat. Mais on n’était pas dans le combat, on était dans une revendication douce, joyeuse et naïve.
Et dans vos pratiques, est-ce que ça se ressentait ? Une forme d’expression dont vous aviez envie de faire part dans votre travail ?
À la sortie des écoles, j’avais fait un film, un moyen métrage en film qui se posait des questions sur la société, de manière générale pas forcément féminine. Je voulais qu’il soit beaucoup plus comme un manifeste, point. Il n'était pas genré. Ce n’était pas le manifeste d’une femme, c’était un manifeste de société, c’était aussi une œuvre sur la solitude. Cette fiction évoquait de nombreux problèmes. Ça a été ma position pendant longtemps, j’ai cherché à exister en tant qu’artiste, point. J’ai pensé longtemps que la valeur et la puissance de ces propositions suffiraient et je pense maintenant avec le temps que ça ne marche pas. Je pense qu’il faut une éducation et une conscientisation, j’en suis certaine. Il y a des choses qui nous tombent sur la tête auxquelles on n’est pas préparées, il y a quelque chose à transmettre. Il y a aussi peut-être, de la part des artistes femmes, à transmettre quelque chose maintenant, si elles accèdent plus à des postes importants de transmission et aussi à des postes dans la société.
Et vous, est-ce que vous enseignez ?
J’enseigne depuis très peu à Strasbourg, à la Hear.
Et ça vous faites revivre des situations de l’époque où vous étiez étudiante ?
Oui, mais c’est vrai que je le vis comme quelque chose d’important de devoir faire partager les différentes natures de combats que j’ai pu avoir et qui se dessinent, etc. Contrairement au temps où j’étais étudiante, j’ai beaucoup d’étudiantes qui sont concernées par ces questions, qui ont un discours assez élaboré et aussi inventif, sur les questions de genre. Je ne suis pas certaine que ça suffise d’avoir un discours, mais ça c’est autre chose.
Est-ce que vous poussez vos étudiantes vers une forme d’expression féministe ? Comment vous transmettez cette éducation dont vous auriez eu besoin ?
Par plein de points de vue, c’est vrai que l’expression d’une forme de l’intime, de la subjectivité ou des formes de subjectivités, que ce se soit aussi la valorisation des autres artistes femmes et la façon dont elles se sont exprimées, les différents travaux, c’est très important. L’étude à l’envers aussi, l’étude des formes et propositions oubliées ou de la façon dont se construit l’éviction des femmes, c’est important de le repérer, de le voir, de le comprendre, ça c’est des choses sur lesquelles on travaille [fig.15]. Dans le langage aussi, dans le langage des films et des œuvres…
Dans l’École, vous vous êtes sentie libre de créer, dans tous les espaces où il était possible de créer ? Est-ce que vous vous y êtes sentie bien, et en confiance ?
Moi j’étais un « garçon manqué » à l’époque. J’étais très rebelle et je m’attelais à tout ce qui semblait être masculin. Je faisais des choses « que les hommes font ». Donc, il était hors de question que quelque chose ne me soit pas accessible. Mais c’était une forme de revendication que j’avais plutôt dans ma façon d’être.
Est-ce que vous aviez l’impression qu’il fallait s’habiller d’une certaine manière pour venir aux Arts Déco ?
Je m’habillais comme un garçon. J’avais les cheveux ras, j’étais carapacée. Ça s’est accentué aux Arts Déco. C’était une protection. Parce qu’il y avait les filles qui étaient très féminines, très belles, et moi je ne voulais pas jouer avec ces armes de la séduction. Je voulais en même temps un peu me battre. C’était un peu un costume. C’est resté longtemps. J’ai travaillé à la télévision sur des plateaux où je devais diriger quinze hommes, je devais dire à des gens, à des personnalités importantes « Tais-toi ! », « Parle ! ». Ça permettait surtout qu’on ne m’emmène pas sur un terrain sur lequel je ne voulais pas aller.
Vous pensez que ça vous a empêchée d’être bloquée, d’avoir peur, etc. ?
Oui je les ai un peu prises de force ! Dans ce sens là j’essayais de me démarquer des femmes ou des filles qui revendiquaient une place plus en retrait. Ça m’a toujours semblé un peu… un peu dangereux. Mais on ne m’a pas empêchée…
Est-ce que vous diriez que vous êtes sortie de l’école plus en confiance, plus en conscience de vos capacités ? Comme vous avez fait une autre école en parallèle, peut-être que l’une a créé plus que l’autre ce sentiment.
À Berlin, le « faire » était inscrit dans un acte déjà très engagé, très politique. Quelque soit le sujet qu’on aborde, ce n’est pas juste une question de sujet, c’est une façon d’être, une façon d’avoir déjà sa place. J’ai habité de nombreuses années en Allemagne parce que j’étais mal en France. J’ai eu beaucoup de mal dans le monde professionnel de l’art français comme femme. C’était épouvantable.
Vous avez été prise à Berlin à la place de votre quatrième année ?
Oui, on peut dire ça, oui. Et en fait j’y suis restée.
Vous êtes revenue faire le diplôme ?
Oui mais deux ou trois ans après. J’ai fait mon film à Berlin et à la fin, un peu plus tard, je me suis dit qu’il fallait quand même que je passe le diplôme. C’était un petit peu compliqué, mais ça s’est fait.
Et vous n’avez pas fait de mémoire alors ?
Si, si, j’ai fait mon mémoire. Ça s’appelait Le cri d’Augustine. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé sur le texte de Didi-Huberman, la photographie et l’hystérie. Tout ce travail que Didi-Huberman avait fait. J’étais vraiment déjà dans des questions comme ça. En quoi l’appareil mécanique, l’appareil de l’œil met en œuvre une possible position féminine ? C’était un flop total ! On me l’avait renvoyé en me disant que c’était une catastrophe. Ils n’avaient pas du tout apprécié mon mémoire. Je n’avais pas du tout écrit de façon… — maintenant, ça pourrait passer je crois — c’était des réflexions éparses, un peu théoriques, des aphorismes sur les figures du cri. Ça n’avait pas du tout marché.
En soi c’est un titre assez féministe, non ? Il y avait un contenu quand même, de ce côté-là ?
Oui ! Oui je pense, tout à fait, sur l’hystérie, l’impossible expression, effectivement. Il y avait quelque chose d’une espèce d’énergie vitale qui ne trouvait pas sa place. Mais il n’y avait que des hommes dans mon jury, je parlais une langue complètement étrangère.
Au concours aussi il n’y avait que des hommes dans vos jurys ?
Mon jury aux Arts Déco, oui il n’y avait que des hommes aux différentes étapes. Je n’avais jamais pensé à ça. Au diplôme aussi.
Je suis heureuse d’avoir fini les Arts Déco avec un jury presque entièrement de femmes.
Non mais ça, c’est quand même une révolution en fait, c’est incroyable.
Est-ce que dans les cours on vous parlait un peu d’artistes femmes, de créatrices, dans vos souvenirs ?
Globalement, c’était à 95% masculins les exemples que j’ai eu d’œuvres. Je n’ai pas eu d’enseignement qui, d’une manière ou d’une autre, mettait en valeur le travail des femmes, à part peut-être Niki de Saint-Phalle. On voyait des bons films, des bons textes, qu’on étudiait ou qu’on regardait, point. La question du genre ne se posait pas tellement. C’est bien après, avec le recul, qu’on s’aperçoit effectivement que c’était au trois quarts masculins. Parce que les normes et parce que les étalons de l’époque, dans tous les sens du terme, étaient masculins. Beaucoup plus d’hommes faisaient des films, beaucoup plus d’hommes étaient metteurs en scène, etc. C’est quand les choses ont changé qu’on s’est mis à voir plus de femmes, mais j’avais quitté l’école, ou bien j’étais en Allemagne.
Et pour le diplôme qu’est-ce que vous aviez présenté ? La réception était bonne ?
J’avais présenté un film en 16 mm que j’avais fait en Allemagne. Oui oui, le film a été bien reçu. En fait moi je pensais que ça allait être une catastrophe, mais non, ça a marché.
Et pour le mémoire qui vous encadrait ?
Ça avait été un peu une catastrophe pour moi, je n’avais pas très bien choisi, j’avais eu du mal à trouver…
C’était un homme ?
Ah mais ce n’était que des hommes ! Il n’y avait pas de femmes. Moi, en dessin c’était un homme, en gravure c’était un homme, en modelage c’était un homme, en peinture c’était un homme. Non je ne vois aucune femme à part une femme qui est arrivée en théorie à un moment donné, de manière un peu extérieure.
Pourtant, c’était quand même déjà les années 80.
Oui, oui, et même je crois que mon diplôme j’ai dû le passer en 91. La société a changé, les points de vue ont changé.
Et pendant vos années d’études aux Arts Déco, est-ce qu’il vous est arrivé d’être témoin ou victime d’actes ou de propos sexistes, de violences sexistes ou sexuelles ?
Non, non, il n’y avait pas de choses aussi directes que ça. Il y avait des situations de séduction, ambiguës, mais pas forcément de harcèlement, ou alors je ne l’ai pas su.
Il n’y a pas de situations que vous regardez avec un œil un peu différent aujourd’hui ?
Des situations très paternalistes, vraiment. En Scéno on avait un prof qui avait vraiment ses petites ouailles, toutes jolies, mignonnes. Bon je ne pense pas que ça allait plus loin que ça, en terme éventuellement d’abus sexuels, mais sur le principe, on était déjà dans une configuration, en tout cas pour les femmes, assez difficile. Dans le sens où elles ne s’émanciperaient jamais de cette situation.
Dans vos années aux Art Déco, dans les différents cours, dans l’ambiance extra-scolaire, est-ce qu’il y a des choses qui vous ont particulièrement épanouie ?
Il y avait quand même globalement — je pense que c’est l’époque qui a beaucoup changé — il y avait une liberté, ça c’est évident. C’est à dire que les choses étaient un peu scolaire, avec des horaires vraiment… On devait finir les cours à sept heures du soir. Il y avait des trucs comme ça, on n’avait pas le droit de rester trop longtemps travailler. Toujours avec des combats comme ça, avec une scolarité bizarre, une administration bizarre, mais une fois que ça a été dépassé, globalement, régnait une espèce de chaos assez sympathique. Et ça, c’était vraiment très agréable parce que ça permettait de se rencontrer, de laisser aller un peu les possibles. On a vraiment passé du temps à faire des interventions qui étaient esthétiquement belles pendant les manifestations. Je me dis que ça, c’était aussi possible parce que c’était sympathiquement possible. On n’était pas dans une confrontation avec la direction. Je me demande même si la direction s’intéressait à quoi que ce soit. Ça flottait complètement, mais ça, ça rendait les choses assez agréables.
Il y a des traces de ce que vous aviez fait pour des manifestations ?
Franchement, je ne crois pas. Un de nos exploits avait existé, grâce à l’un d’entre nous qui avait fait Scéno je crois, avait les clés, je ne sais comment, du métro parisien. On avait squatté une nuit une station et on avait remplacé toutes les affiches de publicité par nos propres affiches publicitaires. On avait collé ça pendant toute la nuit. On avait fait des grandes quatre par trois hyper belles qu’on avait mis des jours à faire. On avait collé des trucs partout sur le sol et on avait entièrement habillé la station de métro. C’était très beau.
Le premier train est arrivé, je crois, à cinq heures et demie du matin. Des gens sont rentrés. C’était assez incroyable. Tout le monde hurlait de joie et une demi-heure après, les services de nettoyage sont arrivés et ils ont tout viré. Il y avait des trucs incroyables. C’était l’époque où, comme il y avait eu la mort de Malik Oussekine, donc il y avait ces traces qu’on formait sur le sol, des corps, comme pour une enquête de police. On avait peint des lampadaires en rouge, enfin… on faisait des comités de réflexions un peu post-68, sur quel type d’affiches on allait faire, et on avait investi une ou deux salles en peinture. On ne faisait que ça.
C’était des choses que vous faisiez uniquement avec des personnes de votre secteur ?
En fait, c’est ce que je disais, comme il régnait un espèce de chaos assez important, c’était les gens qui avaient envie. Je ne saurais même pas dire qui était en quelle section et qui avait quel l’âge. Simplement, on était d’accord sur faire des choses, faire des actions, et on les faisait.
Et il y avait des profs qui vous accompagnaient là-dedans ?
Les profs nous toléraient et en tolérant, ils permettaient. Voilà c’était leur façon de dire qu’ils participaient. Je crois que c’est aussi une histoire de mentalités qui ont vraiment changé.
Et il y avait des affiches sur la situation des femmes ?
À l’époque, c’était vraiment sur la loi Devaquet. On était dans une question politique très générale. Avec la montée de l’extrême droite, avec les lois Pasqua, les lois sur la nationalité, enfin toutes ces questions qui ont traversé cette époque et dont on a hérité maintenant. C’était vraiment l’arrivée de Le Pen et de ces questions-là. Il s’agissait de trouver une façon de résister.
Est-ce qu’il y a des phrases qui vous restent, qui vont ont été dites ?
Non pas vraiment. À l’époque par exemple, je me rappelle, il n’y avait pas tellement de matériel. Je ne sais plus on avait trois caméras à moitié pourries, il fallait se battre pour les avoir. Je me battais pas contre des filles, je me battais contre des garçons et c’était toujours les mêmes. Donc, si moi je ne faisais pas du forcing pour avoir le matériel, je ne l’avais pas.
Vous vous aviez une personnalité qui vous donnait envie de vous battre pour ça, mais vos camarades est-ce qu’elles y arrivaient ?
Tout le monde n’a pas la même volonté de se battre sur ce terrain là, c’est évident. Alors peut-être qu’elles usaient d’autres méthodes, plus dans la séduction.
Est-ce qu’il y avait du soutien entre femmes, une sorte de sororité comme on l’appellerait aujourd’hui ?
Non, parce que pour qu’il y ait un soutien comme ça, il faut qu’il y ait une espèce de conscience des choses et ça, c’était pas vraiment le cas.
Est-ce qu’il y avait l’inverse ? Se tirer dans les pattes parce qu’on est des femmes ?
Chacune avait des parcours particuliers qu’on soutenait plus ou moins, qu’on voyait plus ou moins de loin, mais il n’y avait pas une entraide. Il y avait des amitiés, des grandes amitiés, mais ce n’était pas une espèce de mouvement collectif qui aurait eu conscience d’un combat genré à mettre en œuvre.
Et je voulais vous dire, peut-être que ça n’a rien à voir, mais c’est assez amusant parce que là, avec le confinement, j’ai mis en place une plateforme numérique que j’ai fabriqué où je n’ai invité que des artistes femmes. J’ai théorisé le fait que l’on n’aurait pas de place en tant que femmes et encore moins avec le confinement. Donc, si vous voulez regarder, c’est assez international et c’est toutes les semaines. Ça s’appelle The Crown – Letter. Parce que vraiment, ce que je trouve paradoxal, mais ça c’est peut-être une autre discussion, c’est qu’à la fois en termes de thématisation, de conscience, les choses ont changé. Mais il me semble malgré tout que dans l’épaisseur de l’expérience au quotidien, ça ne change pas si vite pour les femmes. Dans la plateforme, nous avons des conversations hebdomadaires avec des artistes internationales. Des Indiennes, des Argentines, toutes les semaines on se retrouve, on parle d’art, de nos positions et de comment on vit le confinement, de nos projets possibles, et ce sont des paroles de femmes qui souffrent vraiment, d’être à la maison avec les enfants, etc., enfin de tout ce qu’on connaît.
Le confinement aggrave les choses…
Oui, puisque l’idée d’une chambre à soi, c’était d’avoir un espace intime dans l’espace de la maison et l’espace domestique, c’était l’espace des femmes et maintenant, l’espace domestique devient l’espace de travail. Donc qu’est ce que cela veut dire après ? Où est l’espace de création ?

Anonyme A
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 10.12.20

- Carrière
- Épanouissement
- Silence et parole
- Déséquilibres
- Âge
- Sexisme
- Harcèlements
- Discrimination
- Mandarinat
- Relation aux étudiant·es
- Histoire des créatrices
- Concours
- Écoute
Entretien de
Anonyme A
le 10.12.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Lucile Encrevé
La personne interviewée a préféré l’anonymat, estimant que le danger était toujours présent pour elle dans l’École. Les organisatrices du projet lui apportent tout leur soutien, lui disent toute leur solidarité et rappellent qu’une Charte contre les violences existe désormais à l’École qui protège les acteurs et actrices de l’établissement contre toute violence, physique et/ou verbale : aucune violence ne peut être tolérée et notamment contre les femmes témoignant dans le cadre de ce projet.
Pourrais-tu nous présenter ton parcours dans l’École ?
J'ai été étudiante à l'École. En fait, j'ai d’abord fait les Beaux-Arts de Nancy, puis les Arts Déco, et après la Sorbonne. Un long parcours. Je suis plasticienne. J'ai été prise pour des vacations à l’École en 1988. Je suis restée dix-neuf ans vacataire : normal, pour une femme… Je n'étais pas la seule, il y avait Fabienne [Vansteenkiste, enseignante de 1979 à 2015], on a été très nombreuses à avoir des vacations. On était plus diplômées que les hommes. Moi, j'avais mon époux, qui avait la même formation que moi, qui a eu un poste tout de suite et qui gagnait au moins deux fois mieux sa vie que moi. J'ai été bloquée par un responsable dans l’École, qui était très virulent et violent avec moi. On n'était pas du même bord politique. Et puis mon compagnon était en conflit avec lui. Et comme il ne pouvait rien lui faire (comme c’était un titulaire), il s'est vengé sur moi – les choses ont commencé à se débloquer quand il est parti. Ma carrière, je me dis que c'est parce que je suis une femme qu’elle a été telle qu'elle est, avec une retraite qui va être minable.
Tu as toujours été dans ce qu’on appelle le méridien Expression Plastique ?
Oui, quand je suis entrée pour enseigner, j’ai créé l'atelier de matériaux de synthèse. Ensuite, j'ai glissé vers la sculpture, ensuite vers le dessin. J'ai une formation polyvalente.
Tu étais étudiante à quel moment ?
Je suis arrivée en 1980, en deuxième cycle – avec un diplôme des Beaux-Arts, tu pouvais entrer directement en 2ème cycle, en spécialité – et j'ai passé le diplôme en 82. À Nancy, j'étais en peinture. Ici, j’étais en sculpture (ça s’appelait volume). J'ai fait cette école parce qu’il y avait des moyens incroyables. On avait des thermoformeuses géantes. On pouvait déjà faire de la résine. C'était des moyens financiers et des moyens techniques faramineux. Et puis voilà, c'était Paris.
Quels souvenirs gardes-tu de ces années étudiantes ?
C'était génial. En volume, on était au sous-sol. On était une quinzaine pour les deux années. Il y avait des gens de tous les pays. On devait être deux « franco-françaises » et tous les autres étaient africain, égyptien, grec, russe… Et donc du coup, on était une petite famille, on se faisait à manger dans les fours. Chacun faisait son plat une fois par semaine. On avait un réfugié albanais aussi qui dormait, qui vivait en bas. Si on avait besoin de venir à l'École bosser le week-end, on frappait, le gardien nous ouvrait, on allait dans les ateliers. C'était très, très, très différent à l'époque. Le directeur, c’était Tourlière [Michel ; de 1971 à 1990], on pouvait le voir, aller discuter avec lui dans son bureau – c’était une direction très intègre. C’était une ambiance familiale. Et n'importe qui venait dans l’école.
Une sensation de liberté.
Incroyable. Il n'y avait pas de caméras. Maintenant les gens sont beaucoup plus en couple ou seuls ; nous, on était en bande – pour faire des expos, pour bosser, pour se rencontrer. Il y avait vraiment une vie d'atelier. C'était plus chaleureux.
Sur les quinze étudiants, il y avait combien d'étudiantes ? C'était assez équilibré ?
C'était à peu près équilibré, peut-être un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. Les étudiants masculins étaient des étudiants étrangers.
Et les enseignants en face n'étaient que des hommes ?
Oui, sauf Renée Bossaert [enseignante de 1976 à 2010] qui est à la retraite maintenant. Et il y avait aussi Costanza [Costanza, enseignante de 1981 à 1996] pour les bijoux. Je faisais un travail – du volume, des performances, des installations – sur le corps féminin, je travaillais sur l'identité féminine. J'ai eu beaucoup de mal par rapport à la réception de mon travail, assez engagé, féministe. Renée, qui était sculpteur, c’était un soutien. Elle était ouverte aux différentes pratiques et aux propositions. J'avais aussi comme directeur de mémoire Pierre Cabanne, qui était absolument génial, réceptif et qui m'a vraiment aidée à faire passer mon travail. J'avais fait des coussins-vulves, un endroit qui s'appelait L’Assexoire. Du coup, certains enseignants étaient très choqués.
Ils te le disaient ?
Oui, il y en a qui me l’ont dit. Après, ils n'étaient pas tous comme ça. Il y avait Jean-Claude Bédard, qui était un super prof aussi, qui restait très ouvert et qui m'a bien aidée, orientée. Les autres, ils étaient un peu dépassés : déjà l’art contemporain ce n'était pas leur tasse de thé, alors l’art féminin ou engagé…
Ton mémoire, il portait sur quoi ?
J’avais appelé ça L’instant émotionnel. Je parlais du corps et des réactions, des émotions, comment ça nous traverse. Le mémoire était autour de mon travail parce qu'à l'époque, il y avait cette possibilité qui était d'ailleurs super, ça permettait d'analyser son propre travail, d'avancer, de décortiquer.
Il y a eu, lors de ton jury de diplôme, des remarques sexistes ?
J’en ai entendu bien sûr. Il y avait des réfractaires. J'avais donc conçu un lieu qui s'appelait L’Assexoire [fig.16], il y avait différentes chaises – une chaise miroir, une chaise vulve, une chaise phallique, etc. Tout un tas d'éléments. J'avais conçu aussi des sortes de fausses pâtisseries qui étaient des moulages de fruits et légumes un peu particuliers. Et puis, je rajoutais des fragments de corps féminins moulés, qui étaient des tétons, des vulves, un doigt, des choses comme ça.
Et sinon, tu as subi des gestes déplacés ou des choses plus graves ?
Il y avait un technicien qui était obsédé, lubrique et grossier. On ne se sentait pas menacées parce qu'on était toutes remontées ensemble. On se débrouillait pour n’être jamais toute seule avec lui. À l'époque, jamais on n’aurait dit quoi que ce soit.
Donc tu es sortie en 82 ; quand tu es revenue à l'École pour enseigner, comment ça s'est passé ?
C’était un concours sur les matériaux de synthèse. J'avais beaucoup travaillé avec ces matériaux et j'ai créé ce cours ici, c'était une exploration et une expérimentation des matériaux de synthèse, un cours qui permettait d'appréhender la résine, la Plastiline, différentes techniques et outils à partir de propositions créatives. J'ai été prise sur trois heures. J'étais dans les cours de première année, il n'y avait pas d'aération, c'était un peu compliqué. Et puis, je suis restée comme ça quelques années. Et après ? En fait, j'ai été progressivement vers la sculpture. Des choses plus ouvertes. Je suis restée longtemps en première année. Ce qui est devenu après Expression plastique c'était vraiment très balisé par les mecs, très fermé. Que des hommes. J’étais la seule femme avec Renée Bossaert, qui avait un poste.
Comment tu ressentais ce déséquilibre ? Tu étais écoutée ?
J’étais plutôt à l’aise, ça ne me gênait pas. Moi, j'ai six frères, je suis la seule fille, ça ne m’a jamais mise mal à l’aise. Et j’étais écoutée. Après ils me ridiculisaient un peu sur des choses, mais aussi parce que j'étais jeune. Donc, si tu veux, ils se permettaient de te faire comprendre que tu n'avais pas forcément la maturité, ce qui était plus ou moins vrai…
Tu intervenais en 1ère année ?
Oui, il y avait une équipe super, il y avait [Jean-Paul]Céalis, il y avait [François] Miehe, des gens qui avaient un vrai propos politique et féministe, engagés politiquement, à l’écoute. Comme femmes, il y avait Fabienne, Pascale Gleizes [enseignante de 1972 à 2013]. C'était vraiment super. Même si on n'était pas d'accord, il y avait une écoute, il y avait un échange, on discutait. Je me souviens de réunions, d'assemblées. La salle des profs était pleine, c'était nous qui organisions les réunions. On commençait par un mois qui s'appelait « Perception ». Tous les enseignants travaillaient autour de la notion de perception. Ce n'était pas du tout des exercices académiques. C'était un espace d'expérimentation, de découverte. Moi, j'étais responsable d’un groupe. Et ça, ça a été contesté ensuite complètement par un nouveau groupe d’enseignants masculins.
L’équipe à laquelle tu étais reliée, que j’ai connue et qui est toujours là en partie ?
Oui : des machos finis – une enseignante vacataire est partie parce qu'ils étaient odieux avec elle. Ils l’ont attaquée sur son travail de pédagogue, sur son travail d'artiste. Les femmes, dans les réunions avec cette équipe-là, on n'avait plus la parole. C'était impossible de parler, impossible. Moi, je n'ai pas peur, je prends la parole, et non, on ne pouvait pas. Si tu parlais, ils parlaient plus fort que toi pour qu'on ne t’entende pas. De toute façon, il n'y avait même plus de réunions.
Ce problème avec ce groupe, c'est à partir de quel moment que ça s'est installé dans l'École ?
Depuis les années 1994, 1995. C'est lié à l'arrivée de toute une bande. À l’époque de Peduzzi [Richard; directeur de 1990 à 2002]. Tous ne sont pas méchants, certains se sont laissés entrainer. Il y en avait un qui avait dit que les femmes, en fait, ça ne devait pas être artistes, mais s'occuper d'une maison. Pour te dire à quel point c'était une vision rétrograde. Si tu levais le ton, après tu étais humilié, bafoué. L’ enseignante dont je parlais, elle a eu son armoire forcée, vidée plusieurs fois. Une forme de harcèlement. Avec une autre enseignante, qui a d'ailleurs quitté le secteur au bout de deux, trois ans parce qu'elle ne les supportait plus non plus, on se faisait piquer le matériel qu'on commandait, il n’arrivait jamais. Une fois j'ai passé une commande, un gros stock de papiers pour l’année, il n'y a pas si longtemps, comme je n'étais pas là, à l'entrée ils l'ont porté dans la salle de ce groupe d’enseignants, j'arrive deux jours après pour mes cours, plus de papier (il restait trois rames) ; j'ai dit « Je vais porter plainte, je vais faire quelque chose » ; j'ai vraiment crié, je suis redescendue à l’accueil ; quand on est remontées, ils avaient remis le papier.
Et cette atmosphère, est-ce qu'elle se ressentait dans les relations qu’ils avaient avec d’autres personnes dans l’École ?
Je sais qu'il y a des modèles qui ne veulent plus poser avec un des enseignants, des modèles féminins qui ont été maltraitées psychologiquement et qu'il a fait souffrir physiquement en leur faisant prendre des poses très douloureuses, en tension, en torsion ou même bras en l'air, durant plusieurs heures. Ces modèles refusent maintenant de travailler avec lui.
Et vous, les profs, vous n’avez jamais été agressées physiquement ?
Physiquement non, oralement oui. Avec l’un d’eux, on ne se parle plus du tout – je lui disais bonjour, mais il ne me répondait pas ou il se mettait à siffler. Des tas de petits gestes d'humiliation, pour essayer de mettre l'autre mal à l'aise. On s'en est tous pris plein la figure, hommes ou femmes, plus particulièrement les femmes, quand c'était possible pour eux. Pour les femmes avec qui ils étaient en conflit, ça passait par des façons de les nommer. Sur une prof maigre, j’ai entendu : « Celle-là, elle aurait mieux fait de rester à Dachau ». J’ai entendu des propos homophobes, des attaques homophobes sur certains profs. Plusieurs fois, il y a eu des dérapages et si tu leur disais après, ils disaient « Non, c'est faux ». Au début, ce n'était pas aussi fort. C’est quand l’un d’entre eux a commencé à régner. On m'avait demandé de me présenter comme coordonnatrice et de prendre le relais. Et là, j'ai été menacée par lui, il m’a fait comprendre qu’il n’y avait pas de place pour deux candidats. Un enseignant, parce qu’il était ami avec un autre, a été humilié de manière incroyable – ils lui disaient que son cours était nul, qu’il était nul, devant tout le monde, dès qu’il prenait la parole, ils lui coupaient la parole et se moquaient de lui, ils rigolaient. Ils ont essayé de le faire virer. Il avait « trahi la cause » (celle de leurs propres personnes j’imagine).
Il y a un côté genré, non ? Les hommes attaqués, ils devaient être considérés par ce groupe comme féminins. Des hommes non-violents.
Bienveillants.
Pas des gens qui vont aller au combat. Après ça, j’ai cessé d’aller aux réunions. On a été quelques-uns à cesser d'aller aux réunions parce que ça ne servait à rien, ce n'était que des injures, tout était tourné en dérision. Ils étaient carrément réactionnaires, très, très rétrogrades. Pas seulement par rapport au genre, mais sur l'art contemporain. Pour eux, les cours c'était de faire uniquement du dessin avec un trait, un crayon, un support. Si tu travaillais avec la lumière, avec le corps, ça ne passait pas… et ça continue, par exemple avec une enseignante qui fait un cours d’expression corporelle – je les ai entendu dire : « Comme si ça pouvait être un cours ! ». J'ai fait un cours avec elle parce que la conscientisation du corps est importante, tout ce qui est de l'ordre du sensoriel – le rapport entre le corps vu, dessiné, le corps ressenti, expérimenté, etc… Ils ne le savent pas, que j'ai travaillé avec elle… On fait ça en première année, dont ils se sont retirés, sauf pour le dessin. En première année, on travaille en collégial. C'est hyper enrichissant, pour tout le monde.
L’équipe pédagogique est très masculine en 1ère année, non ?
C'est vrai qu'on est très, très peu de femmes. Et du coup, je pense qu’ils m'ont demandé de remplacer un des enseignants comme responsable d’un groupe parce que ça permettait à la direction de faire un pseudo équilibre. Après il y a des profs super, ils sont vraiment adorables, comme Gérald [Petit]. Mais pour les élèves fragiles, c'est plus facile d'être en face d'une femme, je pense, et ils disent les choses plus simplement, plus facilement.
Les étudiantes, tu as l'impression qu'elles se confient plus à toi ?
Oui c’est vrai. Les femmes (les garçons aussi ça fonctionne, mais les femmes particulièrement), il y en a beaucoup qui ont des problèmes, surtout en ce moment, avec le confinement. C'est assez violent et c'est assez violent pour les premières années. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont en grande détresse.
Et tu leur parles de ton engagement féministe, de tes œuvres ?
Non, pas du tout. Je n'ai jamais voulu mélanger. Quand j'étais enseignante en sculpture, je travaillais plutôt l'image, le dessin, les installations, les sérigraphies, etc. Maintenant que je suis en dessin, je travaille plutôt la sculpture. Ça me permet de dissocier mon univers de création personnelle de mon univers pédagogique parce que je trouve que le travail pédagogique est très invasif et c'est vrai que quand tu suis un élève, que tu suis sa production, que tu suis son travail, moi ça m'habite. Et du coup, le fait d'avoir un travail qui est dans un autre registre fait que quand tu rentres dans l’atelier tu n’es plus ailleurs que là ; ça, c'est une chose. Et puis aussi, je ne veux pas avoir d'influence sur leur créativité en dehors de celle de mon intervention pédagogique, pas d’influence en tant qu’artiste.
J'ai l'impression que nos profs hommes nous ont beaucoup plus parlé de leur travail que les femmes. Ils ont moins cette pudeur de ne pas parler de leur travail et même parfois, ils nous impliquent dans leurs projets…
C’est un choix éthique.
Et est-ce que tu leur parles de femmes artistes ?
Énormément. Dans mes documents, j’ai une majorité de femmes, qui travaillent le dessin ou l’image. Il y a quand même une révélation plus évidente aujourd'hui des artistes femmes, qui n'existait pas au début.
Dans les jurys, tu trouvais le rapport hommes/femmes équilibré ?
Non, pendant des années, ce n’était pas des jurys équilibrés. Il y avait un prof en Sciences-humaines, je me souviens d’un jury, il maltraitait les candidats, je lui ai dit. Il était agressif avec la candidate, c’était terrible, c’était d’une violence inouïe. Il démontait le travail. Il portait un regard critique très violent. « Ça, c'est nul. Je vous dis, c'est nul » : tu ne dis pas ça, c'était insupportable.
Tu nous as parlé des relations entre profs, et avec les responsables d’atelier, le rapport femme/hommes, c’était un problème ?
Oui, au début. Quand tu es jeune, tu es prise pour une petite rigolote et puis toi, tu ne sais pas faire – lui, il sait faire, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave… C'est toujours un peu déstabilisant puisque tu n’es pas accueillie à bras ouverts. En prenant de la bouteille, en vieillissant, la donne change. Je me suis dit qu'il y avait des combats à mener, à moi de les choisir. Mon choix, c'était la pédagogie, qui me passionnait. Et j'avais ma création. Je préférais placer mon énergie là-dedans plutôt que d'aller vers des combats perdus d'avance, comme avec le groupe d’enseignants dont je parlais avant.
Il y a des directeurs qui t’ont soutenue ? C‘est fou que l’institution n’ait pas réagi, pendant 20 ans.
Oui, c’est les effets du boys’ club il me semble, ça se retrouve dans pas mal de milieux.
Raynaud [Patrick ; directeur, 2002-2008] m’a soutenue. Il m'a invitée à discuter avec lui dans son bureau. C'était une vraie écoute, une première écoute. On a parlé pédagogie pendant une heure, on a échangé sur mon statut. Et j’ai eu un contrat. Le premier qui a vraiment réagi par rapport au club des enseignants machos, c'est Partouche [Marc; directeur de 2014 de 2018].
Avant, vous vous taisiez ?
C'est vrai qu'on se taisait. On se taisait parce que sinon, tu risquais trop, tu allais passer à la casserole. Je n'étais pas tremblante, mais j'ai été menacée, comme l’autre enseignante. D'ailleurs, on a eu des représailles, on a eu des salles pourries. On n'avait pas le droit d'avoir une armoire. Quand Julien [Bohdanowicz, directeur des études depuis 2017] est arrivé, ça a changé complètement. Je lui ai dit : « Ça fait dix ans que j'ai une salle pourrie, je ne peux pas avoir une salle normale ? ». Il a été vraiment super. Il a été un vrai soutien, il a compris le problème. Il n’a pas eu peur de l’affrontement. Alors le groupe a menacé de le faire virer. Emmanuel Tibloux [directeur actuel, depuis 2018] m’a aussi apporté tout son soutien. C’est difficile de choisir de dire les choses et de se défendre, il n’y avait pas d’endroit, pas de relais dans l’École.
Avant, vous aviez peur ?
Oui, oui, bien sûr, il y avait une peur. Ils pouvaient hurler, ça pouvait être très violent. Tu cherches à fuir – mais je n’ai pas pu. Il y avait une appréhension assez forte tout le temps, j'évitais de les rencontrer, j'évitais de les voir, j'évitais de les croiser. Je venais un petit peu avant mon heure pour sortir mon papier pour ne pas les croiser quand j'allais chercher mon papier dans la salle dans laquelle ils pouvaient se trouver. Quand on sentait qu'il y avait des tensions, on décalait nos arrivées, on arrivait avant, ou après. On se débrouillait pour ne pas avoir à les rencontrer. On avait mis en place, tous, des stratégies pour éviter la confrontation. On n’était même plus conscients. C'était des systèmes, des façons de fonctionner. On était conditionnés. En en parlant, je me dis, c’est vrai, il y avait quand même cette peur. Je reprends conscience de ça. C'est vrai que si on avait mis tout ça en place, c'est parce qu'il y avait une peur. De l’un d’eux, j'ai vraiment eu peur… ce n’était pas qu’une perception fugace – l’autre enseignante aussi, peur physiquement, on n'était pas fières. Il piquait des crises. Les autres, j'ai eu peur de la parole. Peur de la violence verbale, pas physique.
Est-ce que le fait que ton compagnon soit dans l'école a été protecteur par rapport à eux puisqu'ils sont dans un système à l'ancienne ?
Oui, absolument, ça me protégeait. C’était quelqu'un de présent dans l'école, très engagé, assez connu à l’époque.
Et porter plainte, tu y as pensé ?
Non. On a mis des stratégies en place pour se protéger, on n’a jamais pensé, les uns et les autres, à faire plus que ça, à mettre en route des choses plus efficaces, des plaintes et des témoignages qui auraient peut-être pu les calmer et puis voilà, on a pris le pli, l'habitude de vivre avec ça, avec ces menaces et ces intimidations permanentes.
Mais tu as quand même pu t’épanouir dans l’École ?
Oui, complètement, dans la pédagogie. Avec les étudiants, et avec tous les autres collègues. J'ai toujours adoré ça. J'ai adoré cette école, c’est un bon creuset, j'ai adoré les élèves, les collègues, les échanges qu'on a. C'est excitant, c'est intéressant tout ce qui se passe, même aujourd’hui avec la Covid qui nous amène à repenser et à modifier nos cours, nos perceptions, nos façons de fonctionner, de créer.

Maureen Béguin
étudiante
de 2013 à 2018
avec
Alexandra Piat
le 15.12.20

- Identité de genre
- Rôles genrés
- Silence et parole
- Émotions
- Mysogynie
- Sexisme
- Manque de collectif
- Résister
Entretien de
Maureen Béguin
étudiante de 2013 à 2018
le 15.12.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Maureen Béguin, mon nom d’artiste est Maureen Morin. Je suis une personne queer, j’aime bien dire aussi womxn, avec un X. C’est comme ça que je me définis dans ma biographie en tout cas. Et je réponds par « elle » pour le moment. Je n’ai pas trop de préférence — je me maquille beaucoup en homme aussi, j’aime beaucoup passer de la féminité à la masculinité. C’est quelque chose qui fait partie de mon travail, sous ce nom de Maureen Morin particulièrement. Je suis rentrée aux Arts Déco quand j’avais à peine dix-huit ans après un bac général et je suis rentrée d’ailleurs grâce à un de mes personnages, qui était un homme, lors de mon entretien. C’était assez particulier. Je suis ressortie des Arts Déco en 2018 avec un diplôme de scénographie, mon Grand Projet était aussi une performance, avec ma collègue Morgane Le Doze. On s’appelle le « Mmmh group ». On se définit toutes les deux comme des personnes queer. Et maintenant, je travaille en tant que performeuse, artiste plasticienne et scénographe. Aujourd’hui mon travail évolue énormément parce que je suis très intéressée par la pédagogie. Je suis professeure, je donne des cours d’arts plastiques dans un lycée, mais je suis aussi prof de performance dans une école de théâtre. Et tout mon travail porte sur une pédagogie qui est bienveillante ce qui vient un peu du fait que j’étais très en colère aux Arts Déco. J’ai vraiment eu beaucoup de mal avec la pédagogie en art que j’ai pu recevoir pendant tout mon parcours à l’Ensad et que j’ai vue autrement en partant en Erasmus, où j’ai rencontré une pédagogie un peu nouvelle et un peu différente. Et depuis, mon mémoire porte sur ce sujet [MASSE EMOI, sous la direction de Marc Thébault, 2017], mon diplôme porte aussi là-dessus, sur comment repenser l’éducation et le travail, pour tous les âges. Comment repenser l’éducation comme un espace bienveillant, comme un espace de positivité, d’égalité entre toutes personnes, quelles qu’elles soient. C’est mon axe de travail en ce moment : comment changer les rapports entre nous, humains, au travers de l’éducation.
J’ai envie de commencer par le début, tu parlais du concours d’entrée. Est-ce que tu peux m’en dire plus sur ce personnage que tu as joué et pourquoi tu as fait ça ?
Mon oral des Arts Déco, c’est un peu une blague maintenant avec mes amis, et même avec mes profs. Je n’ai pas dit que j’étais Maureen Béguin. J’ai transformé mon identité, je m’appelais le professeur Vladilostock, quelque chose comme ça. Je m’étais créé un pseudonyme, un alias d’un professeur pseudo scientifique, puisque tout mon projet portait autour du superficiel et du fait que je cachais mon identité. Je me présentais comme un homme, un peu un « cis het » [cisgenre et hétérosexuel] de cinquante ans. Ça n’avait aucun sens, mais j’avais un costume et tout et je suis arrivée le jour de mon entretien et je me suis présentée comme ça « Je suis le docteur Vladilostock ». « Mais vous n’êtes pas Maureen Béguin ? » « Non, non, pas du tout ». Ça a foutu vachement la pagaille parce qu’ils me disaient « Mais vous êtes qui ? » et ils insistaient : « Vous êtes Maureen », et je disais « Non, je ne suis pas Maureen, je ne sais pas qui c’est ! », etc. Ils essayaient de trouver mon nom donc, à un moment, je leur ai dit : « Non, en fait c’est une performance, essayez de jouer le jeu ». Et eux ils disaient « Non, vous devez vous présenter comme une élève normale, comme une élève d’art normale ». Ça m’avait vachement choquée à l’époque. Je me disais « Je ne sais pas ce que c’est, une élève d’art normale ». À l’époque, je faisais beaucoup de théâtre et c’était ma seule façon d’arriver à présenter de l’art parce que je n’avais jamais fait vraiment d’arts plastiques. J’avais fait du dessin, mais ce qui m’intéressait c’était ce rapport entre art et théâtre. J’étais super choquée de devoir m’asseoir et expliquer ma petite boîte en carton [dans laquelle l’étudiante donne sa réponse au sujet donné lors du concours]. Au bout de vingt minutes, ils n’en pouvaient plus de moi et m’ont dit de partir. Je suis restée, j’ai dit « Non, en fait, vous ne savez pas du tout ce qu’est mon travail, c’est hyper blessant » et je me rappelle que je m’étais beaucoup énervée, j’étais restée quarante minutes à mon entretien et au final, je pense que c’est ça qui leur a plu. Mais dès mon entrée, je me rappelle m’être battue pour faire de la performance et que c’était hyper mal vu.
C’est marrant parce que tu as vraiment tenu bon pour qu’ils t’écoutent !
Oui, en fait, je m’étais dit que c’était totalement injuste parce que j’avais dix-sept ans, j’avais fait de l’art quand même, mais je ne savais pas trop ce qu’on attendait de moi. J’avais tenté le concours juste comme ça pour voir le niveau et ce qu’on attendait. À toutes les étapes, ce qui leur plaisait, c’est que je faisais autre chose que des arts plastiques. Je me rappelle qu’un de mes jurés a été un de mes profs après. Il était super traditionaliste. Bref, il était obsédé par la féminité, les jeunes femmes, dans les pubs, enfin ses cours étaient une catastrophe. Pendant mon concours il était saoulé parce qu’on devait faire une analyse d’image et une analyse de texte. Je ne savais pas comment faire donc j’ai un peu fait à la louche. Il me disait par exemple : « Mais vous ne connaissez rien », etc. Je lui ai répondu que j’étais dans une école pour apprendre.
Je me rappelle que tu avais aussi témoigné dans mon mémoire. Je crois même que je t’ai citée à au moins un endroit. Et ce qui m’avait marquée, c’est que tu sembles avoir eu des problèmes souvent avec des profs qui cataloguaient ton travail comme masculin parce que tu utilisais certains médiums, certains matériaux, etc. Est-ce que tu peux m’en dire plus sur ce rapport à ton travail ?
Alors c’était surtout dans les oraux. Ce n’était pas forcément par rapport aux matériaux, c’était plus dans mon attitude vis-à-vis d’eux, genre « Tu poses tes couilles sur la table ! » mais sans vraiment le dire. Il y avait un prof en particulier qui passait son temps à dire « Maureen fait un peu le mec ». Je n’étais pas effrontée, mais j’avais confiance en ce que je disais et j’amenais les choses. Une fois, un prof m’avait dit « C’est dommage, parce que tu es une femme, en fait. Tu pourrais amener un peu plus de douceur ». Ça m’avait beaucoup énervée. On me demandait de la douceur dans mon travail, surtout par rapport à certaines performances.
J’ai l’impression qu’on a voulu vraiment te mettre dans une case ou dans un rôle vraiment particulier à chaque fois que tu sortais un petit peu de ce rôle un peu cliché des femmes qui doivent être sages, douces et gentilles.
Je me suis rendu compte que dans ma classe, faire du bruit ou faire des vagues ne passait pas trop. J’avais des potes qui me disaient « Maureen, calme le jeu, ce n’est pas grave, on laisse passer ». Et en fait, c’était horrible parce qu’il y avait même une pression entre nous et je m’en suis rendu compte en sortant. Moi je disais « Il faut le dire, il faut aller voir le directeur des études, il faut qu’on écrive une lettre, il faut faire quelque chose ». C’était super dur parce que j’avais l’impression que c’était normal, que ça allait passer, sauf que ce n’était pas normal. Mais tout le monde disait « Non il faut faire un peu profil bas il faut quand même qu’on ait notre diplôme ». J’étais au CER [Conseil des Études et de la Recherche], au CA [Conseil d’Administration] et j’avais trop envie de faire une différence et en même temps, il y avait cette pression aussi de l’école : « Tu dois réussir ton diplôme, tu dois bien faire les choses ». Dans ma classe, personne n’a élevé la voix. Alors qu’on nous a quand même dit des trucs inimaginables ! On avait quand même des remarques misogynes et sexistes en cours de scénographie parce qu’on était des femmes à faire un travail « d’hommes », de construction.
Tu n’as pas eu l’impression d’être très soutenue dans ta classe par rapport à toutes ces questions ?
Non… Ce n’est pas contre elles, je ne suis pas du tout en train de leur en vouloir. Ce sont des femmes incroyables, des supers personnes. Mais c’est vrai qu’il y avait ce truc-là : « Écoute, oui, il est misogyne, oui, il est sexiste ce prof, oui, c’est horrible ! Mais bon, qu’est-ce que tu veux faire ? »
Une année un prof avait été vraiment blessant, il avait un niveau de bêtise au sujet des questions de genre qui était affolant. Moi j’ai pleuré après un cours tellement j’étais mal. Mais quand on a essayé de se plaindre, j’ai vraiment eu l’impression que les autres profs ne « pouvaient » rien faire… Que c’était des questions un peu politiques et qu’il y avait de la peur d’agir, peut-être de se mettre des gens à dos. Ça me rend super émotionnelle en fait. C’était un peu dur de se rendre compte que même le reste de l’équipe était incapable de faire quelque chose par rapport à un prof qu’ils connaissaient comme étant problématique depuis plusieurs années.
Ça rend un peu impuissant…
Oui carrément !
Tu n’as jamais été en parler plus haut que ces profs ? Tu n’as pas utilisé le CER ou alors directement le directeur des études ou autres ?
J’ai eu plusieurs changements de directeurs d’études, ce qui n’a pas aidé. Quand j’étais en première, deuxième et troisième année, j’étais au CER et CA et je me rappelle avoir élevé plusieurs fois la voix sur certains sujets. Pas forcément le sujet des genres, parce que je n’étais pas encore au courant de tout ça. Mais c’était plus par rapport à des trucs pédagogiques où j’étais très, très en colère. Et en fait, j’étais rarement vraiment écoutée au CER et au CA. Je me rappelle avoir dit quelque chose au sujet d’enseignants de ma section, par rapport à comment ils étaient tout le temps dans le négatif, à ne pas vraiment nous soutenir. J’ai dit ça à d’autres professeurs qui me disaient « Non, mais il est incroyable ce prof, tu ne peux pas dire ça ! » J’ai toujours été aussi un peu rabaissée. Ou vue comme quelqu’un de très émotionnel, de très réactif. Ce qui est ma personnalité, c’est comme ça, mais j’ai toujours été très… pas en colère, mais très énervée en CA et en CER face à des profs qui disaient « Bon, ce n’est pas un lieu d’émotion ici. » Alors que j’étais représentante des élèves, que je m’exprimais par rapport à plusieurs témoignages que je recevais, c’est quand même dur et je suis artiste, je ne suis pas politicienne et je pense même qu’il peut y avoir de l’émotion dans la politique. Bref, au final j’étais mal à l’aise dans ces contextes-là. Donc, je suis partie au bout de deux ans. On écoutait plus mon collègue homme pour le coup parce que lui était moins émotionnel que moi. Aussi un responsable des études à l’époque qui m’a dit que j’avais des professeurs incroyables, quand j’allais lui parler de ce qui n’allait pas. Et je ne lui faisais pas vraiment confiance.
Et ce prof donc, est-ce que tu accepterais de parler un peu plus de ce qu’il a dit ou fait ?
C’est un prof qui lors de déplacements dans le cadre de l’école a été très problématique. Il faisait des propos déplacés, qui sous couvert de nous faire plaisir étaient gênants et graves. On le trouvait très lourd et on essayait de lui dire que ce n’était pas possible de dire ces trucs-là, mais il répondait qu’il n’était pas un enfant… Dans sa pédagogie aussi, on analysait des œuvres très sexistes et misogynes, qui véhiculaient beaucoup la culture du viol en nous disant que c’était des chefs d’œuvres. Nous on essayait de déconstruire ça en parlant de constructions sociales autour du soi-disant fantasme des femmes à être violée, mais il nous renvoyait à son autorité de prof et affirmait que c’était ancré dans la femme. Et puis il avait des regards gênants sur des potes, il faisait passer plein de choses pour des blagues.
Il y a un autre prof qui est aussi très problématique en termes de pédagogie et de sexisme. On était huit femmes et il a dit devant les troisièmes années « Il y a tellement de femmes en scénographie, c’est vraiment parce que vous avez trouvé un mari riche ». Tu te dis « Mais quoi ?! » Tu es face à ça, c’est ton premier jour, et il y avait deux autres profs femmes qui étaient là et qui ont rigolé à cette blague. Toi tu te dis « Mais je suis où ? » Et en même temps, tu ne veux pas passer direct pour ce qu’on a pu me dire après, un peu la casse couilles. J’étais consternée, on était toutes en état de choc. Après c’était assez récurrent ces réflexions genre « Toutes ces femmes ! » ou « Vous savez, en salle noire il y a des machines, hein ! ». En atelier ça n’aide pas parce que quand tu es une femme qui arrive avec des bottines à talons en salle noire on te dit tout de suite « Ah c’est comme ça que tu viens faire de la construction ? » Moi personne ne m’a dit qu’il fallait que je vienne avec des chaussures de construction, personne ne m’a appris.[fig.17] Il n’y avait pas forcément de douceur ou de bienveillance. Même la façon dont on apprend les machines, c’est quelque chose de super masculin, on te dit « Vas-y, prends confiance ! » En plus de ça, il y a toujours eu un peu ce truc de l’enfant roi pour les mecs en Scéno parce qu’il y en a très peu. Quand il y en a, on te dit « Lui, il va te montrer ! » Après ils endossent ce rôle aussi et c’est une pression pour eux.
Est-ce que les profs femmes de la section sont un réconfort ?
Il n’y a pas trop de réconfort. Une d’elles a quand même dit à un prof qu’on avait parlé de notre contraception. Mais pourquoi aller lui dire ça ? En bilan de fin d’année, il vient nous dire « Bon alors, par contre, le stérilet, c’est pour celles qui sont déjà tombées enceintes ». Mais on est où là ? Ce n’est pas l’époque féodale et ce n’est pas notre père. Je me disais qu’il fallait dire quelque chose et en même temps tu n’as pas vraiment de preuves, tu vois. Mais ça, c’est des choses qu’il faut dire pour que ça ne se reproduise pas. C’est une école qui est un peu individualiste et assez égoïste souvent. Comme il n’y a pas de preuve, tu es tout seul avec ce témoignage et tu ne sais pas trop quoi en faire. Plus tu grandis, plus tu te rends compte que ce n’est pas normal en fait. J’espère que ça ne se reproduit plus, peut-être qu’on était juste une année particulière… J’ai du mal à y croire. Vraiment, il se comportait de manière très paternaliste et c’était vraiment dur. J’ai assisté à une scène particulièrement humiliante pour une de mes camarades.
Je suis choquée… Dans les ateliers comment ça se passait ? Vous vous sentiez un peu libre d’aller partout, de faire ce que vous vouliez ?
Dans certains ateliers, il y a un peu ce truc de « techos » [technicien·ne], c’est un peu malheureux, c’est là depuis longtemps, mais voilà il faut avoir super confiance en soi, il faut être super assurée, un peu grande gueule. Mais je sais que, par exemple, dans un des ateliers il fallait endosser un rôle. J’avais un grand ami à moi qui était en Scéno et qui avait fait beaucoup de construction avant et avait vraiment endossé ce rôle de « techos ». C’est lui qui m’a formée. Pendant super longtemps j’ai pris ce rôle-là un peu en mode « Ah ouais tu sais pas utiliser une scie circulaire ?! » Je ne suis plus du tout comme ça, mais c’était une façon de se protéger, d’être « un techos », ce qui était forcément un rôle masculin. Dire qu’on savait faire, sortir plein de noms d’outils. C’était un peu comme ça que tu arrivais à être scénographe. Moi j’ai toujours eu une grande confiance en moi. J’ai toujours été un peu rentre-dedans, donc j’ai réussi à me faufiler. Mais c’est vrai que tu dois toujours jouer un jeu. Il y en a qui ont réussi sans le faire et je trouve ça admirable. Je sais que moi, j’avais besoin d’avoir une façade, et je le fais encore parfois face aux outils, où je suis obligée de me mettre dans cette posture de « Je sais faire ! Je connais ! ». Alors qu’on pourrait avoir une approche beaucoup plus chouette et douce et compréhensive. J’ai plein de copines qui avaient peur des machines, ce qui est complètement normal, c’est hyper flippant. C’était vachement vu comme un truc de « fifille ». Maintenant elles n’y touchent plus du tout.
Sinon, en dehors des cadres un peu scolaires, dans la vie de l’école, est-ce que tu as senti, que ce soit dans ta classe ou dans l’école en général, un soutien, une sororité ? Quelque chose de l’ordre de la communauté dans l’école ou pas vraiment ?
Déjà, je le sentais auprès de certains professeurs d’histoire de l’art et de sciences sociales, enfin, des cours de HTC [Histoire Théorie Critique]. J’ai trouvé que je pouvais avoir des discussions assez intéressantes avec ces personnes-là qui étaient quand même des personnes plus ouvertes aussi je trouve. J’ai eu des cours extraordinaires. Moi après, je suis partie un peu au moment où le genre est arrivé dans certains cours. J’ai loupé un coche donc là je rattrape comme une éducation que je n’ai pas eue autour de ça et qui me fascine complètement et depuis très longtemps.
Sinon pour ce qui est des étudiant·es, c’est vrai que j’ai quand même une bande de copines, de femmes avec moi et même après, de mecs qui ont commencé à écouter nos témoignages aussi. Mais ça, c’est vraiment arrivé en dernière année je trouve, après le mémoire, après qu’il y ait eu un gros moment d’introspection. C’est grâce à mon Erasmus, parce que j’y ai eu des professeurs extraordinaires, ce qui m’a rendue plus forte quand je suis revenue. C’est vrai qu’on commençait à plus ouvrir la parole à ce moment-là. Moi j’ai toujours rencontré des gens d’autres générations, vu que je dirigeais le club Théâtre-performance. Donc c’était vraiment comme ça que j’ai pu me faire un petit réseau et me rendre compte de ces témoignages-là, il y avait aussi pas mal d’histoires autour du sexisme, du genre, etc., c’était vraiment chouette, donc c’est vrai qu’on en parlait entre nous. Mais c’était un peu secret en fait, à l’administration jamais, avec les professeurs jamais. Entre élèves si, forcément, et de plus en plus maintenant.
Je crois qu’on s’était vues une fois à une petite réunion en salle de première année, au moment où tout le monde faisait la révolution. Je ne me rappelle plus vraiment de quoi on avait discuté ce jour-là, mais je me rappelle un peu de cette période d’ébullition où il a commencé à y avoir des choses qui étaient dites. Qu’est-ce que t’as ressenti à ce moment-là ?
Surtout, j’étais tellement heureuse. Je sais que moi, j’ai toujours eu cette envie un peu vive et émotionnelle où je voulais créer du collectif. Je suis persuadée que c’est la chose qui va changer le monde. C’est pour ça que je travaille sur l’éducation et que je trouve que c’est quand même une école très, très égoïste et qui nous individualise vachement. Ce n’est pas la faute des Arts Déco spécifiquement, c’est comment les cours sont construits. Il n’y a pas du tout d’interdisciplinarité. Il y un truc où on est noté, on est chacun mis dans nos petits projets, notre bulle et pas du tout axé sur l’extérieur ou sur l’écologie (n’en parlons pas !), sur le féminisme ça commence à venir, mais bon. J’avais ce fantasme d’école d’art qui était complètement dans le collectif. Bref, c’est un problème qui est un peu plus gros et je me rappelle qu’à l’époque il y avait plein d’initiatives… mais ça s’est toujours effondré.
Je ne sais pas si j’étais déjà représentante au CER, mais c’est un peu à ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser à faire bouger des choses dans l’école. D’ailleurs, on avait participé à la dynamique « écrivons sur les murs » en écrivant des phrases sexistes qu’avaient dites nos profs, sur les murs du troisième étage.
C’est trop trop bien !! Parce que nous il y avait quand même des initiatives dans ma promo, il y avait le fanzine avec Bérénice [Motais de Narbonne], il y avait des fanzines féministes [fig.18]. Oui Les Vulvettes [Underground], mais encore une fois c’était des petites initiatives qui sont restées en suspens. Aussi parfois on nous posait des questions, est-ce que vous avez déjà vécu des violences dans le monde de l’art ? Et moi, je sais que j’en ai vécu pas mal et que c’était au travers de ces fanzines que j’ai trouvé un peu de soutien et de la compréhension. Mais c’est vrai que par exemple, quand j’étais à l’école j’ai toujours voulu me mettre dans des collectifs, des assos. J’ai été au BDE [Bureau Des Élèves] et dans une autre association pour pouvoir créer des expos. À chaque fois, je me suis battue pour avoir un rapport ultra égalitaire et équitable pour les expos, entre hommes et femmes. Je passe mon temps à dire « Il faut plus de femmes, il faut les trouver. Il faut faire un appel à projets parce que c’est par l’appel à projets qu’on découvre ces personnes-là. » Maintenant, la réponse est souvent : « Mais pourquoi on est obligés de faire des appels à projets ? On peut juste prendre les potes, etc. » En fait, je trouve que ça crée aussi le « boy’s club ». Le fait de ne pas faire des appels à projets parce que tu mets tous tes potes.
Oui la cooptation est très mauvaise pour les femmes.
C’est horrible. J’ai l’impression de me faire un peu humilier… C’est pour ça que j’ai de plus en plus de mal, et je suis très émotionnelle quand j’en parle. J’ai toujours un peu cette honte et cette culpabilité à chaque fois de vouloir ramener ce sujet-là : « Il faut vraiment que pour chaque expo il y ait minimum 50% de femmes dans le projet et dans le commissariat il doit forcément y avoir une femme et un homme ». Tout le monde me regarde avec des gros yeux. « C’est bon on n’est pas obligé. Pourquoi est-ce qu’on doit forcément avoir un truc aussi cadré ? » Moi ça me tue ! C’est obligatoire en fait !
Je trouve que tu dépenses de l’énergie à essayer de faire venir des femmes parce que c’est légitime de le demander. Sauf que tout ce temps que tu passes à essayer de les convaincre qu’il faut des femmes, c’est du temps que tu devrais consacrer vraiment au commissariat de l’expo : pour choisir les bonnes personnes. Tant que les gens ne comprennent pas, tu perds du temps.
Oui. Il y en a marre de faire de l’éducation permanente. Je trouve qu’il n’y a pas une éducation de ça aux Arts Déco. On nous dit tout le temps qu’il y a plus de femmes qui tentent le concours, mais qu’il faut quand même des mecs. Je ne sais pas, il y a quelque chose, à la base, qui n’est pas équitable, pas égalitaire dans l’école ; rien que par la sélection.
Oui, c’est quelque chose dont j’ai parlé dans mon mémoire [Sexisme aux Arts Décoratifs, lutter pour l’égalité, dirigé par Lucile Encrevé, 2019] [fig.19] avec quelques statistiques qui prouvent effectivement que ce n’est pas juste une vue de l’esprit. Il y a vraiment eu pendant plusieurs années une discrimination positive à l’égard des garçons.
Je l’ai lu oui ! Et nous on le ressentait en scénographie, parce que tous les gens qui avaient réussi en sortant de l’école, à l’époque où moi j’étais en deuxième année, tous les gens dont on parlait des diplômes c’était des garçons. En plus, ils étaient plus nombreux à l’époque. Nous étions dans une génération de transition où pendant deux, trois, quatre années, il n’y a eu que des femmes en scéno. Comme s’il y avait besoin de cet équilibre-là pour avoir une bonne classe. Forcément mes deux collègues et moi on est devenues le côté masculin dont il y avait besoin, c’est un peu de là que vient le truc masculin. Il y avait besoin d’un mec, et ce mec, c’était nous. Parce qu’on « cassait l’ambiance en soirée », c’était vraiment ça.
Les fameuses casseuses d’ambiance !!
L’une d’elles fait beaucoup de moto, donc, pour le coup, on lui colle une étiquette masculine. Elle arrive avec sa moto, elle est passionnée d’outils, elle a endossé ce rôle-là de la meuf ultra forte. Je me rappelle qu’un prof n’arrêtait pas de lui faire des remarques du genre : « Ah ouais c’est telle moto ! C’est un peu gros quand même pour une fille aussi menue que toi ». Elle avait répondu « Non, j’arrive à la porter ma moto ! » Il y avait toujours cette guéguerre de qui est vraiment un mec quoi !
Sinon, tu m’en as déjà cité beaucoup, mais en dehors de tout ce que tu m’as déjà dit, est-ce que tu as déjà été témoin ou victime de choses que tu qualifierais de violences sexistes ?
Il y a beaucoup de souvenirs que j’ai enfouis, pour passer une bonne scolarité. Des choses que tu préfères oublier. C’était plus sur le long terme : plein de petites remarques qui créent cette violence. Ce qui pour moi a créé vraiment une grande colère et une grande rage. Plus qu’un truc très violent qui était unique où la personne se serait excusée, en fait c’était vraiment à étapes régulières de petites réflexions qui, à l’époque, m’énervaient, mais me paraissaient normales parce que je n’étais pas encore assez réveillée sur le sujet. J’ai l’impression qu’on était cette génération qui avons vécu #metoo et on galérait à comprendre ce qu’on vivait. Puis, les professeurs femmes n’étaient pas vraiment des alliées pour nous parler de tout ça. Ça n’a jamais été abordé en cours. C’est à l’école que tu veux apprendre ces choses et il n’y avait pas cet apprentissage-là de ce que c’est d’être une femme artiste. On savait juste que les femmes réussissaient moins en sortant, il y avait déjà plusieurs infos qui me disaient que je n’allais pas réussir. Comme s’il allait falloir être une sorte de sur-femme, ce que j’appelais à l’époque les « femmes dragons ». J’ai fait des stages avec des femmes comme ça, elles sont plus qu’un homme en restant une femme. Tu es une femme désagréable, qui doit être plus forte qu’un homme. Ça, c’est ce qu’on m’a appris et que maintenant je déteste complètement. Je trouve ça stupide. J’ai été une femme dragon pendant un moment et ce n’était pas vivable, c’est trop violent. Malgré le fait que ce soit une école d’art, ce n’est pas vraiment une école de l’émotion non plus, qui est vue encore comme une faiblesse.
Est-ce que dans les cours quels qu’ils soient, studio, secteur ou autres, on te parlait d’artistes femmes ?
Pas du tout ! Très très peu, et d’ailleurs, c’est marrant parce que je suis prof maintenant et en fait je regarde tous mes anciens cours d’histoire de l’art et j’essaye de faire des cours où je mets 50% de femmes et 50% d’hommes, parfois plus de femmes que d’hommes. C’est une galère sans nom. Je passe mon temps sur le site Aware ou sur des sites d’artistes femmes pour essayer de les mettre dans mes cours. Je suis en plein apprentissage sur des femmes artistes dont je n’avais jamais entendu parler et qui sont exceptionnelles. Mais non, on ne parlait pas des femmes artistes dans l’école.
Je pense que c’est une des choses qui contribuent au fait que la seule figure de femme respectable, c’est la femme dragon et le reste c’est des hommes. Si tu n’as pas d’éléments de représentation différents, forcément, c’est le seul modèle vers lequel tu peux aller.
En scénographie ce n’était que des hommes aussi dont on nous parlait. Il y avait un truc vraiment bizarre qui nous faisait ressentir qu’en tant que femme on n’y avait pas trop notre place. À la base, la scénographie, ce n’est pas vraiment un endroit où tu réussis, sauf quand tu as cinquante ans, que tu es blanc et que tu es un mec. On était un peu maudites. Sur les cinq dernières années, combien ont « réussi » au sens de gagner sa vie ? D’ailleurs, le seul bouquin de référence qu’on avait c’était Les plus grands scénographes de France, c’est surtout des hommes et, en annexe, quelques femmes. C’est-à-dire que moi, dans toutes les références qu’on me donnait pour mon travail, c’était « ah, tu devrais regarder Claude Régy, tu devrais regarder untel ».
Les cours de studio c’était un endroit d’épanouissement ?
Complètement ! Par exemple en objet augmenté, où être une femme ou être un mec ce n’était pas un problème. On était tous face à des choses incompréhensibles, d’Arduino, de code, etc. Je sais que c’était un endroit où je me suis sentie super à l’aise parce que j’étais face à des objets électroniques et il n’y avait pas de problème. J’ai l’impression que le code, etc. — je peux me tromper en termes de statistiques — ça commence à être plus accessible pour les deux côtés, plus que les gros outils, les grosses machines. Non, le studio a toujours été un endroit superbe. De toute façon tous les cours qui sont plastiques ou techniques ont toujours été des vrais régals. Que ce soit dessin, peinture, etc. Jamais de souci. Après par contre en termes de représentation, on avait quand même que des nus blancs, ça je m’en suis rendu compte. Je n’ai jamais dessiné d’homme ou de femme noire de ma vie. Je me suis dit « Mais en fait c’est pour ça que je dessine beaucoup de gens blancs alors que j’ai des potes qui ne sont pas blancs. »
Est-ce qu’il y a des choses que tu aurais envie de partager, sur lesquelles je ne t’ai pas interrogé ?
Non, mais j’aurais bien voulu qu’on parle plus à l’avenir parce que je suis en train d’écrire un essai. J’écris beaucoup sur la pédagogie et je commence à établir des méthodologies sur comment amener ou appréhender l’art. J’ai toute une partie sur le genre, sur le sexisme, le racisme, etc. Sur comment créer de l’égalité et de l’initiative, etc. J’aimerais beaucoup avoir ton point de vue là-dessus. J’ai envie d’interviewer des gens aussi, d’inclure d’autres recherches. Je donne beaucoup d’ateliers où j’essaye de mettre ça en pratique : comment repenser la structure de l’école d’art. C’est un grand thème qui m’intéresse et je pense que tes recherches sont complètement en lien avec ça aussi.
Ça m’intéresse beaucoup ainsi que les autres membres du collectif [Camille Boubals, Louise Garric, Paul Judic].
Je voulais vous dire bravo. Je suis hyper émue par ton travail. La preuve en images je n’arrête pas de pleurer. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Bravo pour ta force.

Margaus Ballagny
étudiante
de 2015 à 2020
avec
Alexandra Piat
le 30.03.21

- Identité de genre
- Représentation
- Manque de collectif
- Culture féministe
- Humour
- Prendre l'espace
- Communauté queer
Entretien de
Margaus Ballagny
étudiante de 2015 à 2020
le 30.03.21 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Margaus Ballagny. J’ai vingt-six ans. Je suis actuellement en sixième année « Atelier » aux Arts Décoratifs de Paris. Avant j’étais en Image imprimée. Je me genre au féminin et j’utilise le pronom « elle ». Je crois que c’est quelque chose qui m’intéresse, ces histoires de genre et d’identité, notamment parce que je suis lesbienne et ça continue de me questionner. Je pense que c’est ce qui m’a mis la puce à l’oreille sur les questions de genre. Je ne sais pas si c’est le cas de tout le monde mais en ce qui me concerne, ça a soulevé ces questions-là. Aussi, j’ai très récemment questionné en profondeur mon identité de genre parce que j’ai l’impression de mentir quand je dis que je suis une femme. J’ai l’impression que ce n’est pas vrai. En même temps, j’ai l’impression de mentir si je dis que je suis un homme. Je ne suis aucun des deux, mais je ne me sens pas non plus non-binaire. Je trouve ça juste trop nul le genre et j’ai pas envie que ça existe. Je n’ai pas vraiment de solution à ces problèmes, c’est un fait que je remarque. Par confort et par facilité, puisque j’ai quand même la chance de ne pas me sentir dans une dysphorie de genre [terme utilisé pour décrire un sentiment d’inadéquation entre son genre assigné à la naissance et son identité de genre] totale, j’utilise le pronom « elle », je crois que c’est plus simple pour les autres et moi.
J’étais en Image imprimée et j’aime beaucoup faire des livres. Je crois que c’est vraiment ce qui me plaît. Comment faire vivre le texte ? Dans une édition, c’est un peu la réponse qui me semble évidente, mais je crois que j’ai aussi envie de fouiller comment est-ce qu’il peut être autrement et autre part.
Est-ce que par rapport à notre sujet d’étude, l’expérience de genre aux Arts Déco, il y a des choses qui te viennent spontanément à l’esprit ?
J’ai été un peu confrontée à ces questions l’année dernière puisque j’avais fait mon diplôme autour d’un projet de maison d’édition dans laquelle je voulais éditer uniquement des femmes et/ou personnes en minorité de genre [fig.20]. J’ai été confrontée à devoir justifier ce choix avec mes profs. Pour moi, c’était simple « J’ai envie de faire ça et c’est mon projet, point ». Mais à chaque fois, je devais ré-expliquer et c’était un peu chiant… Il y avait beaucoup d’hommes aussi dans les profs, peut-être que ça a joué.
Comment était reçue ton explication ?
J’ai l’impression qu’il y avait ce truc habituel de quand tu discutes avec des mecs cis het [cisgenre et hétérosexuel] qui disent « Mais quoi ? Mais attends, on va être exclus ? Mais elle est où notre place ? Ça veut dire que si c’est un mec qui écrit des bons textes, tu vas lui dire non ? ». C’est vraiment ne pas du tout saisir les enjeux que je mettais au cœur de mon travail et de mes intérêts.
Tu as l’impression que ce sont des sujets sur lesquels les profs ne sont pas cultivés ?
C’est un grand oui ! Vraiment, sur tout le secteur, toutes promos confondues, j’ai vraiment l’impression de n’avoir jamais été confrontée à quelqu’un qui avait déconstruit ça ou qui s’était posé des questions là-dessus. Comme tu le disais très bien, quelqu’un qui avait essayé de se cultiver ou de réfléchir. Au début, ce n’était pas très grave parce que je n’avais pas réalisé que c’était autant important pour moi. Je me disais juste « oh là là, mais c’est pas très queer ! ». Mais voilà, c’est un fait, le monde n’est pas queer. Et quand j’ai voulu en faire une partie importante de mon travail, je me suis aperçue que ce n’était pas bien parce que ça freinait un peu un truc, on était obligé de s’arrêter à ça. On ne pouvait pas aller plus loin et c’était un peu dommage. Je les mets pas tous et toutes dans le même degré de compréhension et d’écoute. Mais c’est comme si ça n’avait pas lieu d’être, qu’il n’y avait pas besoin de faire ça. C’est juste super hétéro. Dans le sens hétéro-normatif.
Dans l’ambiance globale de classe, est-ce que tu avais l’impression d’avoir du soutien ? Que si les profs ne suivaient pas, tu avais d’autres gens autour de toi, dans la collectivité de l’école ?
Au sein de ma classe, non. Au sein de la promo, non. À part mes ami·es, évidemment. Plus le temps passait et plus je m’apercevais qu’il y en avait et c’est super cool. Mais vraiment, non. C’est dur parce que même si tu sais que tu as des interlocuteurs ou interlocutrices au sein de l’école, s’ils ne sont pas dans ta classe c’est un peu chiant quand tu es confrontée à tes profs. J’aurais trop aimé qu’il y ait juste une prof qui capte un peu, ou même une intervenante. On a eu une intervenante un peu plus cool. Enfin on a parlé deux secondes et je me suis aperçue que c’était une « abolo » [abolitionniste] donc… bon. Mais dans le principe, c’était chouette d’avoir, déjà une meuf, et ne serait-ce qu’avoir des références de travaux de meufs. Je crois que j’aurais souhaité qu’il y ait des personnes ou des références plus queer.
Tu as l’impression qu’il y en avait jamais ?
Vraiment, c’est chaud ! Après c’est peut-être moi parce que j’ai envie qu’il y ait que des meufs, je ne sais pas. Ce qui est marrant en Image imprimée, c’est que c’est beaucoup de techniciennes et beaucoup de profs mecs. C’est intéressant et c’est chouette, il y a quand même une présence de meufs. Mais je n’ai pas l’impression d’avoir eu des interlocutrices très pertinentes sur ces sujets, en tout cas en tant que prof, jusqu’en quatrième année.
Est-ce que tu te sentais libre de créer dans tous les espaces de l’école ? Est-ce que tu avais la sensation de devoir te conformer à quelque chose pour obtenir ce dont tu avais besoin ?
C’est un peu le même problème dans l’école que dans la vie de tous les jours, partout. Je dirais ni plus ni moins qu’en dehors de l’école.
Est-ce que le fait de transgresser un peu le genre ça créait des réactions, des discriminations ?
Je n’ai pas trop l’impression de transgresser le genre. Et non, je n’ai pas l’impression d’avoir subi de discrimination dans l’école. Si, c’est déjà arrivé que je sente que le fait d’affirmer que je suis gouine, fasse naître des remarques un peu sur le ton de la blague venant de profs mecs cis het blanc de cinquante ans qui sont là depuis cinquante piges dans l’école. Je crois que je ne l’ai pas mal pris parce que je suis fière de ça, que j’en joue et que ça me fait presque plaisir. D’une certaine manière, ça me conforte dans mon identité, disons, même si je n’ai rien demandé et que je n’avais pas particulièrement envie de parler de ça avec eux. J’en avais déjà parlé avec un camarade de classe qui est à peu près dans le même cas de figure et j’ai remarqué que pour nous, c’est ok, mais pour des personnes qui ont peut-être moins les outils, qui ont moins l’habitude de ça, ça pourrait être plus difficile. Moi j’ai l’impression d’avoir acquis des outils. Si on me dit quelque chose je sais un peu comment je pourrais répondre. Je me sens plus armée avec ça. Aussi c’est un truc hyper personnel, mais moi j’aime bien chercher les profs, être un peu provoc’. Donc, qu’ils le soient avec moi, même si c’est un peu biaisé que ce soit là-dessus, j’ai l’impression que c’est une espèce de jeu… Ça ne veut pas dire que c’est légitime, mais ce que je veux dire, c’est que je ne sais pas s’ils se le seraient permis avec d’autres. Je n'espère pas en tout cas !
Est-ce que dans l’école, tu as été témoin ou victime de formes de sexisme, de propos, de gestes déplacés ou de l’ordre de violences sexistes et sexuelles ?
De l’ordre de violence non, ni témoin ni victime. Entendre du sexisme, oui, plein de fois.
Est-ce que tu as l’impression qu’il y a dans l’école une sorte de sororité ou d’adelphité [synonyme non genré de « fraternité »] à propos de toutes ces questions ? Du genre, de l’orientation sexuelle ?
Je ne crois pas trop, non. Ce qui est trop bizarre, c’est que dans les cours ou dans les ateliers, ce serait difficile d’avoir ça, je trouve. À moins d’avoir des meufs ou des personnes queer dans ta classe, ce qui n’était pas mon cas, c’est un peu dur. Mais sinon, dans tout ce qui est espace loisirs de l’école, la cafet’ ou les espaces festifs, oui, tu vois que ces personnes-là existent, qu’elles sont là. Et ça, c’est important déjà. Il y aussi la mailing-list [mailing-list « chers tous » qui sert à s’adresser à tous les étudiant·es], ou l’Ensad cool [groupe facebook d’étudiant·es de l’école] où ça m’est déjà arrivé de sentir qu’il y a une espèce de réserve de personnes qui sont là. C’est difficile à exprimer, mais c’est un peu : savoir qu’il y a des gens qui sont prêts à en découdre, même si on a du mal à l’identifier ou qu’il ne se passe rien de concret. J’ai l’impression qu’il y a un truc à réveiller. J’ai l’impression que ça prend vie dans les nouvelles promos ceci dit, j’ai beaucoup d’espoir en elles.
Cependant c’est quelque chose qui est un peu problématique aux Arts Déco, en tout cas dans ma promo, l’individualisme. Je ne sais pas si c’est à rapprocher de la sororité, etc., mais je pense que l’un influe sur l’autre. Quand tu te poses des questions sur comment tu peux créer un sentiment agréable de communauté et d’entraide, et bien ça passe par le féminisme et aussi par inverser cette courbe pro-individualiste.
Dans beaucoup d’entretiens on m’a parlé de l’individualisme et de manque de collectif aux Arts Déco.
Je pense qu’il suffit d’une personne qui fait sa life, qui s’en bat les gonades, et il y aura un sentiment d’individualisme alors que tout le reste est une communauté soudée. Donc c’est pas forcément représentatif, mais c’est vrai que c’est quelque chose que tout le monde dit.
Est-ce que ton expérience des Arts Déco t’a donné confiance en tes capacités ?
Franchement de ouf ! D’un point de vue technique, on m’a donné des outils et j’ai appris plein de choses donc forcément, je me sens plus mûre de produire des choses qui me plaisent. J’ai appris ça et ça me donne plus confiance en moi et en mon travail. Après, d’un point de vue personnel, est-ce que ça m’a donné confiance en moi ? Je ne sais pas trop. C’est difficile de répondre à cette question parce qu’il y a tellement de choses qui se passent en même temps.
Dans quelle mesure dans l’école tu t’es sentie accompagnée, que ce soit par les profs ou par les responsables d’atelier ? Est-ce qu’il y avait une différence dans l’accompagnement des femmes ou des hommes ?
Ça rejoint un peu ce que je disais au tout début. Il y a quand même des profs qui bloquent un peu les questionnements de mon travail. On ne peut pas vraiment aller très loin du moment où on te dit « Ah mais tu veux exclure les hommes ?! » Ça fait que je ne me suis pas sentie soutenue, dans mon projet de diplôme en tout cas. Néanmoins, j’ai quand même l’impression que malgré leur manque d’informations — on peut dire ça comme ça — je sens qu’ils ont envie d’apprendre. C’est très personnel mais j’ai aussi confiance en l’être humain et je sais que s’ils sont profs, c’est aussi qu’ils ont envie d’apprendre des étudiants et étudiantes. Que même s’ils n’ont pas, là présentement, les outils pour répondre à mon projet, ils étaient quand même curieux et ils avaient envie de donner des références. C’était aussi particulier du fait qu’avec le confinement je ne me suis pas sentie soutenue, personne ne répondait jamais, c’était un enfer. Mais c’est beaucoup de facteurs tout ça. Maintenant que je suis diplômée, il y a une prof (ou deux) que j’aime bien et qui est cool, je sens qu’elle est là pour me soutenir et je sens qu’elle essaye de faire ça avec d’autres personnes. Elle le faisait avant, mais ça pose aussi la question de qui elle soutient et pourquoi ? Même si c’est confortable pour moi parce qu’on s’entend bien, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres. Ça me questionne aussi.
Mais limite dans les ateliers je me suis sentie presque plus accompagnée, parce qu’il y a moins de jugement. Ils et elles sont vraiment là pour mener ton projet à bien techniquement, alors que les profs, c’est plutôt du genre « Ah mais pourquoi tu ne fais pas des bonhommes figuratifs ? On ne comprend pas ce que tu veux dire ». Après, je ne crois pas que ça recoupe trop de questions de genre ou d’identité. Personnellement, je ne l’ai pas ressenti comme ça. Je sais que ce sont des rumeurs. On dit « Elle ne supporte pas les meufs » ou « Tel technicien, si t’es une meuf, ça passe mieux ». Je ne sais pas, moi je n’ai jamais vu ni senti ça directement, mais ça veut pas dire que ça n’existe pas non plus.
Tu parlais de ton diplôme qui a un caractère engagé et politique.[fig.21] Est-ce que globalement dans tes études, tu as souvent fait des travaux engagés ? Féministes ou en rapport avec des luttes sociales ou environnementales.
Non, ou alors pas consciemment ou pas directement. En y repensant, je m’aperçois que même si j’étais soutenue par mes profs, moralement et techniquement, dès le moment où je ne peux pas en parler parce que juste ils y captent que dalle, c’est compliqué d’avancer là-dessus seule, sans armes. Ne serait-ce que le fait qu’il n’y ait pas de personnes queer… Je n’en connais pas, ni dans les profs ni dans les techniciens ou techniciennes, tu ne peux pas avoir d’avis « professionnel ». Et en plus de ça, malgré eux, on ne t’aiguille pas là-dedans. Si toi-même, Alexandra, tu n’y avais pas pensé, personne ne t’aurait dit « Est-ce que c’est un sujet qui t’intéresse ? Lis ça, ça et ça ». Personne ne l’aurait fait, en tout cas en Image imprimée. Le fait qu’ils ne soient pas déconstruits ça fait une barrière à la profondeur. De manière générale les mecs cis het, pas forcément ces profs-là en particulier. Je ne pense pas qu’ils pêchent plus que d’autres.
Mon diplôme m’a néanmoins donné envie de creuser ces questions ; pendant le premier confinement j’ai voulu me pencher sur la faisabilité d’un doctorat de recherche & création sur le thème un peu général de la micro-édition féministe queer. Je sais qu’il n’y a pas de suivi de doctorat en Image imprimée à l’école, mais j’aurais souhaité être aiguillée. Je n’ai vraiment eu aucun soutien à ce niveau, pas d’interlocutrice, et j’ai fini par abandonner. Même si c’était un contexte particulier, j’étais méga déçue.
Est-ce qu’en dehors du cadre purement scolaire, tu as fait des choses pour la vie de l’école ?
En vrai, j’ai l’impression de m’être beaucoup investie dans l’école. Déjà, j’ai passé mon diplôme dans le bureau du directeur [Emmanuel Tibloux]. Ensuite, Fabien Gaydan [chargé de mission coordination et gouvernance] c’est mon ami. Je mets des mots dès que je peux dans l’école. Je fais des blagues. Comme mettre dans l’ascenseur des mots d’amour pour tout le monde ou là, j’ai mis des QR codes qui renvoient sur les deux clips de musique que j’aime trop pour les gens qui s’ennuient dans l’ascenseur. Sur les boîtes aux lettres au premier étage, j’ai mis Rose Vidal [étudiante] parce que je trouve qu’elle est trop importante dans l’école et il y avait une boîte aux lettres vide. Du coup, j’ai mis son nom, comme ça on peut écrire du courrier pour Rose Vidal. Ah oui, j’ai dit que l’école allait fermer définitivement et il y a des gens qui l’ont vraiment cru. C’était un mot dans l’entrée.[fig.22] J’ai organisé des soirées aussi.
Oui notamment la dernière soirée de notre cinquième année ?
Exactement, qui était pour le pot de départ de Naïma [agente d’accueil jusqu’en 2020]. Sauf que j’ai fait tellement de bêtises dans l’école qu’elle pensait vraiment que c’était une bêtise et du coup elle n’est pas venue. J’ai envoyé des mails aussi à Julien Bohdanowicz [directeur des études] pour le faire rire, aussi à Emmanuelle Barbey [responsable de la production des manifestations]. Il y a des sortes d’espaces au premier étage dans lesquels on peut mettre des A4. Il y a plein d’espaces vitrines comme ça, vides. J’avais proposé que les cinquièmes années Image imprimée mettent l’avancée de leurs travaux dans cet espace. D’ailleurs, après les Césars 2020 j’avais mis « Je vais vomir » et à côté, « Bravo à l’hétéro-patriarcat ! ». Encore à côté, j’avais mis l’article de Virginie Despentes [écrivaine et réalisatrice] qui était paru dans Libé le lendemain, il était trop bien !
Pourquoi tu as choisi le bureau du directeur pour ton diplôme ?
Il y a plusieurs raisons. La première, je crois que c’est parce que ça me faisait rigoler. La vraie raison, c’est qu’il y avait des espaces qui me semblaient super chouettes, intimes : des petites salles, ou la cabane dans la cour, ou le local poubelles. Et avec le covid on m’a dit non parce que c’était trop petit et qu’il fallait aérer etc. Du coup j’ai dit « Si je ne peux pas avoir le local poubelles, je prends le bureau du directeur, je m’en fous. Je prends le pouvoir. » Après, ça ne venait pas de rien non plus, c’était cohérent avec mon sujet de diplôme. Comment tu prends un espace, à qui il est réservé et jusqu’où tu peux aller là-dedans ? Je crois que c’était cohérent avec tout un tas de questions que je me posais à ce moment-là, que je me pose encore et qui prennent du temps de réflexion et d’analyse. Je crois que c’était aussi important de savoir que c’était possible de le faire. C’est notre école et même le bureau du directeur si on veut, on peut. Ça m’a touchée qu’il accepte. Je crois que s’il n’avait pas accepté ça aurait été grave, et en même temps, qu’il accepte c’était quand même cool. S’il avait dit non je pense qu’on aurait fait un putsch.
Comment il l’a pris ? Est-ce qu’il a trouvé ça drôle ?
J’ai des photos de lui, quand j’étais en train d’installer le matin de mon diplôme, qui faisait ses réunions dans la cour, ça me faisait hurler de rire !
C’est magique.
C’était trop bien, j’ai accueilli mon jury assise au bureau et tout. Sur leurs cartons d’invitation je les avais « convoqué·es ».
Je trouve ça génial que ton investissement dans l’école soit très basé sur l’humour, pour faire rire les gens et toi-même.
Là je t’ai dit une partie des trucs que j’ai faits, mais j’en ai fait tellement plus. J’ai mis des posters de Larusso et de Lââm dans les couloirs, avec des paroles de leurs chansons [fig.23]. Aussi quand Christophe Mallet, l’ancien directeur technique, est parti, on a écrit en énorme « Adieu Christophe » avec des cœurs sur les vitres de l’atelier de sérigraphie au dernier étage. Je dis « on » parce que la plupart de ces choses-là je les ai faites avec ou pour mon trouple d’ami·es.
C’est une manière assez drôle d’occuper l’espace de l’école.
Je crois que j’avais aussi besoin d’être dans le bureau du directeur comme un bouquet final de mon investissement dans les espaces de l’école.
Est-ce qu’il y a d’autres choses que tu aurais envie de raconter sur ton expérience aux Arts Déco ?
Oui, j’aimerais ajouter : j’associe beaucoup l’esprit de communauté queer à un espace artistique, culturel et festif. Et j’ai l’impression qu’aux Arts Déco, même s’il peut exister de mille manières, personnellement là où je l’ai le plus senti et où j’aimerais qu’il existe le plus, c’est dans les moments festifs des Arts Décoratifs. Vraiment c’est le moment où les queers sont les meilleurs, ils sont incroyables. Et je crois que c’est aussi pour ça que j’avais envie d’investir l’espace de l’école, pour recréer des petits moments comme ça. Mais ce que je veux dire, c’est « On sait que vous êtes là, les queers ! Et que vous avez trop d’énergie et que vous êtes trop stylés ! » Et ça m’énerve qu’il n’y ait plus de fête et qu’on ne puisse plus nous voir, c’est hyper frustrant. C’est plus une remarque qu’une analyse pertinente. C’est un moment où il se passe des choses, déjà on se voit et c’est important. On peut parler ensemble. On peut partager des moments cool entre promo, inter-secteur. Parce que, oui tu peux prêter ton crayon au pôle impression, mais ça ne vaut pas ça.
C’est le moment de briller aussi ?
Oui de ouf ! Parce que tu peux faire des accrochages, mais les gens ne passent pas. Les gens viennent pour faire la fête. Ça existe comme moment de partage. Et là, avant le coronavirus il y a eu les grèves, encore avant j’étais en Erasmus, donc pour moi ça fait deux ans qu’il n’y a pas de fête. Quand je dis fête, oui il y a mettre de la musique et boire beaucoup. Mais je sais que le BDE avait organisé des bingo ou des trucs comme ça et c’était cool aussi.
Ces moments-là permettent de retrouver de la communauté, du rire ensemble et aussi — j’ai l’impression que c’est ce que tu disais tout à l’heure — que les personnes queer s’identifient entre elles aussi.
Oui voilà, se voir. Ça crée un moment possible de rencontres. Même si en zoom on peut se voir, on peut s’apercevoir en travaillant, c’est pas la même chose. D’avoir un temps donné aux autres. C’est ça en fait la fête : donner du temps aux autres… Whaou !
Hyper profond !
Je crois que je n’avais jamais vu ça comme ça.

Michèle Guenoun
enseignante
de Sciences humaines
de 1969 à 2009
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 18.12.20

- Épanouissement
- Déséquilibres
- Relation aux étudiant·es
- Hommage
- Dévalorisation
- Carrière
Entretien de
Michèle Guenoun
professeure de Sciences humaines de 1969 à 2009
le 18.12.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Lucile Encrevé
Préambule écrit à la suite de l’entretien par Michèle Guenoun, qui a cherché à retracer au plus près ses souvenirs de l’École, dont elle est une témoin précieuse :
« Cet entretien me met en situation de faire un bilan sur quarante années. Un vrai travail de reconstruction mémorielle. Alors à le faire avec « intention de sincérité », pour ne pas dire honnêteté intellectuelle, je tiens à dire que je l’inscris, ou qu’il s’inscrit dans un cadre précis, l’Histoire politique vécue entre 69 et 2009. Politique au sens majeur du terme, pas l’histoire politicienne bien sûr. J’espère que ce préambule ne paraitra pas pompeux, mais il est d’autant plus nécessaire que la seule histoire de l’Ensad dont disposent les étudiant·es, dont la seconde partie qui traite de cette même période, s’avère être caricaturalement institutionnelle – voire « administrative » disent d’ex-collègues, pour appeler un chat un chat…
Fondamentalement il y a deux raisons à mon parti pris. L’une, évidente, la chaine Ensad-Ministère-Gouvernement, avec directeur·trice nommé·e sur proposition du, de la Ministre de la Culture par décret du Président de la République. Donc politique culturelle, mise en œuvre avec une certaine marge d’autonomie, mais très visible à partir de 1998 sous le gouvernement Jospin, quand Catherine Trautmann, première femme Ministre de la Culture abolit d’un coup de décret le Conseil paritaire enseignant·es étudiant·es personnel issu de 68, et le remplace par un conseil d’administration dont elle nomme le Président, venu de LVMH. Symboliquement, mais pas que, odieux par rapport à tout ce que l’École a fait après 68. C’est d’ailleurs la dernière fois que j’ai distribué un tract CGT à l’École quand elle y est venue. Je le lui donne en lui demandant de « se ressaisir ». Elle n’a pas eu l’air de comprendre… Passons.
La deuxième raison est que ces quarante années correspondent à « l’âge » de l’accès des femmes à l’emploi dans absolument tous les domaines et disciplines, du graphisme au maintien de l’ordre… inutile de lister. Accès parallèle à leur politisation. C’est ce que ma génération a expérimenté, comme une lame de fond qui a avancé en trois temps. De 1970 à 1981 avec le MLF [Mouvement de libération des femmes] qui naît et agit sur fond d’air rouge. Il tient à son autonomie par rapport aux partis politiques, mais ses revendications convergent, de fait, avec le « changer la vie » et la libération des salarié·es au programme du socialisme. Le militantisme féministe se pratique dans les groupes, manifestations, et publications du MLF, pas sur le lieu de travail. À l’École les trois femmes, dont je suis, qui enseignent les Sciences humaines, sont féministes et notre engagement y est donc « classique », syndical, au Snesup [Syndicat national de l'enseignement supérieur], et dans mon cas au PC, seul parti organisé comme tel à l’École. Quant à la principale exigence d’une maternité choisie et non subie, comment dire, nouvelles enseignantes, étudiantes, qui n’y adhérait pas ? Ça allait de soi. Après 1981, c’est moins clair. Le premier Ministère des Droits de la femme et l’état prennent le relais, avec les Lois qui jusqu’en 1990 installent l’égalité. Globalement les féministes s’en remettent à l’État. Mais le « réel » ne suit pas, elles se réveillent et de 90 à 2010 nouvelles lois pour faire passer l’égalité dans la réalité, dont la loi paritaire pour les élections en 2000… Comment l’École intègre-t-elle ce mouvement d’émancipation au long cours ? Ce sont les instances élues, masculines, et l’administration qui appliquent, éventuellement, ces droits. À quel rythme ? Rétrospectivement, à marche plutôt lente. Mais pas de données objectives. Quel pourcentage d’enseignantes recrutées ? Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015], qui était ingénieur, a planché en 2000 sur leur promotion. Statistiquement les résultats prévisionnels étaient affligeants. Il me reste une mémoire subjective, visuelle. L’administration était entièrement féminine, elle devient mixte. Un peu. Quelques femmes techniciennes. Et la population étudiante qui devient très majoritairement féminine. »
Quand êtes-vous entrée à l’École pour enseigner ?
À la rentrée scolaire 1969-70. C’est une des innovations dues à 68, l’introduction des sciences humaines, avec moi, sociologue, et Régis Matéo, psycho-sociologue. Parité ! On a vraiment été portés par quelque chose qu'on ne peut que très difficilement imaginer maintenant, une effervescence merveilleuse. L’École « occupée » est fermée en juin 1968, comme les Beaux-arts. La différence s’est faite sur qui « pilote » l’occupation. Aux Beaux-Arts, les « gauchistes » veulent faire table rase du passé, donc les fermer… Aux Arts Déco, c’est l’UEC [l’Union des étudiants communistes] qui anime l’UNEF [Union nationale des Étudiants de France] : à la rentrée 1968-69, la proposition de faire une « autre » école a pris forme, avec force assemblées générales, et quelques professeurs à l’initiative… avec le Bauhaus comme référence et repère… Et dans cette volonté de refonte, ou ce désir de changement radical, il y a eu cette idée étonnante d’intégrer les Sciences humaines. Toutes nouvelles, peu enseignées à l’Université, avec donc peu de publications et plutôt confidentielles, inexistantes dans le secondaire. Leur introduction dans un enseignement artistique, c’était révolutionnaire. En tout cas je l’ai pris comme ça. Et je me suis vécue pédagogiquement à l’avant-garde ! Dans le paysage de l’enseignement artistique, on peut dire que, pendant quelques années, l’École a fait preuve d’avant-gardisme. Un qualificatif qui comptait, avec celui de scientifique.
Où aviez-vous fait vos études ?
À Aix-en-Provence, où je voulais faire philo pour comprendre le monde, après avoir vécu en Algérie. C’est-à-dire pendant une guerre, innommée et innommable, avec la misère à domicile, l’exploitation sous mes yeux, je parle des bonnes qui étaient toutes algériennes, situation coloniale type. Mais le département de philosophie était très réfractaire au réel. Après deux ou trois semaines, j’ai rejoint celui de sociologie qui venait d’être inauguré. On y étudiait la vie, et c’était ce que je voulais. Puis à Montpellier, pour faire ethnologie, enfin à Paris, pour un 3ecycle chez Francastel [Pierre] qui avait créé une chaire de sociologie de l’art à l’EHESS [École des Hautes Études en Sciences Sociales], la Sorbonne la lui ayant refusée. Quant au parcours qui m’amène à choisir l’École, il est inédit, et m’en a pas mal appris sur les arcanes de l’État et les pouvoirs mandarinaux. L’assistante de Francastel, sachant que je cherchais du travail avait donné mon nom à Salanon [René, inspecteur général des Enseignements artistiques au ministère des Affaires culturelles]. Il avait le projet d’un Institut de l’Environnement, au sens de la dynamique urbaine, placé sur le territoire de l’Ensad, rue Érasme. « L’enjeu est de former des designers parce que, me dit-il, la France ne tient pas le marché face à la concurrence de l’Allemagne. Ce dossier était au fond d’un tiroir, Mai 68 a permis de le ressortir ». Il m’a demandé d’assister, avec deux autres sociologues, aux jurys du concours d’entrée aux Beaux-Arts annulé en juin et qui serait passé sous une forme totalement libre. Je devais faire un rapport sur l’état d’âme des étudiant·es. Ce que j’ai fait. C’est dans ces conditions que j’ai eu mon premier contact en chair et en os avec une école d’art, et avec des étudiants ravis qu’on les questionne sur leurs besoins et attentes. C’était un test. J’ai reçu en effet après coup un contrat d’enseignante, comme chef de travaux pratiques aux Beaux-Arts. En attendant qu’ouvre l’Institut, un an après [nov. 1969-juillet 1971], rien ne se passe, sauf deux rencontres. L’une avec les plus engagé·es dans l’aggiornamento de l’Ensad, l’autre avec la directrice du département d’Esthétique du CNRS qui me propose d’écrire un article sur l’espace urbain (re-test pour un poste dans son labo) dans un ouvrage sur Les formes esthétiques de l’œuvre d’art à la veille de la 1ereguerre mondiale à paraître aux éditions Klincksieck… sans être payée. Je suis partie en courant et j’ai finalement rejoint les Arts Déco où il y avait des enseignant·es, rétribué·es pour transmettre en cherchant, une liberté reconnue socialement utile. D’où un lien affectif certain avec l’École, partagé par mes collègues nouvellement recru·es, je crois.
Votre contrat a finalement été basculé à l’Ensad ?
Oui, il a été transféré. Comme pour les enseignant·es venu·es de l’UERE [Unité d’Enseignement et de Recherche sur l’Environnement, 1969-1971], autre progéniture du ministère, avec le même destin que l’Institut de l’Environnement, dont Denise Martin-Mourot [enseignante de 1969/72 à 1995], plutôt psy et plasticienne, et Danielle Storper-Perez [enseignante de 1969/72 jusqu’au milieu des années 1980], plutôt ethno, qui écrivait dans Le Torchon brûle [publication féministe ; de 1970 à 1973] moi c’était dans Elles voient rouge [fig.24] – deux féministes de plus dans le département des Sciences humaines.
Il y avait un équilibre hommes/femmes en Sciences humaines ?
Relatif. Il y avait une majorité d’hommes mais le problème n’est pas seulement quantitatif, il est qualitatif : qui parle, propose, est à l’initiative de quoi, surtout entendu·e en réunion pédagogique. En Sciences humaines chacun et chacune faisait ce qu’il, elle voulait selon sa formation académique. De ce point de vue, enseignants et enseignantes étaient en égale liberté. Je note, rétrospectivement, et à ma connaissance, que ni Denise ni Danielle ni moi n’en avons usé pour faire des cours relatifs disons à la problématique de la condition féminine, alors que nous avions vraiment le gout de la théorie. Pour les raisons déjà évoquées [dans le préambule], probablement aussi parce que nous nous sommes auto-censurées, enfin tout simplement parce que nous manquions pour le coup magistralement des données adéquates. La recherche féministe s’est constituée au milieu des années 1980 au CNRS, développée au bon vouloir des universités, instituts de recherches divers et variés, pour l’essentiel sur le salariat. Les publications en anthropologie et Histoire des femmes sont venues encore après. À ma connaissance rien sur le travail dans le champ artistique. Quant à l’esquisse d’une éventuelle théorie de la création féminine, qui pouvait nous concerner, elle s’est perdue dans des querelles entre les « égalitaristes » et les tenantes de la « différence » plutôt que dans l’analyse.
Vous faisiez quels types de cours en arrivant ?
Des cours liés à un groupe de la 1ereet/ou 2eannée. Des cours généraux, dits « d’amphi », sur une thématique particulière, pour ma part en socio-esthétique. Enfin les cours du soir offerts aux salariés. Il n’y avait que des jeunes hommes parfois plus âgés que moi, plus matures que ceux du jour, logique. Et en vraie demande de savoir. Idéal pour enseigner, un vrai laboratoire, pédagogiquement j’y ai fait mes classes. Mais ces cours ont été supprimés au prétexte qu’il n’y avait pas assez de candidats. Annette Messager, dit-on, a fait l’École en cours du soir [étudiante entre 1963 et 1968]. Je note qu’il valait la peine de les maintenir indépendamment du « coût ». Mais il fallait une volonté, on appelle ça une politique…
Et plus tard, vous vous retrouvez en Textile ?
Et après en Design vêtement. Un défi. C’était les sections « femmes » de l’École, à la fois ghetto et cocon où j’allais pouvoir travailler dans une « perspective féministe », parler corps et tête, tels qu’ils sont formatés par la société. Mais c’était difficile, délicat, bien qu’il y ait eu une grande complicité, donnée a priori, entre les étudiantes et moi… Un vrai bonheur mais je marchais sur des œufs ! Psychologiquement, il y avait un risque de blocage. Je dirais qu’il fallait tout ou beaucoup déconstruire. De ce point de vue Barthes et son « Système de la mode » n’aidait pas vraiment. Ce que je faisais, c’était plutôt l’analyse très concrète de l’image publicitaire en général et de la presse féminine – textes et photos —, depuis le luxueux Vogue au bas de gamme Modes et Travaux, en passant par les produits pour couches moyennes Elle, Marie-France, Marie-Claire qui affichaient un féminisme plus ou moins édulcoré et paillettes. Malheureusement pour nous les femmes, les grands photographes étaient à Vogue et Elle [fig.25]. C’était les plus innovants esthétiquement parlant, au prix d’une véritable distorsion de la réalité quotidienne des femmes. Petit exemple des contradictions qu’il me fallait gérer. Sonia Rykiel aussi m’a aidée, self-made-woman dans la transgression de son premier geste, le renversement envers/endroit, et son Et je la voudrais nue [1979]. Là comme en 1er cycle, et même en amphi, j’ai beaucoup, beaucoup tablé sur « l’ éveil critique » par le débat après exposé, de moi, puis de chacun et chacune sur sujet librement choisi dans le cadre thématique. Et je leur proposais de commencer par exprimer leurs désaccords avec mon discours… L’autre principe était « d’ouvrir » à l’extérieur en l’« invitant », en y allant, ou encore en m’appuyant sur l’actualité, essentielle. Par exemple en 1989 pour le Bicentenaire de la Révolution, j’ai fait un cours d’amphi en m’appuyant sur une monumentale Histoire de la révolution par l’Image publiée par le CNRS et le Département d’Histoire de la Révolution Française de La Sorbonne. D’autant qu’enfin le rôle des femmes y était traité. En 1993, à l’occasion du « 500eanniversaire de la découverte du Nouveau Monde », j’en ai fait un sur le « Métissage », préparatoire à un voyage d’études à Cuba que j’organisais en lien avec les Beaux-Arts et l’Institut de Design de la Havane. Et pour ouvrir à l’École même, j’impliquais l’Atelier de rencontres [conférences organisées par l’École depuis 1978] – dans le cas Cuba, ça a donné le concert d’une pianiste cubaine à l’ENS [École Normale Supérieure, en face de l’Ensad] ! Parmi les enseignantes généreuses comme personnes et artistes, rencontrées ces années-là, il y a eu Geneviève Dupeux [enseignante en Textile, de 1975 à 1985] qui m’a initiée à la tapisserie contemporaine. Elle m’impressionnait par sa « fureur créatrice », sa pratique de la tapisserie au « fil de fer » au point d’en avoir les « doigts en sang ». Et aussi Costanza [enseignante de 1981 à 1996], créatrice de bijoux, isolée dans sa spécialité. Elle était dans une « plainte », effet de l’esprit « design » d’alors, d’un certain fonctionnalisme positiviste, que je critiquais mais pas du même point de vue qu’elle, et qu’elle formulait ainsi : « On considère que le bijou, ce n’est pas de la création, c’est une activité de bonne femme ». À propos, est-ce qu’existe toujours cette merveilleuse grotte d’Ali Baba qu’est la matériauthèque ? Je trouvais cela formidable, l’apport de créativité constitué par ce travail, qu’Isabelle[Humbert-Rouadjia] a fait contre vents et marées.
Dans les secteurs Vêtement et Textile, vous avez suivi des mémoires abordant des sujets féministes ?
Oui, mais peu. Un mot à ce propos. Quand le mémoire a été créé, à l’initiative du coordonnateur des Sciences humaines, c’était dans l’idée d’une équivalence de diplôme avec l’Université. Il se faisait, en 4e année, pendant ou après le Grand Projet, comme recherche ouvrant à l’après-école, et devant, j’y insiste, aboutir à une « esquisse » de projet [Il se fait aujourd’hui avant le Grand Projet qui prend forme en 5e année]. Autrement dit, il « renversait la vapeur ». On prenait son temps sur le discursif, qui amenait à une hypothèse artistique. De ce point de vue les étudiantes pouvaient faire la preuve de leur capacité analytique à égalité avec les étudiants, quel que soit l’objet choisi. C’est ce qui me paraissait le plus important. Enfin l’exigence à l’égard du mémoire était d’autant plus cruciale que dans la hiérarchie, évidemment implicite, de l’École, Textile et Vêtement étant des sections « filles » dévaluées. Cela dit, une étudiante libanaise a fait un travail sur l’image de la femme dans les livres scolaires que j’ai particulièrement accompagné, en l’encourageant à le présenter aux Éditions des femmes, qui l’ont refusé [Leila El Habr, L’Image de la femme dans les manuels scolaires, 1977]. Une autre, marocaine, sur le mariage au Maroc, qui demande un investissement financier insupportable pour les familles pauvres [Samya Hachimi, Mariage au Maroc, 1985]. Je l’ai soutenue très fortement. Avec toutes les deux, j’étais restée très amie. J’ai eu aussi le contraire, par exemple un mémoire sur l’esthétique des sous-vêtements. J’étais existentiellement et théoriquement très gênée, je ne savais pas comment l’accompagner. L’étudiante l’a parfaitement compris et a eu le courage de me le dire. Mais c’est une autre histoire qui m’a fait beaucoup culpabiliser. Une étudiante vient me voir et m’annonce qu’avant de partir en kibboutz, en Israël, elle veut faire son mémoire sur mode et vêtement comme phénomènes totalement superfétatoires. Une position théorico-morale radicale, qui me touche d’autant plus que j’ai en mémoire ce que m’avait rapporté, avec humour, une collègue avec qui j’étais amie (et qui m’a marquée)… À la fin d’un séminaire à l’université de Jérusalem, où elle voulait aller vivre, elle s’était retrouvée devant le mur des lamentations à psalmodier « merci mon Dieu de ne pas m’avoir fait femme » ! J’ai suivi une étudiante courageuse, mais le jury a refusé, exceptionnellement, de valider son travail, arguant qu’il remettait en cause l’existence même de la section Design vêtement. Je n’ai rien pu faire. Je me suis trouvée face à mes contradictions, coincée entre deux sectarismes. D’ailleurs, pour de multiples raisons, allant de pair avec l’évolution au-dehors, dans la société et sa conséquence au-dedans, la bataille entre les enseignants « généralistes » et « professionnalistes », son effet entre autre sur la nature du mémoire, au bout de quinze ans, je n’en pouvais plus. J’ai considéré que j’avais fait mon temps et ce que je pouvais dans des spécialités qui n’étaient plus cocon et ghetto, mais plus que ghetto. Je suis allée, un peu, en Design industriel, puis et surtout en Communication visuelle. Et, le plafond de verre ayant fonctionné, je suis devenue la plus ancienne assistante de l’École. Ça n’a pas été une préoccupation, j’avais l’habitude de dire que je cumulais les handicaps, femme, communiste, prof de Sciences humaines. Jusqu’au moment où, en 1995, après la fameuse grande grève sur les retraites, j’ai littéralement atterri et je me suis autorisée à m’occuper de mon sort personnel. J’ai envoyé deux ou trois notes rappelant mon existence à mes collègues, tous hommes élus à la commission de recrutement. Sans succès. En 1999 je crois, la colère m’a prise. Crise de dignité ! Là je leur ai envoyé très officiellement une lettre ainsi qu’à Peduzzi [Richard ; directeur de 1990 à 2002] et suis enfin, après vingt-sept années… passée prof de 3ecatégorie grâce, parait-il, à sa voix, qui était prépondérante. Cette discrimination latente s’est aussi exercée sur d’autres, selon moi c’est évident pour un enseignant, plasticien reconnu irakien, que j’avais connu en 1990 lors de la 1ereguerre d’Irak, quand on avait monté un petit comité de résistance avec des étudiant·es, et organisé une conférence-meeting – au passage, pour la 2nde en 2003, ça a été un travail graphique affiché sur les murs intérieur/extérieur de l’École et dans les manifestations. Enfin l’enseignant en question est parti de l’École chef de travaux pratiques donc au plus bas, alors que vraiment il s’investissait beaucoup. Et je « nous » ai associés comme figures de l’exclusion… le femme, l’immigré.
Avant de se quitter, j’aimerais vous poser une dernière question. Des propos sexistes, est-ce qu’il y en avait dans l’École ? Ou de la violence ?
Franchement, je n’en ai aucun souvenir. Sauf un seul, après 2000. Le propos d’un enseignant à l’égard d’une étudiante qui s’est plainte. Il s’est excusé.
Les étudiantes ne venaient pas vous parler de gestes déplacés, de mains baladeuses ?
Mains baladeuses ? Vous plaisantez ? La révolution sexuelle, elle passe par la libération intra et inter générations. On savait pertinemment que tel prof vivait telle aventure… ça ne posait aucun problème. J’ai souvenir d’une époque d’émancipation générale, de libération, donc de libération sexuelle. Et je peux vous dire qu’en Textile et Vêtement, mais pas que, en Communication visuelle aussi, j’ai vraiment reçu des confidences. Comme substitut de mère naturellement. Dans les groupes du 1ercycle, les étudiant·es disaient même que mes cours tendaient à la psychothérapie collective, tellement « ça » parlait. On n'a pas les mêmes catégories. Vous pensez dans des catégories acquises depuis l’an 2000, moi mes catégories sont acquises en 1968, sur d’autres bases. Exemple l’affaire Gabrielle Russier qui a marqué ma génération. C’était une jeune prof de littérature, divorcée, mère de deux enfants, qui a eu, pendant 68, une histoire d’amour avec un élève de dix-huit ans, mineur à l’époque. La famille du garçon, des enseignants je crois, a porté plainte, elle a été inculpée, mise en prison et s’est suicidée en 1969. J’ai senti un effet immédiat sur les étudiants, j’ai reçu quelques propositions. Et je n’ai pas été la seule… Vous croyez à l’étanchéité entre ce qui meut l’être humain, c’est-à-dire le désir, et le corps social ?
C’est la question du pouvoir (de l’autorité), aux mains, entre autres, des enseignants, qui pose problème, et la possibilité réelle de dire non. L’École devrait être un cadre qui protège et elle l’est, le plus souvent. Comme femme, l’École, elle vous a semblé un bon lieu ?
Jusqu’à la fin des années 1990, l’École était une famille, plus ou moins ouverte sur le monde, en tous les cas qui fonctionnait au sentiment, où l’administration était composée de femmes maternantes. Mais pour vous répondre sur le fond je crois qu’une école d’arts, pour autant que la pratique artistique est totalement mue par le désir, au sens psychanalytique et lacanien du terme bien sûr, est le lieu où circule ce pouvoir-là, du désir. Alors se protéger, entre adultes, de ce pouvoir-là ?? À quoi j’ajouterai, s’agissant de liberté, qu’il faut un projet pédagogique qui s’y prête, démocratique. Et ça existe, je l’ai rencontré dans l’expérience de « Traverses » qu’un groupe d’enseignants a créé en 2000 pour la 2eannée, contre la coupure entre l’Image et l’Espace [séparation instituée alors en 2nde année du 1ercycle, généraliste]. Expérience dont je pourrais parler des heures, avec documents visuels à l’appui. J’y ai vraiment vécu, pour la première fois, une pleine égalité, sur le terrain, dans ma relation avec mes collègues praticiens. De plus et surtout elle a résolu, au bénéfice je crois des étudiant·es, deux problèmes très pesants. Le problème de la « note », puisque les étudiant·es travaillaient en collectifs. Or j'ai toujours été contre la « note », peut-être en raison de ma détestation sociale et féministe du pouvoir de subordonner, hiérarchiser etc. Je considérais que le concours était suffisamment sélectif — il peut se « gagner » à un dixième de point n'est-ce pas ? — pour qu'on puisse se passer d'une seconde sélection. Mais c'est un combat que je n'ai mené que dans le cadre de mes cours : j'actais le fait que l’étudiant·e avait travaillé… ou pas et on en discutait. C'était leur responsabilité… et la mienne. Enfin le problème de la relation pratique-théorie, que la réforme de l’École avait mise en œuvre dans le 1ercycle sous la forme du « couple » d’enseignants praticien-théoricien, couples à 99 % masculins ! Reprise là sous la forme d’une seule véritable pédagogie de projet… Eh bien cette expérience a été arrêtée au bout de trois années…

Françoise Courbis
ancienne étudiante,
enseignante
depuis 1990
avec
Lucile Encrevé
le 02.12.20

- Carrière
- Vacataire
- Minorité
- Sexisme
- Homophobie
- Dévalorisation
- Histoire des créatrices
- Àge
- Déséquilibres
- Hommage
Entretien de
Françoise Courbis
ancienne étudiante, enseignante depuis 1990
le 02.12.20 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
J’aimerais revenir sur ton parcours.
J’ai fait mes études aux Arts Déco, après j’ai fait l’Atelier d’Image et d’Informatique (AII) qui était tout nouveau : tout d’abord existant sous la forme d’un troisième cycle, il est aussi rapidement devenu le centre de formation aux nouvelles technologies du ministère de la Culture intégré à l’École, à la fois pour des gens de l’École et des gens de l’extérieur. Je suis rentrée la deuxième année de l’Atelier, c’était les premiers programmes d’image numérique et de 3D. J’ai fini l’École en 1984 puis j’ai enchaîné avec l’Atelier et j’ai fait cette année-là comme une année de recherche. On pouvait prendre un an pour faire le mémoire après le projet, donc j’ai été diplômée en 1985. Tout de suite après j’ai travaillé comme intervenante pour l’Atelier. C’est un cheminement continu que je n’avais pas prévu, mais transmettre m’intéressait. Quatre ou cinq ans après, j’ai eu un poste de vacataire.
C’était en quelle année ?
J’ai été recrutée comme prof aux Arts Déco, et non plus comme intervenante, en septembre 90. Et comme cela t’a été signifié, [par Fabienne Vansteenkiste, dans une partie de son entretien qui n’a pas été conservée dans la version publiée] je suis restée vacataire très longtemps. Mon compagnon était déjà enseignant à l’Ensad quand j’ai eu ce poste d’enseignante. Lui n’a pas du tout eu le même parcours que moi : en 1984-85, il a été recruté sur concours sur un poste de vacataire en sérigraphie, puis sa progression de carrière a été facilitée par un glissement, de l’enseignement en sérigraphie vers le numérique, avec le statut d’assistant. À cette époque, quand les gens étaient en couple, il semblait normal de n’en privilégier qu’un, et à ma connaissance ça a toujours été les hommes. Ça m’a été dit à demi-mot par une personne dont j’étais proche et qui voulait que ma carrière progresse et ça m’a été beaucoup plus tard confirmé par un ancien directeur des études. Ce qui était extrêmement déprimant. Tu es sans moyen, ce n’est pas forcément l’École, c’est la société qui avait cette violence-là, et qui a toujours une part de cette violence. C’est un phénomène plus global, ça déborde l’École. Mais en même temps que moi un autre enseignant a été recruté sur le même poste et il n’a pas eu une progression de carrière plus glorieuse que la mienne. C’est une époque où les nouvelles technologies, on ne voulait pas trop en entendre parler bien qu’elles soient très présentes à l’École. On avait été seulement deux à candidater pour le poste, et le poste a été réparti en deux. Je suis restée vacataire au moins dix-huit ans… L’autre collègue recruté est resté vacataire plus longtemps, un homme, donc ce n’est pas aussi noir et blanc qu’on peut le penser, même si j’ai en tête deux femmes qui ont été dans le même cas que moi et qui ont eu des progressions de carrière lamentables.
Tu as eu droit à ce qu’on appelle un glissement ?
Je suis allée voir les Ressources Humaines en leur disant que si ça n’évoluait pas, je partais. On m’a dit qu’on comprenait ma situation mais qu’il fallait être patiente. Il y avait deux hommes qui étaient entrés après moi et qui venaient de glisser, je n’en pouvais plus. Là j’ai pris sur moi, et je suis allée voir le directeur, Patrick Raynaud [directeur de 2002 à 2008], qui lui m’a écoutée. Je lui ai dit : « Si je ne fais pas l’affaire, vous me le dites et je pars. Pour l’instant, on ne m’a jamais dit que je ne convenais pas au poste ». Il m’a dit : « Il n’y a rien à dire sur votre travail ». On a discuté longtemps, et à la fin il m’a dit : « Avant que je parte, vous aurez un poste ». Et avant qu’il parte, je l’ai eu. C’est peut-être la personne la plus humaine que j’ai rencontrée aux Arts Déco. Il a tenu son engagement. Son appui a été décisif. C’est Geneviève Gallot [directrice de 2008 à 2013] qui a signé mon contrat.
Pendant toutes ces années, tu étais reliée à un seul secteur, Design graphique ?
Non, au début des cours à l’Ensad, j’intervenais pour le pôle « image », c’était plutôt lié aux nouvelles technologies et c’était des cours que j’ai donnés pour Photo, pour Image imprimée et pour DG, en fait c’était des compétences que très peu de gens avaient, c’était sous forme d’ateliers, on était sur des projets. J’ai travaillé aussi pendant bien une dizaine d’années pour Design objet, sept ans après mon arrivée je pense. Comme j’étais vacataire, j’ai commencé à travailler à l’Ensci quasiment en même temps qu’à l’Ensad, j’y ai travaillé pendant très longtemps, et j’ai toujours fait du graphisme multimédia dans mon atelier professionnel. Cet ensemble de compétences a été mis en avant et j’ai travaillé en tant que prof de graphisme pour Design objet pendant sept ou huit ans, j’ai été très bien accueillie, j’avais juste un cours. Aujourd’hui je n’interviens plus qu’en Design graphique et j’expérimente cette année un cours multimédia pour les premières années [fig.26].
Ton expérience durant ces années dans l’École a-t-elle été spécifique, en tant que femme ?
Je n’en avais pas vraiment conscience, c’est plus les étudiants de DG qui m’ont renvoyé cette image-là. En me disant qu’ils étaient contents d’avoir une prof femme, alors que moi je ne voyais pas vraiment de différence. Au fil des ans, ça s’est beaucoup renforcé, cette idée-là : « Est-ce que c’est normal qu’on n’ait que des professeurs hommes ? »
Toi, tu ne sentais pas ce déséquilibre ?
Bien sûr que si, quand tu te retrouves dans une réunion où il y a quinze personnes et que tu es la seule femme, tu te poses des questions quand même. Mais ils étaient à la fois habiles et condescendants : « Tu es bien avec nous… ». Je pense qu’ils n’en avaient pas conscience, c’est très nouveau de remarquer qu’il y a peu de femmes. Je ne suis même pas sûre que ce soit dans leurs préoccupations. C’est mis en avant actuellement mais est-ce que ça correspond à une envie profonde ? Je n’en suis pas sûre.
Tu te sentais seule ? On t’écoutait ?
C’est particulier, chez moi je ne suis entourée que de garçons, ce n’est pas quelque chose qui me semble être une difficulté. Mais quand même, petit à petit, tu vois le recrutement étudiant en DG qui se féminise : à un moment il y a eu beaucoup plus de filles que de garçons – ça avait toujours été pratiquement équilibré dans le secteur, sauf ces dernières années. Là tu te dis : j’ai des étudiantes extrêmement performantes, qui ont une patte particulière, qui ont des idées et après on ne les retrouve pas dans le paysage du graphisme, c’est un monde extrêmement masculin. Je ne suis pas une grande communicante, donc je prenais assez peu la parole, c’est dans mon caractère. À un moment, plusieurs m’ont dit : « Mais Françoise, il faut que tu sois responsable du groupe de 2e année », ça je l’ai fait pendant pas mal d’années. Et là il y avait une écoute, le fait d’avoir ce positionnement avait modifié mon statut.
C’était une forme de reconnaissance.
Tout à fait. J’ai eu des très bons rapports avec plusieurs de mes collègues et on a très bien travaillé ensemble mais par contre j’ai tellement entendu des choses pas sympathiques sur d’autres personnes… que je me dis soit je suis invisible, soit ils ne se rendent pas compte…
Que tu es une femme ?
Oui (rires). J’étais un de leurs potes. Au tout début, deux ou trois m’ont dit : « Françoise, tu ne peux pas savoir comme ça fait du bien de ne pas se retrouver qu’entre mecs en réunion ». Mais ils avaient des propos sur des enseignantes qu’ils n’auraient pas sur des enseignants. Là ça a beaucoup évolué, il y a encore des choses que je trouve bizarres, on est quand même que quatre femmes, la progression est importante mais on est loin d’un équilibre.
Est-ce que faire partie d’un couple, ça t’a renforcée dans le secteur ?
Non, je suis extrêmement discrète, pendant des temps et des temps personne ne l’a su. Après, il y a un prof, hors du secteur, qui a fait beaucoup pour essayer que les choses se passent mal pour moi et qui a pris un malin plaisir à me présenter comme la femme de. Femme de, fille de, ce n’est pas normal. Je l’ai entendu un nombre de fois à l’École… J’ai l’impression qu’ils ont besoin de se justifier de notre présence et quand ils ne sont pas très malins, ça passe par ça. Quand je constate cela, je m’éloigne, je n’ai pas vocation d’éducation de mes collègues. Il y a un domaine où je les trouve parfois très rudes et là je réagis, peut-être parce que je suis moins concernée, c’est quand j’entends des propos homophobes qui sont quand même assez courants dans l’École, le plus souvent en l’absence des étudiants mais j’ai eu aussi des étudiants qui s’en plaignaient. J’en ai entendu assez souvent au niveau des jurys, et ça je n’ai pas laissé passer, je ne peux pas, et on m’a toujours dit soit : « Mais tu sais bien que je plaisantais » ou « Ah, je t’ai choquée, excuse-moi, ce n’est pas vraiment ce que je voulais dire ». A un moment il a été dit qu’il fallait absolument féminiser les jurys, j’ai donc été sollicitée tous les ans. Et en fait c’est là où j’ai commencé à rencontrer d’autres collègues d’autres secteurs et où je me suis rendu compte qu’il y avait d’autres femmes dans l’École.
Des propos sexistes, tu en as entendus dans ta carrière ?
Ce n’est pas dit comme ça. La façon dont ta reconnaissance est perçue n’est pas au même niveau. Il y a aussi le fait qu’on t’affecte à un secteur qui n’est pas le tien, on m’a souvent assimilée à Design textile ou Illustration, c’est assez révélateur. Une femme doit beaucoup plus faire ses preuves qu’un homme, on remet beaucoup moins en question les compétences d’un homme que les compétences d’une femme. Ça fait partie de ma génération, on nous a fait croire qu’on avait gagné des choses, mais on a dû prouver tout le temps, beaucoup. Et ma génération s’offusque peut-être moins facilement, on a été hors cette conscience-là pendant un certain moment. Moi j’ai connu une jeunesse où les hommes sifflaient, qu’est-ce que tu fais contre ça ? Tu te dis, je n’entends pas, c’est tout. Le niveau de tolérance n’est pas le même pour tout le monde. J’ai un degré d’abstraction qui peut aller très loin. Chez les étudiantes, il y a eu un virement il y a cinq/six ans : on a des combattantes, ce qui n’était pas du tout le cas avant, cela se faisait plus dans la nuance, avec beaucoup plus d’humour. Elles ont un côté très bravache, ça ne sert pas forcément la cause, c’est très caricatural, ça crée des choses dures à entendre. Ça m’effraie – ce n’est pas assez mesuré pour moi. Et ça impacte les faits, par exemple, lors d’une réunion, il nous a été dit que s’il y avait un recrutement, ça devait être une femme, que c’est un critère primordial, pour moi c’est difficile à entendre, ça fausse la chose, ça braque. Je suis plus pour un principe égalitaire. Pas pour une mesure réparatrice. Un collègue a dit : « En fait on a tout faux, parce qu’on est tous blancs ». La diversité doit être à tous les niveaux.
Oui, c’est un problème la blancheur de l’École. L’idée c’est de rééquilibrer je pense.
Je suis d’accord et je le comprends mais ça coince quelque part pour moi quand ça devient de fait non égalitaire.
Elles te le disent pourtant que c’est important que tu sois une femme.
Depuis quelques années, oui. Je leur parle de figures de femmes graphistes par rapport aux nouvelles technologies, qui n’ont pas été reconnues à l’époque où elles étaient en fonction, comme Muriel Cooper, qui a co-fondé le MIT Media Lab, elle avait une conception de l’image numérique absolument fabuleuse, elle était sur des parcours à trois dimensions, l’information n’était plus à plat, ce qui était fou pour l’époque. Les femmes graphistes, c’est très peu documenté, il y a des blocages. Je leur parle de Vera Molnar ou des œuvres troublantes de Kate Cooper sur le corps digital féminin, aussi de Warja Lavater, c’est plus proche de l’illustration mais pour moi c’est du graphisme, elle a fait toute une collection où elle a repris des contes pour enfants, des formes géométriques, un travail magnifique.
Les étudiantes, elles faisaient des travaux adressés aux enfants ?
Non, très peu, on a eu quelques grands projets, assez intéressants, mais ils font les mêmes boulots à la fin, chez nous, filles ou garçons.
Les garçons, ils se comportent comment avec toi ?
Normalement ! J’ai eu une seule année difficile il y a deux ou trois ans. C’est la seule fois où j’aurais pu me dire : « Je suis une femme et je suis vieille, et là ça ne leur plaît pas ». Je les ai pris en aparté et on a discuté, voilà, ça a suffi. Devant une grosse pointure du graphisme, je ne sais pas s’ils auraient essayé la même chose. Il y a aussi du jeunisme maintenant : ou peut-être n’en avais-je pas conscience avant, mais je ne pense pas que ça atteigne seulement les femmes, ce sont des collègues masculins qui me l’ont fait remarquer.
Toi, tes profs, c’était des hommes ?
J’ai eu principalement des profs hommes mais le rapport aux profs, moi je ne l’ai pas vécu comme les étudiantes actuelles. L’École, c’est un microcosme qui a été occupé par les hommes depuis des générations et des générations. L’état de fait était comme ça, mais on pensait pourtant qu’on avait autant d’opportunités que les garçons. Je suis la génération d’après 68, une génération compliquée, on n’a pas fait de révolution et en plus on a vu que la révolution d’avant ne menait pas à grand-chose bien qu’il y ait eu des progrès. J’appartiens à une génération un peu désillusionnée, la bof génération. Dans la vie d’après… j’ai beaucoup travaillé à deux, on allait tout le temps à deux pour les rendez-vous avec les commanditaires, on est plus fort à deux, c’est toujours plus riche, et j’ai eu pas mal de cas de figure où on pensait que le monsieur venait avec sa secrétaire. C’est sociétal, cela nous faisait beaucoup rire – ou au téléphone à l’atelier, on me disait : « Est-ce que vous pourriez laisser un message ? », « Mais bien sûr ! »… À l’École, en Sciences Humaines il y avait des femmes, mais c’était à peu près tout. Il y avait Agnès Castanié [enseignante de 1975 à 1993], qui est décédée, Michèle Guenoun [enseignante de 1969 à 2009], qui aurait beaucoup de choses à dire je pense, c’était un sacré personnage… Agnès, je l’adorais, c’était une grande intellectuelle, elle m’a ouverte à plein de choses, elle mélangeait l’histoire de l’art et la sociologie, c’était un cours très ouvert, je l’ai eu en 1ereet 2eannées, ça m’a fait comprendre beaucoup de choses. C’était un cours obligatoire, à cette époque souvent les cours de Sciences-Humaines étaient mêlés à la pratique – on était un groupe de quinze ou dix-huit, elle nous amenait à regarder notre travail d’une autre façon et à l’ouvrir sur le monde.
Tu as eu Margo Rouard[enseignante de 1978 à 2008] ?
Oui, je l’ai eu en année de diplôme, c’est aussi un bon souvenir. Elle défendait l’égalité dans le métier, quand je l’ai eu comme collègue c’est elle qui m’a fait comprendre que les femmes dans le secteur on n’était pas bien loties. Elle a toujours dit les choses, direct. C’était une période où il y avait les ex-Grapus et il y avait les Suisses, c’était conflictuel.
Comme étudiante, tu n’as pas rencontré de formes de sexisme ?
Non, c’est rare qu’on m’ennuie en fait, mais j’ai des souvenirs d’étudiantes qui ont réellement été harcelées en vidéo et en photo. A la fois sur un terrain psychologique et sur un terrain sexuel. À cette époque-là, la prise de conscience de tout ça n’était pas très présente. C’était à chacun de se défendre et les limites étaient où chacun les posait. Mais je me souviens qu’un de nos profs de graphisme nous disait toujours : « Dans la vie, tu n’as que ta bite et ton couteau ». Un jour, je lui ai dit qu’on pouvait formuler les choses autrement, je pense qu’on était sur un terrain d’incompréhension totale. Ça correspond à une époque, il faut replacer les choses au moment où elles ont été dites, maintenant ils ne se le permettraient pas.
Aujourd’hui, les femmes qui sont avec toi, dans ton secteur, tu as le sentiment qu’elles sont maltraitées ?
Oui, et je ne sais pas ce qui se dit sur moi quand je ne suis pas là… J’entends des choses qui ne sont pas normales, pas justifiées. Je suis dans un secteur qui est très masculin, la légitimité n’y est pas accordée par défaut à une femme. Si on regarde la liste des membres de l’AGI [Alliance graphique internationale], notamment pour la France, le ratio femmes/hommes (5/21) est très signifiant, mais encore une fois, à l’image de la société.
Tu t’es sentie illégitime ?
J’avais une double casserole. Le fait d’être une femme en était une. L’autre était que j’ai toujours fait un enseignement de graphisme en amenant la technique et la technologie, je continue à le faire. C’était quelque chose qu’il était très difficile de faire considérer comme un vrai enseignement. Les attaques ont été beaucoup plus de ce côté-là, les gens qui utilisaient les ordinateurs n’avaient pas la même aura que les autres. Comme si, comme je savais me servir de logiciels, je ne savais pas penser. Maintenant c’est très très rare qu’on en revienne à ça, mais ça a été compliqué.
Ces outils techniques, ils t’avaient été offerts à l’AII ?
Complètement. Ensuite, j’ai continué en autodidacte. L’Atelier était un lieu très ouvert et égalitaire. À y repenser, c’est aussi peut-être ce qui a contribué à ne pas me faire percevoir l’École comme un lieu discriminant, en tous cas pas plus que la société en général.
Et des femmes t’ont soutenue ensuite ?
Non, très clairement non. J’ai trouvé des soutiens masculins forts, des gens qui m’ont amenée où je suis, qui m’ont proposé des choses pour changer ma visibilité. Il y a eu au début Jean-François Depelsenaire, qui codirigeait l’Atelier, puis André Hatala, dans le secteur DG, m’a amenée à prendre beaucoup de responsabilités, c’était un très gros soutien, pour moi c’était quelqu’un d’extrêmement bienveillant et attentif. Il y a eu des attitudes très condescendantes et des attitudes encourageantes, le tout s’est équilibré. Là, les choses se sont un peu apaisées. Dans le département Design graphique, il y a toujours eu des grosses personnalités, et ce n’est pas un mal. Le graphisme, c’est un métier où il faut énormément se battre.

Anonyme B
avec
Lucile Encrevé
le 05.01.21

- Épanouissement
- Àge
- Sexisme
Entretien de
Anonyme B
le 05.01.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Qu’as-tu envie de répondre spontanément par rapport à notre sujet ?
Je trouve qu’en tant que femme, à l'École, on est quand même plutôt bien traitées, on est préservées. Et ces dernières années, ça s'est largement amélioré. J’ai un exemple à te donner au niveau du ministère. Je travaille à temps partiel, je suis à 80%, je ne travaille pas le mercredi pour m'occuper de mes enfants. Au mois de novembre, on a reçu à titre exceptionnel une prime pour tous les gens qui sont à temps partiel parce qu'ils considèrent que ce sont souvent les femmes qui sont à temps partiel pour s'occuper des enfants et donc il y a une prise de conscience de ça et ils nous ont donné une petite prime ponctuelle. C’est lié à la charte égalité femmes-hommes au Ministère de la Culture. C’est tout nouveau, et c’est du concret. À l’École aussi par exemple ils ont fait en sorte qu'il n’y ait pas de réunion après 17 heures, ce qui n’est pas mal. Actuellement, je n’y ressens plus de sexisme. C’est peut-être lié à la charte de l’École [fig.27].
Tu évoques tes enfants : tu les emmènes à l’École ?
Oui, pendant les Portes Ouvertes. Une année, pendant les Portes Ouvertes, ils avaient pris quelqu’un, une animatrice, pour garder les enfants de tout le personnel qui travaillait : ça leur permettait de voir le boulot de leur maman.
Qu’entends-tu par « ça s’est largement amélioré » ?
C'est peut-être lié à l'âge, mais, quand j'étais plus jeune, il y avait un peu plus de sexisme, plus de réflexions moins sympathiques. Des remarques, des regards d'hommes un peu déplacés, que je ressentais plus avant. Avant, j’étais dans un service plus masculin. C’était moins évident pour moi, j’étais beaucoup plus jeune, on m’a prise pour une étudiante pendant longtemps, on me le faisait ressentir. Tu sentais que tu étais une fille, dans un milieu d’hommes, donc forcément tu n’y connaissais rien… Et là, j’ai senti certains regards un peu déplacés, mais pas de la part de tout le monde. Des fois, certains, au lieu de me regarder dans les yeux, me regardaient ailleurs. Ça, je l’ai ressenti. Il y avait un enseignant en particulier, qui regardait ta poitrine, mais il le faisait à toutes les femmes. Quand tu es plus jeune, c’est plus compliqué, tu es plus vulnérable ; après, tu prends plus d’assurance. J’avais une collègue d’un autre service, qui était très jeune, qui m’avait rapporté des propos vraiment sexistes qui lui étaient faits par des hommes de l’administration – des commentaires sur son physique, devant elle. Moi, je me souviens d’une réflexion, et ça venait d’une femme, qui avait dit à mon propos : « Quand on pourra embaucher un vrai collaborateur, ce sera bien ». Forcément tu es une fille, et en contrat précaire, donc tu es un faux travailleur : ça, ça m’avait blessée.
Dans tes supérieurs hiérarchiques, est-ce que ça change quand ce sont des femmes ?
Je pense que ça dépend franchement des personnes. De toutes manières, à l’École, on ne te met pas de bâton dans les roues si tu es une femme. Si tu as besoin de partir plus tôt parce que tu as un problème personnel, il y a quand même de la souplesse et plutôt de la bienveillance. Les directeurs, il y en a qu’on a beaucoup croisés. Je me souviens de madame Gallot [Geneviève ; directrice de 2008 à 2013], à l’époque le service dans lequel je travaillais était en face de son bureau, elle venait très souvent, elle était très en demande. Elle avait ses idées : il fallait suivre. Et ça dépend beaucoup des générations. J’étais dans les premières à avoir fait une demande de télétravail, j’ai un métier qui s’y prête bien ; une ancienne responsable, qui était d’une certaine génération, m’avait quand même sorti : « Si c’est pour ranger vos placards ! ». Est-ce que c’était parce que je suis une femme ? Je ne sais pas.
Tu sens de la solidarité féminine au niveau de l’administration ?
Non, pas particulièrement, même s’il y a pas mal de femmes au final.
De la part des enseignants, tu as entendu des petites phrases qui posaient problème ?
Je me souviens de trucs qui ne me concernaient pas directement, pendant les entretiens des jurys de concours. Là, il y avait des profs sexistes, des profs qui maintenant sont partis à la retraite, qui regardaient les décolletés des candidates ; certains profs ne se gênaient pas pour faire des commentaires sur leur physique. C'était il y a longtemps, parce que, maintenant, je ne fais plus secrétariat de jury de concours.
Les enseignants étaient corrects ?
Parfois, on se sentait un peu comme des larbins, tu étais là pour faire la petite main, ce n’était pas agréable. Après, ça dépend des jurys, il y a aussi des jurys qui demandent l'avis des secrétaires de jurys.
Et quelles sont tes relations avec les étudiantes ? Dans ton service, tu les valorises ?
On fait attention à ça, la place des femmes, c’est une thématique qui revient et qu’on relaie. Prochainement, on va faire un focus sur Anne Bourrassé [ancienne étudiante, curatrice indépendante, responsable du projet féministe Contemporaines]. À l’École, les filles sont quand même assez mises à l'honneur et plutôt bien défendues. Dans ma vie personnelle, j’y fais attention, c’est une question qui me touche : j’ai deux filles, ça change ton regard, on se demande comment les préparer sans les inquiéter. Voilà, d’une manière générale, à l’École, on est plutôt bien traitées, on a aujourd’hui des bonnes conditions de travail. Je ne ressens pas de sexisme ou de choses comme ça actuellement.

Rachel Marsil
étudiante
depuis 2017
avec
Alexandra Piat
le 01.12.20

- Représentation
- Engagement
- Silence et parole
- Sororité
- Malaise
- Intersectionnalité
- Bienveillance
- Liberté
- Soutien
Entretien de
Rachel Marsil
étudiante depuis 2017
le 01.12.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Rachel Marsil, j’ai vingt-cinq ans. Je pense me définir comme une femme cis [cisgenre, dont l’identité de genre correspond au genre qu’on lui a assigné à la naissance] et je suis métissée franco-sénégalaise. J’ai toujours grandi dans ma famille française et ce côté sénégalais m’est assez inconnu. Je suis en cinquième année en Design textile et je suis arrivée en deuxième année après avoir fait un BTS textile à Lyon, en étant passée par d’autres formations. Je vis en banlieue.
Je pense que ma vision du textile va vers un textile narratif. Rien qu’en disant ça, c’est un moyen d’exprimer ma manière de voir les choses.
Est-ce que par rapport à ton genre et ton expérience de l’école, il y a quelque chose que tu as envie de raconter spontanément ?
Mon secteur est majoritairement féminin dans l’ensemble, que ce soit au niveau des élèves ou de l’encadrement pédagogique. Pour moi, c’est une espèce de cocon dans lequel je me sens à l’aise, car on me permet d’évoluer librement. Je sens de la bienveillance à mon encontre et une volonté de compréhension de la part des personnes qui me suivent. Peut-être que je n’ai pas ressenti un tel accompagnement lorsque j’ai dû sortir de mon secteur que ce soit pour les MRC ou inter-pôles, mais je n’ai jamais été vraiment confrontée à des discriminations durant mon cursus.
Que ce soit pendant le concours ou dans les cours ainsi que dans ta pratique, est-ce que l’on t’a déjà renvoyée à ton genre ou à ta race sociale [à différencier de la « race biologique », qui elle, n’existe pas], à tes origines ?
J’ai été une personne chanceuse parce que je n’ai jamais vraiment subi de choses qui m’aient fait écarquiller les yeux en me disant « Mais qu’est-ce qu’il se passe là ? ». J’ai toujours été assez protégée du côté du genre. En tant que personne racisée [qui appartient à l’un ou plusieurs des groupes sociaux subissant le racisme] c’est vrai que j’ai pu être amenée à me sentir en décalage, mais cela résulte d’une ambiance générale plus que de mon accompagnement en particulier. Que ce soit en lien avec l’image que je renvoyais ou de là d’où je venais. Par exemple, je vis en banlieue et ai un schéma familial particulier et parfois je l’ai un peu senti. C’est pour ça que dans mon travail, il y a toujours cette question de l’exotisme qui revient, la question de ce que mon corps renvoie. Ne serait-ce que dans mes travaux, quand je parle d’exotisme ou de l’identité, il peut vite être attendu de moi des choses comme des références au wax qu’on me suggérera naturellement. Ce n’est pas forcément ce vers quoi je veux aller. Mon grand projet va être également sur cette question du fantasme et du réel et comment pouvoir détourner tout ça. Alors oui, ça, je l’ai pas mal senti et c’est pour ça que j’en joue parce que dans un sens, c’est ce qui permet de questionner les gens, d’ouvrir les yeux sur les a priori. Je pense que je suis une personne très résiliente donc, je sais faire avec ce qu’il y a, tout en étant dans une volonté de faire entendre des expériences de vie, des questionnements autres.
Quel a été le sujet de ton mémoire ? Et est-ce que tu peux dire que ta pratique est engagée ? Quelle que soit la lutte sociale qui te touche, est-ce que parfois ça imprègne ton travail ?
Je le pense totalement, oui et de plus en plus. Notamment dans mon mémoire qui s’appelle En quête de soi, enquête par l’image. Étude de la circulation culturelle des images [dirigé par Francesca Cozzolino, 2020] qui pose cette question de ce que notre corps peut renvoyer en tant que personnes racisées et comment est-ce que cette construction de l’autre est venue s’immiscer dans les esprits ? Comment personnellement en tant que personne racisée j’ai pu me construire socialement aujourd’hui et les liens que l’on peut trouver dans l’histoire.
Pour revenir sur mon engagement ça s’est fait vraiment petit à petit, parce que je pense qu’il y a une sorte de tabou au sein des personnes racisées, métissées, ou du moins il y a souvent un questionnement qui arrive peut-être plus tardivement en fonction des histoires de chacun·e. Il y a toujours cette question du métissage — mais le terme de métissage en lui-même peut être un peu péjoratif - qui va vers l’oubli d’une partie de soi et de son histoire pour mieux se conformer à la norme, ne pas recevoir des remarques… Sachant que la question de l’identité, du métissage, c’est très intime. On ne pourrait pas se permettre des choses pareilles (poser des questions relevant de la sphère intime) envers des personnes dont l’apparence apparait comme moins « exotique » de prime abord. Donc, oui, mon travail s’engage en ce sens-là. Je fais également beaucoup de peinture qui aborde pas mal la représentation de personnes noires : c’est faire entrer une autre représentation dans ce qu’on a la plupart du temps aux Arts Déco. Je pense qu’on est très peu qui peuvent vraiment parler de ces sujets-là en tant que personnes concernées à l’école. Autant se faire une des voix qui peut s’exprimer là-dessus.
Est-ce que tu as le sentiment d’avoir été encouragée dans ces différents travaux engagés ? Est-ce qu’il y a eu une bonne réception de ton travail ?
Dans mon secteur, oui, parce que je pense que les personnes sont ouvertes à l’histoire que l’on veut porter et ce qu’on a à dire. La discussion permet toujours de replacer les choses, même lorsque quelques formulations sont maladroites. Dans mon secteur, ma volonté d’aborder la question de l’identité a été bien accueillie et on m’a questionnée, certes sur des choses un peu intimes, mais c’était toujours avec beaucoup de précaution. Évidement chaque personne s’engage à sa manière, et le ton donné à un projet peut être plus ou moins direct en fonction de l’aisance de la personne qui partage son expérience à travers sa création. Dans mon approche, j’essaie avant tout de favoriser le dialogue, qui reflète mes propres questionnements quant à la définition de l’identité. Tout ce que j’ai fait a été bien accueilli parce que j’ai toujours été dans l’échange pour raconter des choses. C’est pour ça que je parle d’un textile narratif. Parce que ce n’est pas juste faire une pièce posée là, c’est vraiment : voilà pourquoi j’ai fait ça et je vais vous parler de mon histoire. Par la pratique il est question de se réapproprier son corps, et de mieux assimiler/comprendre les images qui nous sont données à voir, leur donner un sens du point de vue de la construction du moi entre une apparence donnée et une histoire de vie. Dans ce sens-là, ça a toujours été assez bien pris et compris. Encore une fois, j’ai été chanceuse d’être dans ce secteur textile parce qu’il y a aussi dans l’histoire du textile tellement de mélanges… Les choses sont très circulaires à l’échelle du globe donc je pense qu’il y a une appréhension moins forte par rapport à la question de l’identité dans le textile.
Ces remarques parfois maladroites, tu sens que c’est parce que les personnes en face ne sont pas concernées personnellement par tes sujets ? Il y a une sorte de réticence à donner son avis par manque de pertinence peut-être ?
Je dirais que ça peut être lié à la peur d’utiliser les mauvais mots, ou justement d’y aller franco sans se douter que certaines choses me sont personnellement sensibles. Sachant que c’est une expression de l’intime, ces questions plus ou moins pertinentes, je sens que c’est ne pas vouloir parler pour ne pas être à côté de la plaque, pour ne pas froisser. Mais ça ne me gêne pas du tout qu’on me questionne et qu’on critique mon travail. Parce qu’il n’y a pas seulement un côté très autobiographique dans ce que je fais, il y a aussi une démarche derrière, même si par moment j’ai l’impression qu’elle ne parle qu’à moi. Il faut qui y ait des critiques sur tout ça. Normalement, le travail est censé parler à tout le monde et je n’ai pas envie non plus que ce que je fais ne soit pas compris et mis de côté, comme quelque chose d’esthétique qu’on ne comprend pas vraiment. Il faut questionner et dans l’équipe enseignante, parfois oui je l’ai pensé, ils ne se permettaient pas de critiquer ce que je faisais parce qu’ils avaient peur d’être trop maladroits.
Dans le questionnaire [envoyé dans le cadre du projet Chères toutes], il y avait plusieurs personnes qui disaient avoir été agacées par le manque d’expression de l’école au moment de la mort de Georges Floyd, des manifestations Black Lives Matter et pour Adama Traoré. Qu’est-ce que tu as pensé de tout ça toi à ce moment ?
Personnellement, en tant qu’étudiante d’une école qui fait partie intégrante de ce monde, j’aurais trouvé juste que l’école considère la position de ses étudiants, de toutes les personnes qu’elle emploie, dans les derniers mouvements qu’il y a eu. Au lieu de ça, alors que le compte instagram de l’Ensad était actif, il n’y a eu aucune démonstration de soutien, aucun mot de prononcé, et ce silence pose des questions. Parce qu’on est toujours dans un esthétisme très « Ensad » et il est vraiment dommage de ne pas avoir saisi l’occasion, non pas de manière opportuniste, mais bel et bien pour montrer « nous sommes contre l’injustice », que ces voix-là existent, et qu’au sein même de l’Ensad elles sont reconnues et soutenues. C’est important.
Je me souviens dans les premiers temps où j’ai voulu postuler dans les écoles d’art et autres, ne serait-ce que par le fait que je vienne de banlieue ou que j’étais racisée, on m’a dit, lors d’un entretien pour une bourse d’études « Mais tu sais, dans le domaine de la mode et du textile, il y a tellement d’autres choses. Tu pourrais être comptable ». J’avais alors de très bons résultats scolaires, suivais des cours d’histoire de l’art comme option facultative et avais eu la chance de suivre des cours de dessin académique en plus de ma pratique personnelle. Il y a une invisibilisation des possibilités qui sont données et mettre en avant des personnes racisées, des personnes qui ont une voix ça serait bénéfique, ne serait-ce que pour la diversité au sein même du panel étudiant à venir.
En tout cas pour revenir à ce qui s’est passé cet été, qui était quand même le moment le plus fort de ces derniers temps, j’ai été déçue de constater ce silence. Ce n’était pas juste un silence habituel. On sentait que c’était un silence vraiment dans la retenue où l’école ne voulait pas se prononcer. C’était dommage parce que c’est un moment assez important pour une école d’art qui se veut dans la diversité, qui se veut dans le progrès. C’était le moment de prendre position et même avec tout ce qui se passe encore aujourd’hui. Quand on voit par exemple, pour « Charlie » [attentats du 7 janvier 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo] qui certes n’est pas comparable en termes de contexte, toutes les écoles d’art ont fait des projets, des liens… Ce qui montre bien que les écoles d’art ne sont pas « tenues » au silence. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en avant alors que là, ça touche une partie de la société, certes, qui n’est pas la majorité à l’Ensad, mais il aurait été temps de faire entendre aussi ces positions.
Est-ce que tu trouves du soutien auprès d’autres femmes, et aussi d’autres personnes racisées dans l’école ? Est-ce que vous en avez parlé entre vous ?
Oui, totalement. Mon entourage à l’Ensad est très majoritairement féminin parce que c’est là où je me sens le plus à l’aise et qu’il y a le plus de compréhension. Quant à la question du lien avec des femmes racisées au sein de l’école, nous sommes en lien (pour celles que j’ai pu rencontrer jusque-là) et le moment des mémoires nous a permis de mettre en commun des sentiments partagés. Nos thématiques venaient se regrouper pour former un bel ensemble de questions, de visions en rapport avec l’identité et la voix des personnes racisées. Il y avait vraiment une circularité des idées. Nous avons d’ailleurs fait un zoom en comité restreint en début d’année pour se tenir au courant de nos ressentis par rapport à nos grands projets et mémoires, et comment ceux-ci avaient pu être accueillis. Mais depuis, les choses et les occupations prenant de plus en plus de place on n’a pas eu l’occasion de se retrouver à nouveau, je suppose que c’est un bon signe. Comme je le disais, en Textile, j’ai pas mal de chance de mon côté, mais on a toutes des visions très différentes. C’est un bon point de partage en tout cas.
Dans ton questionnaire tu as évoqué le fait que dans d’autres secteurs, tu as eu l’occasion de constater un peu plus de sexisme que dans le tien, tu peux m’en dire un peu plus ?
C’était davantage dans le secteur Design graphique. C’était des cours ponctuels que ce soit inter-pôle [cours proposé dans un secteur pour les étudiant·es des autres secteurs], ou MRC [Modules Recherche et Création] et étrangement, je me suis toujours retrouvée avec des gens de Design graphique. C’était les moments où je me suis sentie le plus mal à l’aise. Les professeurs à qui j’ai eu affaire ne m’ont pas fait me sentir dans des conditions de travail agréables, et ils s’adressaient avant tout aux personnes qui les intéressaient laissant les autres de côté à mon goût. Il y avait aussi davantage de propos plus problématiques qui n’avaient pas lieu d’être. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans ce secteur, mais ça m’a fait encore plus me rendre compte comme j’étais bien « chez moi » en Textile et comme j’avais un peu peur finalement des autres secteurs et même des autres professeurs. J’ai toujours eu une appréhension assez forte pour les professeurs hommes, pour quelques raisons personnelles et ça ne m’a pas vraiment amenée à changer mon avis là-dessus.
Est-ce que tu peux développer pour les propos ou les choses que tu as entendues ?
Par exemple on était en cours avec un professeur, qui, à chaque fois, ne cherchait pas à savoir ce que les étudiants avaient fait, mais qui voulait juste se poser sur une chaise pour raconter sa vie. Et ça finissait toujours par parler de choses assez sexuelles, de ses expositions, de ses copines, etc. C’était très gênant quand il parlait aussi de choses qui ne choquaient pas à son époque, mais qui choquent aujourd’hui, comme si notre morale avait augmenté et comme si c’était nous qui n’étions pas assez ouverts d’esprit pour écouter ce qu’il avait à dire. J’étais assez choquée d’entendre tout ça. Finalement, je n’allais plus dans son cours parce que je m’y sentais trop mal à l’aise. De toute manière, il ne regardait pas ce que je faisais. Si c’est pour me poser, l’écouter avec gêne, devoir détourner le regard et rester là à l’écouter faire encore et encore ses discours. Non merci. C’était trop gênant et trop déplacé. Il y a un certain cadre à avoir dans le domaine de l’école et si le sujet s’y prête, alors d’accord, ça signifie que les personnes présentes sont prêtes à parler de ces sujets dans un cadre donné, le cours dont je parle ici n’était pas du tout l’endroit pour. Par exemple, je trouve ça très bien qu’il y ait eu un cours sur la sexualité en anglais. Les gens voulaient y aller, les gens voulaient en parler, mais quand on est dans un cours qui n’a rien à voir, ce n’est pas du tout ce qu’on veut entendre. Ce n’est pas l’endroit.
Tu disais que tu avais des appréhensions à être en contact avec des profs hommes par rapport au travail. Qu’est-ce que tu recherches et qu’est-ce que tu apprécies dans l’accompagnement des profs femmes à l’école ?
C’est peut-être très subjectif, ça l’est dans tous les cas. Mais je pense qu’il y a une meilleure compréhension des expériences de vie et de tout ce qui peut être partagé qui sera très implicite. Dernièrement, c’est quelque chose d’assez personnel, mais j’ai vécu des moments difficiles en lien avec des violences et justement, j’ai pu faire part de tout ça à mes professeures femmes qui, elles, ont très bien compris. C’était dit à demi-mot, mais j’ai senti une compréhension et une acceptation de la chose, comme de femme à femme. Pour le côté éducation, suivi, etc., j’ai un professeur homme, ça se passe aussi très bien, il n’y a rien à dire là-dessus. Mais je pense (en mettant ce cas de mon professeur masculin à part) qu’il y a moins d’appréhension rien que pour la manière de s’exprimer et la manière de se tenir, avec des femmes. Personnellement, j’ai eu des expériences où par exemple, mon ancien prof de BTS, à la suite de mon BTS, m’a envoyé des messages où il me proposait de venir chez lui. C’est pour ça qu’il y a toujours un rapport qui peut être mal compris de l’autre côté, qui me fait assez peur. Alors que de femme à femme, je le vois comme un lien de sororité ou de mentor, où je n’ai pas peur d’être comme je suis, où je ne suis pas dans la retenue, mais dans la vérité de soi avec l’autre, sans avoir peur que cela entraîne d’autres choses. C’est peut-être très cliché ce que je dis, mais c’est aussi mes expériences qui ont fait que j’ai pris un peu peur. Je suis une personne qui est assez enjouée, enthousiaste et j’ai peur que souvent, auprès de professeurs hommes, ce soit mal interprété comme cela a pu l’être et que ça me mette dans des situations que je ne comprenne pas du tout, alors que ça ne m’est jamais arrivé avec des professeures femmes. Jamais.
Est-ce qu’il y a des lieux dans l’école où tu n’es pas à l’aise pour ce genre de raisons ?
Ce sont des a priori parce que je ne me sens pas forcément à l’aise, mais je ne vais pas forcément trop sortir de mes ateliers. Les ateliers textiles sont un peu chez moi, car les autres ateliers me font assez peur, même si je ne me suis pas aventurée partout. Je sais toujours à peu près à qui m’adresser, par exemple à l’administration, où j’ai pu parler librement. Pour les autres ateliers, je ne pense pas avoir vraiment peur, mais plus ressentir de l’appréhension.
Ça t’a empêchée parfois de faire des choses dans différents ateliers de l’école ou est-ce que tu as quand même fait ce que tu avais envie de faire ?
J’ai quand même fait ce que j’avais envie de faire. C’est vraiment que parfois, je me suis dit que je n’avais pas envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, de devoir expliquer. Oui, je pense que j’ai pu faire ce que j’avais envie de faire, mais c’est aussi parce que le secteur textile, il est encore une fois assez privilégié, qu’on a déjà nos deux ateliers qui nous sont dédiés. C’est vraiment le secteur de la sécurité !
Est-ce que dans ta vie étudiante en général, tu t’es toujours senti à l’aise d’être une femme ? Comment est-ce que tu as vécu ton parcours ?
Globalement, je dirais assez bien, parce que j’ai su, dans un sens, trouver ma place là où je pouvais la trouver. Après, ce qui est pas mal encourageant, c’est d’avoir eu ces personnes à qui m’adresser qui, dans les moments où je me sentais un peu à part, pouvaient comprendre. Ce n’est pas forcément une question de genre, mais aussi une question de classe sociale. Parfois, je me suis sentie en décalage total avec ce qu’il pouvait y avoir à l’école et de pouvoir trouver des groupes… Ça a été assez facile à trouver finalement parce que ça vient facilement dans les discussions. Je pense que mon parcours aurait été totalement différent si je n’avais pas pu rencontrer des gens à qui je m’identifie un peu ou des personnes qui entendent et qui écoutent comme j’ai pu en trouver. J’ai été entourée de pas mal de bienveillance, donc ça a vraiment beaucoup joué. Je ne suis pas à plaindre de ce côté-là.
Est-ce que tu dirais que l’école t’a rendue plus forte ? Qu’elle t’a donné confiance dans tes capacités ?
Pour ma part, oui, totalement. Il y a eu cette bienveillance qui m’a accompagnée et cette « non-critique », qui maintenant peut être critiquable, mais qui m’a poussée à m’exprimer de manière plus libre. Je n’avais pas de barrières qui étaient mises sur mon chemin et donc on m’a laissé faire ce que j’avais envie de faire. Et ça, ça m’a vraiment aidée et je dis merci pour ça ! Parce que justement ailleurs, dans d’autres secteurs, je vois que pour des ami·es avec qui je discute, c’est un peu plus difficile. Et cette liberté qui m’a été accordée m’a aidée, ne serait-ce que l’accompagnement que j’ai pu recevoir pour mon mémoire. Tout au long de mon parcours, je suis tombée sur des personnes qui m’ont vraiment poussée. Notamment l’année dernière, j’ai rencontré Francesca Cozzolino, qui a été vraiment un moteur. C’était une super rencontre. Mon prof de peinture, par exemple aussi, avec qui ça s’est toujours très bien passé. Ils m’ont tous laissé aller dans les directions qui m’intéressaient. Aujourd’hui, je vois ne serait-ce qu’avec le grand projet, toute cette confiance qui m’a été accordée, elle est encore là. On ne va pas me dire aujourd’hui « Non tes questions, c’est peut-être trop esthétisant… C’est trop ceci… ». On me laisse vraiment faire ce que j’ai envie de traiter, dire ce que j’ai envie de dire par mon travail. On ne le questionne d’ailleurs plus aujourd’hui, ce qui est peut-être aussi le bon moment, car j’ai eu le champ libre pour construire les bases de ce que je suis aujourd’hui, et en ce sens, la critique me pousse à aller toujours plus loin et à m’affirmer, m’épanouir. Pour eux-mêmes (mes professeurs) je pense que de m’avoir suivie du début jusqu’à maintenant, ça permet d’ouvrir un peu les esprits vers d’autres pensées, d’autres visions et d’autres histoires, au sein même de l’équipe qui me suit. C’est vraiment un dialogue, quelque chose d’assez positif des deux côtés. Puis de l’école en tant que telle, même de l’administration, j’ai toujours reçu un soutien assez fort. Pour ça, je remercie vraiment l’école, que ce soit la psychologue, les aides financières de l’école, je me suis sentie soutenue et aidée dans mes difficultés.
Tu parles de ta directrice de mémoire, Francesca Cozzolino et je crois que tu as participé à la journée sur la créolisation par l’art et le design [Créolisation par l’art et le design ? Créer dans le tout-monde. Le mardi 17 novembre 2020 à l’École des arts décoratifs de Paris], est-ce que tu peux raconter pourquoi tu as participé et ton ressenti à ce sujet ?
J’ai participé pour présenter mon mémoire, qu’elle avait dirigé pendant un an, En quête de soi, enquête par l’image, étude de la circulation culturelle des images, en lien avec la globalisation. J’y ai participé pour parler à la fois de cette recherche et un peu de mon travail. J’y étais avec Charlotte [Attal, étudiante de 2016 à 2020] dans la dernière phase, qui était plutôt une table ronde. C’était une journée assez intéressante, ce genre de démarche est vraiment à mettre en avant dans l’école. Parce qu’au moment où on peut dire que l’école ne prend pas position par rapport à tous les mouvements sociaux qui se passent, ce genre de journées d’étude où on a de la discussion, des interventions de gens dans la création et la recherche, c’est vraiment un dialogue qui se fait bien et qui est accessible aux étudiants, aux personnes qui se posent ces questions-là et qui se sentent invisibilisées. C’est le moment où vraiment je me suis dit que mon travail pouvait être mis en avant et que je pouvais parler de ce que je fais autrement que lors de mes rendus et en tant que personne qui peut s’exprimer sur ces questions de société. C’était une belle opportunité et c’est aussi un bon moyen de montrer que les visions ne sont pas unilatérales. J’ai assez bien vécu cette journée même si elle était très universitaire. En tant que personne qui est dans la pratique, c’était quelquefois dur à suivre, mais je pense que c’est une bonne chose et qu’il devrait y avoir justement de plus en plus de journées, de moyens et de raisons de montrer le travail de gens qui ont envie de s’exprimer. Oui, c’est une belle opportunité.
Est-ce que pendant ton parcours au sein de l’école, tu as été témoin ou victime de violences, verbales ou physiques ?
Non, je n’ai pas eu affaire à ça. Je n’ai pas été témoin de ça du tout. Après, oui, c’est encore une fois grâce à mon cocon et je ne pourrais pas m’exprimer là-dessus. Je sais qu’il doit y en avoir parce que j’ai vu des choses passer, évidemment. Mais c’est toujours resté assez flou et un peu lointain de moi, dans le sens où je ne savais pas qui étaient les personnes concernées.
Tu as dit avoir vécu des moments de violence en dehors de l’école. Est-ce que l’école t’a bien accompagnée suite à ça pour que tu puisses continuer ta scolarité et vivre un peu mieux ces moments-là ?
Totalement. Je pense que c’est pour ça que, finalement, mon parcours à l’école est si positif ! C’est parce que j’ai toujours reçu cet accompagnement qui m’a aidé. Ce qui m’est arrivé, c’est arrivé en fin de troisième année. J’ai passé tout un été assez compliqué, vers décembre de l’année dernière j’étais vraiment à bout et je me suis dit que j’allais arrêter l’école parce que ça devenait trop difficile pour moi. J’en avais parlé à mes professeurs, qui ont toujours été assez ouverts, indulgents et qui m’ont aidée, qui m’ont dit que je pouvais m’absenter si c’était nécessaire sans poser de questions et ont admis la chose comme elle était. Quand je suis allée plus tard en parler à l’administration parce que j’étais dans une phase compliquée, j’ai été très bien reçue. C’est pour ça que je pense que c’est la relation femme à femme qui aide parce que ça a été pas mal de discussions avec Sophie Zouari [responsable du suivi des élèves et référentes contre les violences et les discriminations pour les étudiant·es]. Il y avait aussi Aurélie Zita [adjointe au directeur des études] et dès que je suis arrivée, j’ai été tout de suite accompagnée. On a pris du temps pour m’écouter, ce dont j’avais vraiment besoin. On m’a proposé de mettre en place un emploi du temps aménagé pour que ça m’allège. On m’a redirigée vers la psychologue de l’école, on m’a redonné des numéros et depuis, il y a toujours ce soutien et cet accompagnement : on prend souvent de mes nouvelles. Vraiment, c’est un soutien que je n’avais pas chez moi et qui m’a été très, très bénéfique. C’est pour ça que je me sens aussi bien dans l’école, c’est finalement un peu chez moi et c’est là où je peux parler plus qu’ailleurs. Je ne sais pas si tout le monde a eu cette chance-là, mais moi je l’ai très bien vécu.
Comme moi tu as dû vivre #metoo pendant ton cursus à l’école. Est-ce que tu te dis féministe et est-ce que l’école a participé à ça d’une certaine manière ?
Alors oui, évidemment, je pense que ne pas se dire féministe aujourd’hui, ça serait problématique. Je me considère comme féministe et je ne sais pas si l’école a vraiment joué un rôle dans tout ça. Je pense que c’est plutôt en lien avec le côté « classe de filles » très camarades en Textile où évidemment, les questions sont toujours venues sur le sujet et d’autant plus dans un secteur qui est très, très féminin. Donc l’école, ce qu’elle a pu jouer comme rôle là-dedans, c’est peut-être juste la mise en relation de gens qui avaient des idées et des opinions. Sinon, ce n’est pas vraiment à l’école que j’ai ouvert les yeux du tout, vraiment pas. L’école m’a permis d’avoir un déclic sur la question de l’identité, notamment grâce à Francesca. Après, je trouve que de plus en plus, il y a des femmes qui parlent, la parole se délie et les choses sont mises en avant. Au fond cette question du féminisme, même si elle ne m’est pas tant apparue à l’école que ça, je la retrouve dans les projets de certaines personnes, mais je n’ai jamais senti de mise en avant de ceux-ci. On peut le voir comme les questions de la journée d’étude Créolisation. Finalement, si on ne s’intéresse pas à ça, ce n’est jamais mis en avant. On ne découvre jamais des projets intéressants sur des thématiques particulières et ciblées.
Quand on a parlé de créer une association féministe [fig.28] à l’école avec d’autres personnes, c’est aussi ça que l’on voulait faire. Créer des moments communs où parler de nos projets, de nos sujets d’étude, etc. Je pense notamment à l’exemple des étudiant·es de l’Ensci qui font des petits événements de rencontre autour d’un thème avec des étudiant·es de différentes écoles qui viennent présenter leur sujet de diplôme ou leur mémoire. J’ai participé à l’une de leurs soirées et c’est très enrichissant.
C’est super intéressant et c’est bien de faire comme ça une mise en collectif. De ne pas toujours rester dans le côté très individuel du designer ou de l’artiste et de pouvoir discuter avec d’autres personnes. Finalement, c’est ce qu’on est toujours amené à faire. On travaille pour parler aux autres, amener du dialogue et se faire une voix qui amène à la réflexion.

Dominique Lesterlin
adjointe du directeur des études
de 1998 à 2007
avec
Lucile Encrevé
le 14.12.20

- Accueil
- Déséquilibres
- Sororité
- Dévalorisation
- Silence et parole
- Sexisme
- Écoute
Entretien de
Dominique Lesterlin
adjointe du directeur des études de 1998 à 2007
le 14.12.20 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Je suis restée en contact avec quelques étudiantes, des filles. J'aime beaucoup le dessin et il y avait à l'époque un secteur gravure. Et j'ai assisté aux soutenances de deux graveuses, Marjolaine Pigeon [diplômée 2001] et Agnès Prévost [diplômée 2005], j’ai des gravures d’elles, je vis avec. Marjolaine Pigeon fait de la peinture abstraite et illustre des livres de poètes ou de la littérature. J’ai perdu de vue Agnès Prévost… mais je suis en contact de temps en temps avec Sarah Fouquet [diplômée 2004], une illustratrice qui est prof à l'école d'art de Caen, talentueuse, engagée du côté du syndicalisme enseignant (elle était dans le secteur illustration).
Vous, qu’est-ce qui vous a amenée à l’École ?
Ce qui m'a amenée à l'École, c'est très simple. J’étais responsable de la communication de la Direction de l'architecture depuis 1996. Puis la Direction du patrimoine a dû rejoindre la Direction de l'architecture pour former la DAPA (Direction de l'Architecture et du Patrimoine). Et on passait donc d'une petite direction d'une centaine de personnes à trois-cents personnes. Et moi, ça ne m'allait pas du tout. J'aimais beaucoup le milieu de l'architecture parce que j'avais travaillé quinze ans à l'École d'architecture de Grenoble ; le patrimoine me plaisait beaucoup moins. Donc, mon arrivée aux Arts Déco s'est faite par le plus grand des hasards. Un jour, j'ai déjeuné avec une amie, Élisabeth Vitou, qui était à la direction de la communication de l’École, et il se trouve qu’ils cherchaient quelqu'un à la direction des études. Donc, rapidement, j'ai eu un rendez-vous avec Elizabeth Fleury, qui était à l'époque la directrice adjointe de Richard Peduzzi [directeur de 1990 à 2002] (elle est partie ensuite en même temps que lui, elle l’a suivi à la Villa Médicis). Et puis j'ai eu un rendez-vous avec lui. Mon transfert s'est fait facilement et rapidement. Je suis arrivée en octobre 1998, comme adjointe du directeur des études, René Lesné. Il y avait encore une partie de l'enseignement qui se faisait à la Manufacture des Œillets à Ivry, et puis tout le monde a réemménagé rue d'Ulm, ça devait être en 2002. J'étais au premier étage – côté Érasme. Je n'avais pas un bureau seule, je partageais mon bureau. On était deux ou trois, avec Martine Ahssen, la secrétaire du service, qui m’a très très bien accueillie.
Vous avez quitté l’École en quelle année ?
En 2007. Pendant toutes ces années, j’ai fait tourner le service, le service pédagogique, les stages à l’étranger, et une part importante de la charge était consacrée à l'organisation du concours, pour lequel on a modifié beaucoup de choses. Au départ, il y avait des jurys assez lourds, et on a instauré des petits jurys très légers de trois personnes, tournants, de façon à ce que personne ne se coince dans un système. Et on a introduit la présence d'une personne de l'administration. Tous ceux qui ont participé étaient extrêmement contents parce qu'ils voyaient concrètement la vie de l'école et le travail en train de se faire.
Vous étiez attentive à l'équilibre homme/femme ?
On répartissait les femmes, on va dire… Chez les enseignants, il y avait plus d'hommes que de femmes. Des enseignantes, il y en avait dans le secteur textile, qui était un secteur avec beaucoup de débouchés, un secteur extrêmement porteur. En gravure, il y avait Françoise Roy [enseignante depuis 1989; elle a dit au sujet de Mireille Miailhe dans une conversation téléphonique avec L. Encrevé le 20 mars : « Elle m'a beaucoup appris. Je l'aimais beaucoup. Elle m'avait invitée chez elle à prendre le thé, elle nous a montré ses dessins. On était épaté »]. Il y avait une coloriste, Martine Duris [enseignante de 1980 à 2006], qui avait de grandes compétences… quelques femmes, donc (il faudrait citer aussi Colette Martin, Véronique Breton, accessoiriste, Nathalie Brès [fig.29] , trop tôt disparue, Françoise Darne en Scéno, Arlette Ginioux en dessin, Roxane Jubert, Elisabeth de Senneville… ). Non, c'est sûr que les hommes étaient très majoritaires, ça c'est certain. Alors que, le paradoxe, c’est qu’il y avait beaucoup d’étudiantes, on voyait un nombre croissant de filles arriver à l’École.
Le recrutement des enseignants, vous vous en occupiez ?
Non, pas du tout, c’était vraiment la direction. Je trouvais que ça aurait été intéressant de recruter plus systématiquement des femmes. À l’époque on ne raisonnait pas encore en termes de parité, c'était un peu dommage, mais c'était comme ça. L’arrivée des femmes enseignantes, je la percevais de façon très positive, ça équilibrait un peu.
Et au sein de la direction, de l’administration, ça vous semblait équilibré ?
Les chefs de service étaient essentiellement féminins. La directrice technique c’était Françoise Peyronnet, qui était arrivée un peu avant moi. Elle a beaucoup travaillé dans le théâtre avec Peduzzi et Chéreau et elle était venue pour assurer les travaux de l'École, puis elle est restée diriger le service technique. Elle avait un service compliqué à gérer, il y avait de la bagarre mais elle a su s'imposer parce qu'elle connaissait très bien le milieu, parce qu’elle était énergique. Elle n’avait peur de rien. La conservatrice-documentaliste bibliothécaire, c’était Françoise Giroux, qui avait travaillé longtemps à Pompidou, qui a quitté l’École quelques années après moi. Ensuite à la direction informatique, il y avait Martine Eberhardt – qui y est toujours – et nous avons été heureuses de voir arriver une femme à ce poste technique. Donc voilà, avec ces réunions de chefs de service, on était exclusivement des femmes et on s'entendait bien, on se serrait les coudes. Il y avait beaucoup d'échanges. Dans mon service, il y avait surtout des femmes. Dans les autres, il y avait des hommes. Tout ça se mélangeait assez bien.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre carrière dans l'École, elle a été spécifique parce que vous êtes une femme ?
Je ne me suis absolument jamais posé la question. Pour moi, l’École n’a jamais été une question de genre. En tout cas, ce que je peux noter c’est que dans mon équipe, il y avait beaucoup de gens, des femmes d'ailleurs, majoritairement, avec des petits postes et des petits salaires et des grandes compétences et une grande conscience professionnelle. Je me souviens d’Audrey Durrieux, qui avait pris le concours de première année complètement en charge. D'accord, ils ont des vacances, d'accord la vie n’est pas désagréable à l'École, mais ils ne progressent pas, c’est les limites de la fonction publique.
Vous faisiez partie des instances. Et là, vous aviez quand même pas mal d'enseignants-hommes en face de vous. Est-ce que vous le sentiez ?
Oui, on sentait que c'étaient des hommes parce que très souvent ils aimaient se mettre en valeur, ils aimaient parler, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire.
Est ce qu'il y avait quand même quelques femmes dont vous vous rappelez qui assistaient à ces réunions ?
Non, il y avait des profs femmes mais pas de coordinatrices je crois, pas tellement de femmes au Conseil d’Administration, pas d’enseignantes au Collège des coordonnateurs.
Vous étiez la seule femme ?
Il y avait de temps en temps Françoise Peyronnet.
Et dans ces réunions, et plus généralement dans l’école, vous n'avez jamais été témoin ou la cible de propos sexistes ou de plaisanteries ?
Oui, il y avait des plaisanteries un peu grivoises, comme dans toutes les écoles d'art, les écoles d'architecture, mais ça n'allait pas très loin. Je n'y ai pas fait attention. J'ai grandi avec trois frères… Des propos sexistes primaires, il y en avait certainement, mais c'était l'époque. Pour moi, l’École n’était pas sexiste, j’en garde un très très bon souvenir, j’ai beaucoup aimé y travailler.
Les relations avec les enseignant·es et les étudiant·es étaient bonnes ?
Oui, on était une équipe chez qui les enseignants et les étudiants trouvaient un accueil, une écoute. Ils venaient beaucoup nous voir. On était un lieu ouvert, un lieu d'échanges. Il régnait un très bon esprit dans cette direction des études. J'avais une équipe sympathique et efficace.
Est-ce que vous sentiez une solidarité féminine entre vous ?
Oui, oui, je crois. À part Francis Dumas [ancien directeur des études] et un délégué syndical, on n’était que des femmes. On avait des réunions de service hebdomadaires, on écoutait chacun, on essayait de régler les problèmes, on était dans le même bateau. C'était très chaleureux, très sympathique. J’ai des photos de réunions à l'occasion d'une naissance – Audrey qui vient présenter son bébé.
Ce cadre d’écoute, on peut le lire comme genré, comme féminin – une responsable au sein de l’administration m’a parlé un jour de vous comme une personne très humaine, respectueuse, sachant valoriser son équipe. Et les étudiant·es, ils ou elles vous confiaient leurs problèmes ?
Oui, il y avait beaucoup d'attention portée aux étudiant·es, à leurs problèmes personnels. Je voyais beaucoup les étudiant·es à problème – problèmes de santé, familiaux, de bourses, problèmes pédagogiques.
Si une violence arrivait, est-ce qu’il y avait des circuits mis en place ?
Je dirais qu'il n’y avait pas de circuit officiel et que la personne allait voir qui lui semblait le plus apte, au-delà de l'organisation administrative. Mais c'est vrai qu'à la direction des études, on était quand même assez bien placés pour avoir beaucoup de confidences, des choses qu'on n'aurait pas divulguées. C'était vraiment important d'avoir une permanence, d'être là tout le temps. On a un travail très, très morcelé mais une école, c’est fait pour rencontrer les gens, c'est ce qui en fait l'intérêt pour moi. Parce que des études, ce n'est pas simplement des disciplines à approfondir, c'est aussi toute une pâte humaine qui se construit au fil des ans entre les étudiant·es, entre les étudiant·es et les profs, et avec l'administration.

Isabelle Humbert-Rouadjia
ancienne étudiante, responsable
de la matériauthèque
avec
Lucile Encrevé
le 03.02.21

- Épanouissement
- Déséquilibres
- Silence et parole
Questionnaire de
Isabelle Humbert-Rouadjia
ancienne étudiante,
responsable de la matériauthèque
le 03.02.21 avec
Lucile Encrevé
L’interviewée a préféré répondre à l’écrit au questionnaire « test », avant un rendez-vous avec Lucile Encrevé.
Quelle est votre expérience de l’Ensad ? Est-elle à vos yeux liée à votre genre ?
Je rentre à l’Ensad en 1979 comme étudiante. J’en sors en 1984, diplômée en Design textile. J’y reviens en 1987, après deux expériences dans l’industrie. De retour de l’étranger, sur une proposition de mes anciens profs du textile, j’intègre l’atelier d’impression comme vacataire. Compte-tenu des circonstances, j’étais plutôt contente de trouver ce travail mais ça s’est assez vite mal passé avec un membre de l’équipe pédagogique, une femme autoritaire.
L’École, à ce moment-là, était une grande famille où nous étions tous liés, indépendamment des statuts de chacun. Elle fonctionnait avec un directeur, deux personnes au service du personnel et une secrétaire générale. J’ai connu cinq directeurs et une directrice. Tourlière [Michel ; directeur, 1971 à 1990] un monsieur modeste, puis Peduzzi [Richard ; directeur, 1990 à 2002] dont nous étions proches en dépit des réunions houleuses avec son personnel et les étudiants. C’était une belle époque jusqu’à l’arrivée… d’une femme aux commandes. Là tout a basculé. L’Ensad est devenue une grosse administration avec pléthore de directions. Les personnels se sont scindés et laissés progressivement enfermer dans des catégories socio-professionnelles bien différenciées. La gaieté, les événements festifs, la fantaisie, le collectif ont progressivement disparu. L’humain n’était plus au centre.
Dans l’intervalle, ma famille s’est agrandie et, à l’issu d’un congé parental, je n’ai pas pu reprendre mon poste dans des délais légaux (bloquée par une femme !). À la suite de négociations avec la direction et la CGT, et après un passage à la bibliothèque, il m’a été proposé en 1997 de créer une tissuthèque, qui deviendra la matériauthèque, quelques années plus tard. Celle-ci est alors rattachée au service technique, dirigé par une femme de poigne. Si j’ai conservé une certaine autonomie de déplacements et d’organisation, j’ai été bloquée sur certains développements et rarement soutenue. Notamment avec un projet porteur : le son des matériaux, en 2006, « qui n’intéressait personne à l’école ». Moralité, nous repartons sur cette idée en 2021 et avons perdu quinze années !!! Peut-être un hasard, mais trois femmes.
Avez-vous constaté que des secteurs étaient à l’École moins accueillants que d’autres pour vous en tant que femme ou pour les femmes ?
Non, à une exception près, l’archi intérieure. Il y a quelques années, j’ai fait le lien entre la matériauthèque de l’École Nationale d’Architecture Paris Val de Seine et l’Ensad pour un accès gracieux aux enseignants et étudiants de la section Architecture intérieure. Un enseignant de ce secteur que je croisais depuis des années n’a pas même daigné me saluer ni me regarder en face, durant toute la visite. Ce comportement s’est renouvelé par la suite.
Avez-vous le sentiment qu’on attend de vous à l’École un investissement spécifique lié à votre genre ?
Je ne vois pas ? Pour moi, la discrimination n’est pas genrée, c’est une discrimination de classe.
L’école est-elle un espace qui vous semble différent par rapport au monde extérieur ?
Vraiment différent ? Pas certaine. C’est un microcosme qui est à l’image de la société. Peut-être l’est-elle de façon plus caricaturale. Je dirais que l’Ensad est un lieu où l’on ne reconnait pas les individus à leur valeur, c’est-à-dire à leurs compétences ni à leur investissement dans le travail, mais plutôt à leur capital social, aux diplômes prestigieux — l’Ensad n’en délivrant pas un — et à leur âge. C’est un lieu qui fonctionne, comme ailleurs, par cooptation. Une direction sur-représentée avec de très jeunes cadres et le sentiment que les anciens n’ont plus trop leur place. C’est aussi une administration tentaculaire et tatillonne qui, depuis des années, bloque les initiatives, complique les procédures, favorise le réseautage et est incapable d’anticiper.
Connaissez-vous des parcours d’anciennes étudiantes, enseignantes, membres du personnel qui vous inspirent ?
J’ai été fascinée par le talent de Desolina Suter, une ancienne étudiante du Design textile. Une jeune femme d’une rare créativité. Elle savait tout faire, des costumes pour le théâtre, aux scénographies, à de fabuleuses collections tissées et imprimées. Elle est devenue une référence avec son Agence de direction artistique, Uragano, créée à Milan en 2002 [Desolina Suter intervient actuellement comme enseignante à l’Ensad].
J’appréciais aussi beaucoup Vonnik Hertig [enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016], coloriste très impliquée dans l’architecture et l’industrie, longtemps partenaire de Jean-Philippe Lenclos, tous deux professeurs de couleur aux Arts Déco. Son professionnalisme, sa grande gentillesse et sa modestie… des qualités rares à l’école.
Enfin, j’admirais, sans très bien la connaître, Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015]. Femme informaticienne, engagée en politique à la Mairie de Montreuil, ne circulant qu’à vélo depuis les années 90. Connue aussi pour ses coups de gueule féministes. Elle avait écrit un papier plein d’humour, un 8 mars, sur la situation des femmes à l’Ensad, dénonçant inégalités de traitements et de représentativité [fig.30].
Vous êtes-vous sentie en minorité dans votre secteur/espace de travail ou lors de réunions/commissions/jurys ? Y a-t-il eu une évolution au cours de votre carrière ?
On m’a demandé au début des années 2000 de présenter la matériauthèque au collège de coordonnateurs. Je n’ai pas souvenir d’y avoir vu une seule femme. Est-ce ma mémoire qui me joue des tours ? Enfin, j’ai trouvé cela désagréable.
Aujourd’hui, c’est un peu l’inverse à l’École, les femmes sont sur-représentées dans l’administration, notamment à des postes de direction et notre vivier d’élèves est majoritairement féminin.
En quasi autonomie pendant 22 ans, je suis passée à côté des problèmes de genre. Je voyais bien que quelques enseignants s’étaient mariés avec leurs élèves et jamais l’inverse, et que la mixité n’était pas acquise dans certains secteurs de l’école. Je me dis aujourd’hui que la bibliothèque, qui est mon nouveau port d’attache, gagnerait peut-être à une meilleure parité.
Pensez-vous que travailler dans vos équipes avec d’autres femmes est un atout ? Pourquoi ?
Pas du tout. Les femmes sont plus redoutables que les hommes en situation de pouvoir. Nous avons l'exemple de certaines directrices de l’École. Contrairement aux idées reçues, les femmes peuvent être totalement dénuées d’empathie. Il y a probablement des raisons tout à fait valables. Éducatives, liées à des difficultés à mener frontalement carrière et vie familiale. Oui, il y a dans notre société, comme à l’Ensad, des harceleuses. Personnellement, je préfère travailler avec des hommes.
Une direction masculine entraîne-t-elle des relations spécifiques ? L’arrivée de femmes à des postes de direction a-t-elle entraîné des changements pour vous ?
Ce n’est pas une question de genre, mais de personnalité. L’arrivée de Simon Garcia [ancien directeur général des services] et, à sa suite, celle de Viviane Cattane [ancienne conservatrice du pôle documentaire] en 2019 ont marqué un tournant dans l’évolution de la matériauthèque. Pour la première fois après plus de vingt années de travail solitaire, j’ai été accompagnée dans mes projets, mon travail valorisé et le potentiel de la matériauthèque s’est inscrit dans un projet plus large, celui d’une Grande Matériauthèque au sein d’un nouveau CAMPUS.
Lors des réunions ou de discussions à l’École, votre parole est-elle entendue à l’égal de celle d’un homme ?
À l’Ensad, ce serait plutôt une question de statut et bien sûr de personnalité. Si l’on est offensif et convainquant cela passe mieux que si l’on est timide. Mais si l’on est prof cela a davantage de poids que si l’on est technicien. Mais prof contractuel mieux que prof vacataire… Néanmoins, il pourrait bien y avoir deux écueils « genrés ». La capacité à savoir se mettre en avant et la capacité à gérer son avancée de carrière.
Une anecdote, j’ai voulu suivre une formation sur la prise de parole en public. Eh bien, il y avait neuf candidates pour un seul candidat. Manifestement, les femmes ont davantage de difficultés à se faire entendre. Sur l’avancée de carrière, un homme aurait certainement travaillé à l’évolution de son statut et négocié un salaire à l’aune de ses résultats. Une femme sera davantage dans l’acceptation d’une situation salariale, non évolutive.
Avez-vous déjà eu la sensation que l’on répondait positivement à vos demandes, parce que vous étiez une femme ?
Jamais.
Les étudiant·es vous considèrent-ils/elles à l’égal d’un homme ?
Drôle de question ! J’ai à la fois développé un angle technique du matériau, une compétence vaguement associée au masculin, mais en parallèle d’une approche sensible. Les descripteurs du toucher (température, rugosité, flexibilité… ) et de la vue (couleur, matière), ceux de l’odorat et du son, un registre plus féminin ? Je suis donc en capacité de répondre à toutes sortes d’approches et de questionnements, voilà l’essentiel.
Avez-vous été victime à l’École d’un sexisme bienveillant ?
Jamais.
Avez-vous été l’objet de remarques sexistes ou de traits d’humour déplacés liés à votre genre ?
Oui, deux ou trois fois en trente ans. Je me rappelle avoir trouvé de petits billets lubriques devant la porte de la matériauthèque. Cela m’a bien fait rire.
Avez-vous été victime au sein de l’École d’agressions liées à votre genre ?
Jamais.

Claire Bardainne
étudiante
de 1999 à 2001
avec
Alexandra Piat
le 17.12.20

- Épanouissement
- Plafond de verre
- Mysogynie intériorisée
- Empouvoirement
- Résister
- Enfants
- Représentation
Entretien de
Claire Bardainne
étudiante de 1999 à 2001
le 17.12.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Aujourd’hui, j’ai quarante-deux ans, et je place ma pratique plutôt dans la catégorie des arts visuels, au sein d’une compagnie qui s’appelle Adrien M & Claire B dont j’assure la co-direction artistique. Cette direction artistique est menée avec un homme, Adrien Mondot, avec qui je partage aussi ma vie personnelle, donc depuis dix ans, on travaille et on vit ensemble. J’insiste sur le fait que je suis artiste visuelle et aussi directrice de compagnie. Pour dire que si ce sont des métiers extrêmement entremêlés, complémentaires, ce sont quand même des métiers différents. La compagnie aujourd’hui, c’est trente personnes, dont cinq personnes qui constituent un comité de pilotage : production, administration, régie générale, direction technique, dans une approche d’intelligence collective. L’objet de nos recherches et de nos créations se situe dans le champ des arts vivants et des arts visuels. On conçoit, on réalise et on diffuse des spectacles, des installations de formats très variés. Du petit format, comme un livre pop-up visible en réalité augmentée ou encore une installation immersive et interactive de grand format, comme celle qui a été présentée à la Gaîté Lyrique, ou un spectacle frontal que l’on devait jouer à Chaillot cette semaine. Voilà un petit peu l’endroit où on se situe aujourd’hui.
Maintenant, je vais revenir vingt ans en arrière. Oui, ça fait quasiment exactement vingt ans que je suis sortie des Arts Déco ! J’ai fait un bac général, puis une mise à niveau à Lyon, à La Martinière Diderot. Comme j’ai pu constituer un bon dossier, ça m’a permis de postuler pour toutes les filières que je voulais dans les meilleures écoles. Au départ je voulais faire du design industriel, et j’ai été reçue en design à Olivier de Serres. J’étais aussi prise en Design graphique à Estienne. Au dernier moment, j’ai choisi plutôt l’image, donc j’ai fait du Design graphique à Estienne. J’ai fait un BTS qui s’appelait à l’époque Communication visuelle, il n’y avait pas de distinction print/web. En 1997, on faisait encore des montages d’images ou de typos artisanalement, avec du collage. On avait aussi des ordinateurs dans la salle et on commençait à faire un petit peu d’Illustrator, Photoshop, et on utilisait les premiers appareils photo numériques. On était vraiment cette génération de l’entre-deux. À l’issue de cette formation en Design graphique, j’ai éprouvé l’envie de continuer mes études. Et aussi le désir de raconter des histoires, qui m’avait manqué dans ma formation en BTS, alors que dans l’univers du théâtre, il y avait quelque chose qui se passait à l’endroit du récit, qui m’attirait.
C’est pour ça que je suis rentrée aux Arts Déco, pour intégrer la filière Scénographie. Je suis rentrée directement en troisième année, en spécialisation. C’est important de le préciser parce que, finalement, je n’ai passé que deux ans aux Arts Déco. À l’époque, la formation se réalisait en quatre ans — aujourd’hui je sais qu’elle se fait en cinq ans — donc moi, j’y ai passé deux ans, de 1999 à 2001. En y ayant passé seulement deux ans, j’ai l’impression que je ne connais pas très bien les Arts Déco. À l’époque, tout ce qui concernait les filières dites « espace » se passait à Ivry-sur-Seine, à la Manufacture des Œillets, parce qu’il y avait des travaux à la rue d’Ulm. J’avais quelques cours rue d’Ulm, mais en fait, j’étais quasiment tout le temps à la Manufacture des Œillets, qui était un endroit génial, immense [fig.31]. On ne risquait rien d’abîmer, c’était une ancienne manufacture, un bâtiment industriel du XIXe, hyper beau, avec de grands espaces où je me souviens, on investissait tous les recoins, les couloirs. Il y avait quelque chose d’assez chouette dans le rapport à l’espace.
Quand j’ai intégré la filière, on était neuf et il y avait deux garçons, dont un qui est parti en multimédia après la première année. C’était un groupe très féminin. Je me suis sentie hyper bien dans ces deux années d’études, dans une dynamique d’atelier ! Par rapport à l’école Estienne, il y avait une vraie dimension de recherche personnelle, une autonomie, une liberté, un travail sur son propre univers. Je m’ouvrais à tout un tas de disciplines qui étaient issues de l’histoire de l’art, et connectées à l’histoire du théâtre. J’ai eu une relation au travail ces années-là très orientée sur le contenu. Et je n’interrogeais pas du tout le prisme à travers lequel ce contenu nous était délivré. Je pense qu’aujourd’hui je le ferais, c’est sûr.
Ce qui est aussi notable dans mon souvenir, c’est qu’on était aux Arts Déco lorsque les tours jumelles se sont effondrées en 2001. On était en atelier avec le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Un metteur en scène invité montait une pièce que les étudiants du Conservatoire interprétaient, et dont ceux des Arts Déco réalisaient les décors. Ça, c’est un souvenir très marquant de ma fin de scolarité. Plus précisément, le jour où les tours jumelles se sont effondrées, on était en train de répéter, de travailler sur la fabrication des décors, et tout le monde s’est arrêté. Mais moi j’ai continué mon travail. Je ne me suis pas vraiment arrêtée pour aller regarder la télé dans la loge du gardien. Ça parle bien de la passion et de la concentration dans laquelle j’étais. Je peux dire que j’ai adoré les études que j’ai faites. J’adorais ça.
Il y avait une atmosphère dans le groupe de filles et d’un ou deux garçons qui étaient extrêmement respectueuse, amicale, joyeuse. On était vraiment dans la concertation, dans le dialogue. Je me souviens, notamment d’un atelier cinéma où on devait partir d’un texte écrit par nous-mêmes. L’un des textes qui avaient été sélectionnés par nos enseignants Françoise Darne [enseignante de 1991 à 2008] et Guy-Claude François (un grand chef déco du théâtre et du cinéma, qui est décédé depuis) parlait d’un jeune homme qui était en train de changer de sexe. Et on avait mis en scène la chambre de ce jeune homme. On avait incarné son personnage, on avait fait toute la patine, un décor de cinéma. Je me souviens qu’il y avait une des nanas de l’équipe dont on avait photographié les seins. Puis, sur Photoshop, j’avais ensuite collé la photo de ses seins sur la photo du torse nu d’un homme de ménage avec qui on s’entendait bien et qui avait accepté de jouer le jeu. On travaillait donc sur un personnage maghrébin qui vivait dans une chambre de bonne à Paris et qui était en train de changer de sexe. On essayait de rentrer en empathie et de créer son univers. Il y avait quelque chose d’hyper ludique et simple.
Les ennuis ont commencé pour moi dans la vie professionnelle, les ennuis, ou plutôt les sensations de confrontation, et l’énorme décalage entre ce qu’on m’avait dit possible et ce qui était véritablement possible, ce qui était vraiment accessible. J’étais bonne élève à l’école. J’avais compris le système scolaire. Et compris comment il fallait faire, jusqu’au bac, pour que ça marche sans qu’on m’embête. Après le bac, ça a continué à bien se passer, mais en plus, ça m’intéressait. La désillusion pour moi est venue après. De fait, les filles sont fortes à l’école. Et il y a beaucoup de filles en écoles d’art. Mais par contre, après, dans le monde professionnel, qu’est-ce qui se passe ? Il y a de moins en moins de femmes. Qu’est-ce qui se passe, putain ? Aujourd’hui, ce que je comprends, c’est qu’il y a une énorme résistance. Il y a un plafond de verre. Au moment où il s’agit de faire des choses sérieuses, des choses réelles, des choses qui engagent de l’argent, des choses qui changent la société. Et bien là, on ne nous laisse pas la place. C’est ce que j’ai ressenti alors même que j’étais fonceuse et que j’avais confiance en mes capacités. Avec ce trait qu’on décrit un peu comme un trait masculin : « Bon, je ne sais pas tout à fait faire, mais ce n’est pas grave. Je vais dire que je sais faire et je vais y arriver ». À compétences égales, un homme va dire qu’il sait faire même s’il ne sait pas tout à fait, et une femme va dire qu’elle ne sait pas faire parce qu’elle ne sait pas parfaitement faire. C’est sûrement un peu caricatural, mais c’est quelque chose que j’ai observé.
Ce qui m’a frappé, c’est que ça vient très souvent des femmes. Ce ne sont pas systématiquement les hommes qui censurent les femmes. Parmi les situations les plus violentes et les difficultés que j’ai pu rencontrer, beaucoup sont venues de femmes. Des situations où j’ai été empêchée de faire les choses sont venues de femmes. Professionnellement. C’est ça qui m’a frappé, qu’il y ait vraiment quelque chose d’une autocensure et d’un truc tellement intégré que ce sont les femmes qui, après, appliquent ce système. Moi ce que j’observe, c’est que les hommes sont dans une inconscience de la répercussion d’un système orienté par leur regard. Ils ne s’en rendent pas compte. Les femmes ont conscience et par un phénomène que je ne saurais pas expliquer, elles sont encore plus dures et plus exigeantes avec les autres femmes.
Malgré tout, j’ai eu la chance d’être au contact de gens qui étaient des entrepreneurs, qui n’avaient pas tellement de préjugés sur la question d’être une femme ou un homme et qui m’encourageaient. Qui me disaient « Mais vas-y, tu veux faire ça, vas-y fais-le ! C’est simple ! ». J’ai en particulier un souvenir très fort d’un homme me racontant « Moi, mon premier boulot, quelqu’un m’a demandé si je pouvais faire un devis. J’ai répondu « Pas de problème, je te le fais, dis-moi juste c’est quoi un devis ? ». Ça, j’ai trouvé ça génial et je me suis dit voilà, c’est comme ça qu’il faut faire.
Bon, c’est un peu généraliste comme discours. Concrètement, qu’est-ce qui s’est passé ? J’ai commencé par faire du graphisme de manière indépendante parce que c’est là où je trouvais plus de travail qu’en scéno et j’avais envie d’être autonome. Je faisais des projets d’identité visuelle, ou encore des icônes pour les téléphones portables à l’époque où il y avait des résolutions de sept pixels par douze. Je m’y jetais à corps perdu. Et puis, au bout d’un moment, je me suis rendu compte qu’en définitive, je travaillais tout le temps au service des autres, je ne décidais pas grand-chose dans le fond. J’appliquais des briefs, des décisions. Je faisais le caméléon. D’un coup, j’ai eu besoin d’être maître de l’origine des choses. J’ai fait un rejet quasi total du fait de travailler pour les autres.
Pour me retrouver, j’ai eu besoin de partir marcher toute seule avec mon sac à dos, et j’ai marché 600 kilomètres, pendant un mois, de Saint-Étienne jusqu’à Castelnaudary. Je n’ai pas eu peur, et ça m’a permis de me reconnecter avec ma force, avec le fait que je pouvais faire les choses seule, que je pouvais avoir confiance en moi. Quand tu marches seule dans la nature, en tant que femme, pendant un mois et que tu te rends compte que ça se passe non seulement bien, mais que c’est d’un épanouissement complètement dingue, ça te redonne plein de capacités. C’était très « encapacitant » cette expérience-là pour moi, et je l’ai facilement après transposé au fait de me dire « Je me lance vraiment dans un travail plastique où je sors mes tripes, où je vais raconter, à ma façon, ma vision du monde » . C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à avoir envie de faire percevoir mon regard en travaillant sur des images et sur des projets d’installation, qui étaient au départ très modestes, très confidentiels.
Mais c’est là où j’ai commencé à percevoir que j’étais dans un monde d’hommes, décrit par les hommes et que le regard majoritaire qui était autour de moi était très orienté par les hommes. Et depuis, je ne fais que le ressentir plus. Voilà un exemple : Wikipédia est quasiment en totalité écrit par des hommes et donc il y a moins d’articles sur des femmes. Ce n’est pas parce qu’il y a peu de femmes qui ont fait des trucs, mais c’est juste que ce sont les hommes qui écrivent. C’est des petites choses, mais ça m’a choquée de sentir progressivement à quel point c’était à l’endroit des bases de la description du monde qu’il y avait un biais. Et un peu comme toi, à partir du moment où tu perçois ça en tant que femme et que tu te ressens comme minorité en tant que femme, ça crée une sensibilité et une empathie pour les autres minorités. Je pense aussi que c’est un atout, parce que ça nous permet d’être sensibilisées aux minorités ethniques et aux minorités sexuelles… Je suis une femme qui est née dans un corps de femme et je me sens femme. J’essaye de transposer ce que moi je peux ressentir à des situations qui ne sont pas les miennes. Et je pense que ce n’est pas un cadeau en fait d’être un homme blanc aujourd’hui, parce que ça demande un gros travail. De conscience et de prise de conscience pour aller vers cette empathie-là.
Quand on a commencé à co-diriger ensemble notre projet de compagnie avec Adrien en 2010-2011, on ne partait pas tout à fait sur un terrain d’égalité. Son nom était identifié, et sa compagnie était reconnue. Quand on s’est rencontrés, on a eu un coup de foudre professionnel. Ça fait dix ans que tu bosses et tout d’un coup, tu rencontres quelqu’un et tu te dis « Ouah ! C’est dingue, je n’ai jamais travaillé comme ça avec quelqu’un ! » Plus tard, on est tombé amoureux dans la vie. Mais on a d’abord eu cette exaltation de ressentir dans le travail, on se comprend tout de suite. On est complémentaires et en même temps, on a un terrain commun qui est énorme. Bref, on a senti qu’on avait vraiment envie de monter un projet ensemble. Je lui ai dit « Bah écoute, ça marche, mais moi je sais le travail que je vais fournir, je sais à quel endroit de responsabilité dans la création je vais être. J’ai envie d’être reconnue à cet endroit-là et je mets comme condition : changer le nom de la compagnie en ajoutant le mien : Adrien M & Claire B ». C’était un peu osé parce que j’hypothéquais sur mes capacités quand même. Mais plusieurs fois dans la vie, j’ai senti comme un devoir de faire cet effort-là, de se faire confiance en tant que femme et que c’est injuste de ne pas le faire. Parce qu’il y a trop de femmes qui ne le font pas assez, je me dis que ce n’est pas grave si moi je le fais un peu trop !
Ça a mis plusieurs années, mais aujourd’hui, on sait qu’on a eu raison de faire ce pari. Et que j’ai eu raison de faire cette demande-là. Mais au début, mon nom était régulièrement oublié des crédits. Alors qu’on envoyait des dossiers où il y avait Adrien M & Claire B, qu’on envoyait des crédits où c’était écrit noir sur blanc. Eh bien, je te jure, ça a été une bataille. Ça a pris trois ans, je pense, avant que soit validé que je co-signais les projets et que je co-dirigeais cette compagnie. La transformation était difficile à intégrer de la part des gens qui avaient déjà rencontré Adrien. Il y a plusieurs raisons principales à ça, à mon sens : un, le fait que j’étais une femme, et qu’on vivait ensemble (c’était louche), deux, le fait que j’étais moins connue, trois, le fait que le secteur du spectacle vivant est sur une rythmique beaucoup plus lente que le milieu industriel ou le milieu commercial. En studio, on travaille à trois mois, en compagnie, on travaille à un an et demi. Un an et demi avant, tu envoies des dossiers pour des diffusions, des projets qui vont être créés, etc. En tout cas, dans le monde d’avant, c’était comme ça. Quatre, la difficulté à admettre que les créations puissent être signées collectivement. Il y a encore une forte attirance pour les systèmes pyramidaux (mais là c’est une problématique qui dépasse celle des femmes). Et enfin, cinq, un milieu où, comme beaucoup d’autres, les femmes sont sous-représentées dans les situations de direction. Directions de compagnies, directions de lieux, directions de projets. C’est redoutable et avec une mainmise des grosses institutions par — encore une fois, là c’est en train de changer un peu — des hommes blancs de cinquante-soixante ans. Ces années-là ont été les plus éprouvantes de toute ma vie.
Et comment, justement tu as combattu ça avec ton partenaire, le fait que tu n’étais pas reconnue, comment tu as essayé de t’imposer ?
Justement, ce qui est très compliqué, c’est qu’on ne supporte pas que tu t’imposes. En face les gens le vivent de manière agressive. Ils estiment que tu devrais être tout en détente et en douceur avec ces questions-là, qu’il n’y a aucune raison de s’énerver, que c’est extrêmement désagréable et malaisant de mettre le doigt sur ça. Tu fais chier, en fait, tu mets du sable dans les rouages. Voilà la sensation que j’ai éprouvée. Et j’ai juste tenu. Je crois que j’ai dans ma façon de faire, quelque chose de l’ordre de la détermination, de la patience et du courage qui m’a aidé à tenir. J’ai tenu, tenu, tenu et à force de tenir, ça a fini par rentrer. Par ailleurs, j’ai fait de beaux projets. On a fait des projets ensemble, qui ont été des réussites et ça, c’était la démonstration par le réel. Ce n’était pas juste une demande d’ego de quelqu’un qui veut être vu et reconnu pour des choses qui n’ont pas d’intérêt. J’avais l’intuition qu’on allait faire des choses de qualité et que j’avais le droit d’être reconnue tout de suite pour ces choses-là, pas une fois que je serai morte. J’étais extrêmement pragmatique, si tu n’es pas reconnue pour des choses de qualité que tu fais, si ton nom est invisibilisé, tu t’épuises, tu tombes malade et effectivement tu meurs. Vue la quantité de travail qu’il faut fournir dans la création, résoudre l’équation sans l’énergie de cette reconnaissance, ça n’est pas possible.
L’équilibre tu ne peux pas le trouver, en fait. Ça veut dire qu’il faut relire tous les documents. En gros on fait les projets, on fait des dossiers, on envoie des mentions obligatoires, etc., et il faut relire toute la communication visuelle qui est faite par les lieux qui accueillent ces projets pour vérifier qu’ils n’ont pas fait d’erreurs, qu’ils n’ont pas reformulé d’une manière qui ne conviendrait pas. C’est un énorme travail de vigie, de fourmi, dans le temps et dans le détail. Heureusement, au bout d’un moment, on a structuré la compagnie avec des personnes exceptionnelles (hommes et femmes) en production, en administration, qui nous ont soutenus à cet endroit-là. Et en interne il y a eu une cohésion sur le fait qu’on était un binôme de création et de direction, qu’on était à égalité et que tout le monde allait participer à le faire valoir. Et donc, c’est comme si tout d’un coup, on avait une armée. Aujourd’hui, je ne fais plus ce travail, et de toute façon, il y a moins besoin de le faire puisqu’on est enfin reconnu comme étant un binôme. Ça a pris du temps.
Il y a quelque chose que j’ai entendu récemment, c’est un petit aparté, mais ça me semble intéressant. J’ai écouté un séminaire d’un chercheur qui s’appelle Emanuele Coccia, enseignant à l’École des Hautes Études en sciences sociales. Lui, il est philosophe et s’attache en particulier aux questions qui sont liées à la « nature » avec des guillemets, parce que, justement, il essaie de déconstruire cette théorie de la nature. Dans ce séminaire, il y avait quelqu’un qui posait cette question « Mais est-ce que la définition et la construction des notions de paysage, de nature ne sont-elles pas genrées ? On a l’impression qu’elles ont toujours été écrites par des hommes et donc, elles sont à la fois occidentales et genrées, non ?». Et Emanuele Coccia avait une réponse qui était intéressante. Évidemment, la première approche aurait été de dire oui. Mais lui, il a évoqué que les hommes qui écrivent ne sont parfois pas des hommes qui se sentent hommes dans leur genre et ça a probablement toujours été comme ça dans toute l’histoire de la pensée. J’ai trouvé que c’était une ouverture. Ça m’a fait du bien d’entendre ça, je me suis dit qu’il avait raison. On a quasiment que des écrits d’hommes dans une écrasante majorité, du XVIe au XIXe… Au XXe ça commence un peu à changer. Mais voilà, en tout cas, c’est principalement ceux qui sont restés. Mais qu’est-ce qui nous dit que dans leur sensibilité et dans leur vécu et dans leur genre, ces hommes n’étaient pas porteurs d’une vision d’un autre genre ? On ne sait pas, donc c’est bien aussi de ne pas aller trop vite dans des jugements, je me le dis à moi-même : ne pas aller dans des jugements réducteurs. Car justement, c’est aussi très écrasant pour un homme de s’entendre dire qu’il a une vision d’homme alors qu’on n’en sait rien, ni de son genre ni de son vécu intime.
Après, il y a ce que la personne ressent en elle et comment elle a été éduquée à penser, etc. Ce n’est pas forcément en adéquation, mais ça influe quand même sur son comportement ou sa pensée, forcément. C’est là où il faut faire la différence. C’est hyper intéressant tout ton parcours. Ça illustre beaucoup de choses dont je parlais dans mon mémoire [Sexisme aux Arts Décoratifs, lutter pour l’égalité, dirigé par Lucile Encrevé, 2019] [fig.32]. Sur pourquoi les femmes disparaissent après les écoles alors qu’elles sont beaucoup plus nombreuses dans les écoles d’art. Les difficultés que tu as rencontrées parlent beaucoup de ça. Si je peux revenir un peu sur ton vécu à l’école, tu as l’air d’avoir un vécu assez positif. Est-ce que c’était grâce aux profs aussi, est-ce que tu avais des profs femmes et des profs hommes ?
Eh bien, notre prof principal était quelqu’un de très fin, très doux. Avec Françoise Darne[enseignante de 1991 à 2008], ils co-dirigeaient la section. On était dans une bulle de neuf personnes avec ces profs et on était embarqués comme ça, on découvrait l’histoire, le monde du théâtre par le biais du rapport à l’espace, du rapport à la scène. Plastiquement, quoi.
Mais il y a aussi quelque chose pendant les études, qui est lié à l’argent. Je pense que c’est important d’en parler. Pendant les études, l’argent lié à la pratique professionnelle n’est pas encore vraiment une question. Donc ce que tu peux faire en tant que femme, tes projets, tout ça ne demande pas de débloquer des enveloppes. Mais après, quand tu es dans la vie professionnelle, déjà il y a des questions de salaire, et des budgets nécessaires pour réaliser des projets, en gros, tu défends des projets qui coûtent de l’argent. Nous par exemple, on fait des projets qui coûtent entre quelques dizaines et quelques centaines de milliers d’euros. C’est là, pour débloquer de l’argent où tu sens que ta parole et ta légitimité ont un coefficient moins important que celles d’un homme.
Avec mon partenaire, c’est une façon qu’on a eue pour installer l’égalité aussi, installer une égalité de salaire. Parfaite. Aujourd’hui, on est en CDI et il n’y en a pas un qui touche un euro de plus que l’autre. Ça a mis un peu de temps. Au départ, on était intermittents, et on essayait de trouver des solutions, mais je me souviens que ce n’était pas facile, car il fallait que je fasse mes preuves. Ce n’est pas forcément facile à dire, mais il m’a mise à l’épreuve lui aussi. Parce qu’il avait envie, justement, que je gagne une légitimité et qu’on ne dise pas « Comme elle couche avec lui, évidemment qu’elle a de l’argent, évidemment qu’elle a un salaire, évidemment qu’elle a son nom sur les projets » , il ne voulait surtout pas que ça se passe comme ça. C’est vrai que c’était quand même un handicap, en fait, qu’on soit ensemble.
Quand on a eu un enfant et qu’on a un peu été en tournée avec lui, il y avait deux types de réactions. Je me souviens d’une fois où il était malade et quand c’était Adrien qui l’avait dans les bras, l’équipe du lieu qui nous accueillait était impressionnée, attendrie. Puis inversement, quand c’était moi qui l’avais dans les bras et qu’il avait quarante de fièvre, je devenais invisible, transparente. On me tournait le dos quoi, je n’avais plus d’existence professionnelle, je ne faisais plus partie des conversations. Un autre souvenir dingue, lors du montage d’une expo, c’est quand j’ai fait la visite de Sécu, avec le bébé au sein en train d’être allaité. Le fait de revendiquer que je peux être une femme, je peux être une mère et je peux avoir tous mes neurones pour discuter avec le chef des pompiers était un grand défi. Mais pour moi, ça fait partie des choses qui étaient essentielles. Il se joue des choses dans ces moments-là, il faut y aller ! Tu vois, il faut aller au feu, il faut les faire.
Ce sont des engagements du quotidien, des engagements minuscules. Mais je pense que c’est dans ces images-là qu’on transforme les imaginaires. Aujourd’hui, je sais que mon engagement, que ce soit vis-à-vis de la position des femmes, du rapport aux technologies — qui est un autre sujet passionnant — du rapport au vivant, du rapport aux autres, il ne se traduit pas — de par ma personnalité — dans un activisme identifiable avec des banderoles et tout, même si je pense que c’est très important que ça existe. Mais dans un détournement des imaginaires extrêmement inconscient parce que je sais que c’est très puissant et que, justement, il faut construire de nouveaux récits, faire apparaître de nouvelles images, reprogrammer les cerveaux. De manière complètement quotidienne. Je me sens à cet endroit-là et mon engagement est de plus en plus fort et de plus en plus profond et de moins en moins visible ! J’ai l’impression d’être un cheval de Troie. Toutes les approches sont complémentaires : il faut mettre de la pensée, il faut mettre de la parole. Il faut qu’il y ait des coups de gueule. Il faut qu’il y ait des Femen [mouvement d’activistes politiques de lutte contre la domination patriarcale]. Il faut qu’il y ait tout ça et il faut aussi concrètement être au rendez-vous dans le quotidien. Dans les images et les imaginaires qu’on crée.
Enfin, une dernière chose qui est aujourd’hui assez présente dans mon engagement, c’est une certaine discrimination positive dans les références et dans mes sources de lectures, d’inspirations. C’est-à-dire que pour un sujet donné, je vais essayer d’aller prioritairement chercher la parole d’une femme. Je sais que je suis obligée de le faire de manière consciente parce que sinon, ce n’est pas ce qui m’est servi sur un plateau. Si je dois citer des références, si je dois solliciter des sources d’inspiration, des images, je vais chercher si c’est possible de citer une femme plutôt qu’un homme. Ça, quand j’étais aux Arts Déco, je n’en avais aucune conscience. Dans mon mémoire [La perte des choses, dirigé par Yves Tissier, 2001], par exemple, je pense qu’il n’y a aucune femme qui est citée, aucune œuvre, aucune artiste femme. Que des hommes. Et je ne m’en rendais pas compte.
Est-ce que tu as l’impression d’être sortie des Arts Déco avec plus de confiance en toi ? Avec une grande confiance dans tes capacités ?
Cette sensation de confiance, je l’ai sollicitée à partir du moment où en Première ES j’ai décidé d’aller faire des études d’arts appliqués. C’était un ensemble de choses énorme : j’avais dix-huit ans, j’habitais à Grenoble et j’allais à Paris. Mes parents m’avaient dit « On te fait confiance, tu fais les études que tu veux. Et si c’est des études d’art que tu veux faire, tu les fais. Mais nous, on ne pourra pas payer d’école privée, on pourra juste payer de quoi subvenir à tes besoins quotidiens, participer à un logement et de la nourriture ». Alors j’ai commencé à faire le bulldozer. Je me suis dit « Je mets le maximum de chances de mon côté dès maintenant en essayant de rentrer dans une grande école ». J’ai travaillé mon auto-conviction. Il fallait que je donne le meilleur de moi-même et je suis rentrée aux Arts Déco de cette manière-là en troisième année. J’avais tenté le concours général au tout début, mais je ne l’avais pas eu car je n’étais pas prête. Je n’avais jamais dessiné, je sortais du bac. Je suis sortie aussi dans cet état-là. J’ai rédigé un mémoire qui s’appelait La perte des choses où j’ai travaillé sur des situations liées à la perte. J’ai travaillé sur la mélancolie, le deuil, le land art. Ce projet m’a emballée. J’ai adoré faire ça, j’ai adoré écrire sur ça, et à partir de ce moment-là, j’étais déjà en train de travailler sur cette notion de mort et de vivant, d’un monde et d’un autre, de matériel et d’immatériel qui, aujourd’hui, sont au cœur de ma recherche. C’était une première pierre et je ne m’en rendais pas forcément compte. Ce projet a emballé le jury, ils m’ont dit « On t’a mis dix-neuf, parce que vingt quand même ce n’est pas possible ! ». Donc je suis sortie en ayant la certitude que ce que j’étais et ce que je faisais avaient de la valeur, vraiment.
Je n’ai pas de mauvais souvenirs. Ou peut-être un seul : on avait fait une résidence d’une semaine à Arc-et-Senans pour faire des projets d’installation et ça avait été traité de manière très légère. On nous avait envoyés là-bas sans se poser la question de savoir comment on allait dormir, manger, etc. On s’est retrouvé comme des rats dans cette saline royale complètement isolée dans la nature. On n’avait aucun moyen de locomotion, aucun moyen pour aller s’acheter à manger. On ne nous avait rien dit et on était comme ça, censés vivre un peu d’amour et d’eau fraîche. Je me souviens avoir, au nom de tout le groupe d’étudiants, envoyé une lettre en recommandé au directeur pour dire à quel point on était scandalisés par cette situation d’absence d’organisation et d’anticipation ! C’était certainement un peu naïf et arrogant, je m’en rends compte aujourd’hui, mais c’est le seul moment un peu tendu dont je me souviens de cette période.
Est-ce qu’au cours de tes études aux Arts Déco, tu as été soit victime personnellement, soit témoin de violences sexistes ou sexuelles ? Que tu as pu identifier à ce moment-là, ou alors même que tu as identifiées après coup.
Non, mais je pense que je ne les voyais pas. Je ne me suis jamais sentie victime, même si j’ai été, comme toutes les femmes, draguée, sifflée, pas forcément dans les Arts Déco, mais d’une manière générale. Je me souviens m’être baladée à cette époque à Belleville et ne pas m’être retournée alors qu’un mec était en train de m’appeler en me sifflant. Je me suis pris une canette de coca pleine dans la tête. J’étais en colère, mais bon, je ne me suis pas accrochée à cette situation. Aux Arts Déco, non, franchement, pas spécialement, mais c’est vrai que ça n’avait pas de prise sur moi. Là où à situation égale, ça peut être traumatisant ou très violent pour quelqu’un d’autre. Je pense que je n’avais pas cette sensibilité que j’ai aujourd’hui où je fais le lien entre tout un tas de signes et je vois une espèce de toile d’araignée. Je n’avais pas du tout cette conscience à l’époque.
Comme tu étais en Scéno je me demande, est-ce que tu ne t’es jamais sentie infantilisée pour l’utilisation de certains outils ? Quand on t’a appris à te servir de choses, des machines, etc. ?
Non je me souviens très bien des techniciens et ils n’étaient pas du tout comme ça.

Margo Rouard-Snowman
ancienne étudiante,
enseignante
de 1978 à 2008
avec
Lucile Encrevé
le 25.11.20

- Harcèlements
- Sexisme
- Rôles genrés
- Déséquilibres
- Carrière
- Minorité
- Dévalorisation
- Modèle
- Histoire des créatrices
- Mandarinat
- Silence et parole
Entretien de
Margo Rouard-Snowman
ancienne étudiante, enseignante de 1978 à 2008
le 25.11.20 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Pourriez-vous nous dire quel a été votre premier contact avec les Arts Déco ?
J’ai été étudiante aux Arts Déco et je suis sortie en 1972. Comme étudiante, j’ai vraiment souvenir du machisme des profs et de certains élèves. À l'époque, on fonctionnait par ateliers, on restait quatre ans avec les mêmes personnes. Dans l’atelier où j’étais, il y avait des garçons très sympathiques, très protecteurs et très galants. Le souvenir des profs que j’ai, c’est que les profs draguaient les étudiantes. J’étais un peu provocante et j’ai eu plusieurs fois des propositions un peu tordues. Quand il y avait des rendus, j’ai le souvenir, et ça m’avait un peu cassée, que certains garçons de l’année au-dessus de nous passaient et disaient : « C’est nul ton projet, c’est normal, tu es une fille ». C’étaient des relevés de projets, assez réguliers, une fois par mois à peu près, et c’était assez solennel. On devait accrocher notre travail sur un thème ou sur un autre. Les professeurs passaient, corrigeaient et notaient. On travaillait tard le soir. Il y avait toujours des garçons qui passaient, soit pour pincer les fesses, soit pour dire « C’est nul ». Il y a un autre truc qui m’a fait rire, c’est un prof (il est mort depuis) qui a dit le premier jour de la rentrée de l’atelier : « Vous êtes dans une grande école, vous avez réussi le concours, vous devez avoir la légion d’honneur, sauf les filles. » : c’était quand même une manière de faire une séparation entre le talent des filles et celui des garçons.
Vous avez dû subir un bizutage ?
Je n’ai pas été bizutée parce que j’avais un gardien. Mon meilleur copain, qui était à l’école depuis trois ans, était un colosse et il a dit : « Elle, elle n’est pas bizutée ». Le bizutage existait encore, mais c’était 68, on remettait tout en question. Le directeur, c’était Jean Adnet [directeur ; de 1959 à 1971]. Il était présent dans les corrections. C’était une espèce de cérémonial, très fort. Les filles, on se maquillait, on mettait des talons. Il y avait un soin physique. Les garçons aussi. J’ai vécu la première année après 68, tout était en désordre, c’était chaotique.
Comment les femmes ont participé à mai 68 ?
Je n’étais pas encore étudiante mais je faisais des affiches, en sérigraphie. J’ai souvenir que les femmes – en tous cas moi – étaient des domestiques pour imprimer. J’ai fait des projets, il y en a deux qui ont été imprimés. Toutes les affiches sont signées Beaux-Arts mais beaucoup ont été faites aux Arts Déco. Il n’y avait pas beaucoup de femmes. Ce qui m’a toujours étonné, c’est qu’aux Arts Déco il y avait une dominante d’étudiantes, féminines, et qu’après dans ma profession je me suis retrouvée avec très peu de femmes à mon niveau. C’était un décalage total. Dans ma promotion, je ne sais pas ce qu’elles sont devenues – il y avait douze filles. Elles se mariaient souvent, et donc elles ne travaillaient pas. Le sexisme aux Arts Déco existe, existait, parce que dans ces métiers de la création, il faut quand même montrer deux fois plus en tant que femme ce qu’on sait faire par rapport à un mec, c’est mon expérience. J’ai bien senti que je devais faire deux fois ou trois fois plus pour avoir la même chose, à l’École ou ailleurs. On demande plus de preuve, surtout si vous avez l’air légère, moi j’avais l’air très légère. J’ai dû toujours me bagarrer pour tout avoir. Comme étudiante, j’ai pris un peu par-dessus la jambe les attaques, parce que j’étais déterminée à faire ce que j’avais à faire, j’étais boursière et je devais payer mes études. Dès qu’il y avait des vacances, je travaillais chez Publicis ou Havas, j’avais un lien avec la réalité professionnelle que d’autres collègues d’atelier n’avaient pas, ce qui m’a beaucoup servi, même si c’était très difficile. J’ai quand même remarqué que dans la profession du graphisme, du design, de l’architecture d’intérieur, il y avait très peu de femmes à des postes importants. La plupart étaient des exécutantes, à l’époque, il n’y avait pas les ordinateurs. J’étais rentrée à l’école pour faire de l’architecture d’intérieur, j’ai fait deux stages et ça ne m’a pas plu, car les clients changeaient de manière capricieuse nos projets présentés. Je me suis dit : « Je ne veux pas être au service de gens qui me donnent des ordres toute la journée ». J’ai fait de la Communication visuelle et j’ai eu la chance d’avoir des profs comme Jean Widmer, à qui je dois beaucoup, qui m’ont vraiment donné la passion de la Communication, c’est-à-dire du traitement de l’image et du texte. Ce qui m’a servi dans mes stages d’Architecture intérieure, dans mon parcours professionnel, c’est qu’après avoir fait du pur graphisme pendant deux ans, j’ai fait des expositions, ça a croisé les deux. Il y a eu des hasards, je suis arrivée en patins à roulettes partout – les rencontres professionnelles qui m’ont permis de faire ce que j’ai fait étaient un hasard total. J’ai été dans de grandes agences de publicité, là non plus, ça ne me plaisait pas, les mecs étaient assez grossiers et il fallait avoir la dernière paire de chaussures dessinée par le dernier designer, il fallait être à la mode tous les matins. Socialement, c’était vulgaire et machiste. Aux Arts Déco, ma chance a été d’avoir Jean Widmer et Rudi Meyer comme profs, qui m’ont vraiment donné le goût de l’image et de la typographie. Après, j’ai eu la chance de rencontrer François Mathey, qui était conservateur du musée des Arts Décoratifs. Il m’a dit : « Je cherche quelqu’un pour faire des expositions, et vous feriez ça très bien. Prenez rendez-vous avec François Barré. ». Et j’ai été dans l’équipe de création du CCI [Centre de création industrielle], la préfiguration du Centre Pompidou, une période magnifique. Je me suis retrouvée là en 1973, j’ai fait des expositions assez provocatrices, non pas biographiques mais thématiques, qui étaient : « De l’objet à la ville » [1973], « Qu’est-ce qu’une campagne publicitaire ? » [1975], j’essayais toujours de démonter les mécanismes du capitalisme, ce qu’en faisait la communication. Le CCI a intégré le Centre Pompidou et j’ai fait des expos au Centre. À l’ouverture j’ai été commissaire d’une exposition qui s’appelait Femmes d’un jour, en 1977. Une exposition dans toute la galerie du CCI, 1000 m2. Le thème c’était : la représentation de la femme dans la publicité. C’était culotté d’aborder ce thème, dénonçant une exploitation sexiste de l’image de la femme. La direction du Centre Pompidou avait approuvé le projet. Après je suis partie au musée des sciences à la Villette, je n’aime pas la routine. J’étais responsable de la préfiguration. J’ai eu une proposition de travailler avec Claude Mollard et Jack Lang et de créer [en 1983] l’Association pour la Promotion de la Création Industrielle, et dans ce cadre j’ai à nouveau fait des expositions sur le graphisme et sur le Design L’Image des mots [1985], Design français, 1960-1990 [1988], j’étais à la fois commissaire et producteur.
C’est le moment où vous êtes devenue prof aux Arts Déco ?
Je suis devenue prof tout à fait en patins à roulettes aussi. J’étais au Centre Pompidou et j’ai rencontré le directeur de l’époque des Arts Déco qui était Michel Tourlière [directeur ; de 1971 à 1990] et qui me dit : « J’ai besoin de conférenciers, venez faire des conférences, vous parlerez de votre métier de commissaire d’expo ». C’était un nouveau métier à l’époque. En tant que commissaire, j’étais toujours un peu en porte-à-faux, un : en tant que femme, et assez provocatrice, et deux : je n’ai pas le titre de conservateur. Je devais toujours insister pour qu’on reconnaisse mon identité, ma capacité à faire des expositions. Je passais allègrement au-dessus des remarques machistes. Je suis rentrée comme vacataire, j’ai fait des vacations sur le graphisme. J’ai travaillé une année avec Widmer, une année seule, une année avec [Pierre] Praquin, le système des ateliers permettait de faire des groupes par projet, d’intervenir selon ses compétences – et les miennes c’est de savoir faire des expos, des livres et des catalogues. Pendant quatre ou cinq ans. Un jour Michel Tourlière me dit, « Il y a un poste, les étudiants vous adorent, ce serait très bien que vous preniez le poste. » J’ai dit : « Je n’ai pas le temps, j’ai déjà un emploi à temps plein ». Il insiste et j’ai eu un poste. J’ai eu des histoires parce que je ne suis pas passée devant la commission de recrutement. J’ai eu des réflexions machistes : « C’est grâce à tes jambes que tu es rentrée comme prof », y compris des syndicalistes de choc, ils ne supportaient pas qu’il y ait des femmes profs. J’ai été titularisée vers 1985-86.
Quelles étaient les femmes profs à cette époque ?
Michèle Guenoun [enseignante de 1969 à 2009], qui était sociologue. Il y avait une mathématicienne, Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015]. En vêtement, il y avait Krystyna Ballaban [enseignante de 1970 à 1998]. En graphisme, il y avait Béatrice Saalburg [enseignante de 1969 à 1998]. Dans les réunions de profs, on était très peu de femmes profs titulaires. Je n’ai pas vécu ça mal, je répondais toujours à la rigolade comme on me faisait des mauvaises réflexions, du genre, quand j’ai créé le cours d’histoire du graphisme, je remplissais les amphis, et un collègue m’a dit un jour « Evidemment c’est grâce à tes bas résilles que tu as des étudiants », je lui ai dit « Je vais te prêter mes bas, comme ça tu en auras aussi. ». Ça volait bas. C’étaient les profs du secteur, jaloux. Je suis féministe, j’ai toujours revendiqué mon indépendance financière, professionnelle, quand on m’attaquait là-dessus, je me moquais du mec qui essayait de m’humilier. Je renversais la vapeur, ça ne me faisait pas que des amis. J’ai tout entendu. J’étais isolée, j’étais la fille en minijupe qui arrivait dans les réunions sérieuses. C’était pareil partout.
Avec les autres femmes, il y avait une forme d’entraide ?
Aucune. Là aussi il y avait de la jalousie.
Mais est-ce qu’il y a des femmes avec lesquelles vous avez tissé des liens ?
Oui, avec Béatrice Saalburg, qui travaillait dans le textile. C’était une graphiste, elle était très forte en typo, elle faisait des illustrations magnifiques mais elle n’a travaillé comme prof que dans la section Textile [fig.33]. On était amies, on déjeunait ensemble mais on ne travaillait pas ensemble. Elle était sortie du secteur graphisme parce ce qu’elle trouvait les mecs insupportables.
Elle est allée dans le secteur Textile parce que c’était plus facile pour elle. Roxane [Jubert ; enseignante depuis 1997] aussi, je pense ; je l’ai eu comme étudiante, c’était une bonne étudiante. Moi, un de mes collègues m’avait dit que comme j’étais une femme, je devrais aller dans le secteur Textile. À la réunion suivante, j’ai placé des bobines de fil devant lui. C’était ma réponse.
Et comment étaient vos relations avec les étudiantes ?
J’ai toujours eu d’excellents rapports avec les étudiants autant femmes que hommes. Je trouve qu’il faut donner aux gens ce qu’on sait. Ce qui m’intéressait, c’était les étudiants, c’était enseigner et faire des choses nouvelles, différentes. J’ai fait un cours sur « graphisme et trois dimensions » pendant quelques années, j’ai créé ce cours sur l’histoire du graphisme. J’ai été une des rares profs aux Arts Déco qui vouvoyaient les étudiants. Par respect.
Les mémoires, c’était un moment de proximité avec les étudiantes ?
J’adorais ça, j’en ai dirigé pas mal. Ça permet d’aller au fond des sujets et d’aider quelqu’un à sortir son projet. J’ai le souvenir de Dorothée de Monfreid, que je cocoonais un peu, parce qu’il y avait des choses difficiles, elle n’a pas très bien vécu je crois son passage aux Arts Déco en tant que femme.
Pour les étudiantes, vous aviez l’impression d’être un modèle ?
J’avais un peu l’impression de servir de référence. Plus tard, pas tout de suite. Dans l’action, on ne le sent pas. Mais après, j’ai senti que je faisais référence, j’étais coquette, je m’habillais comme je voulais, je gagnais ma vie, je faisais à peu près les projets que je voulais. Le contexte le permettait, particulièrement dans les années 81-95.
Dans ces années, comment était l’ambiance à l’École ?
Moi, j’ai toujours adoré l’école. En tant qu’étudiante, je l’ai adorée, bien que socialement je ne faisais pas partie des bourgeois – ça m’avait un peu complexée au début mais après je n’en avais rien à faire. Comme prof ? Il y avait une espèce de compétition entre les profs, latente mais réelle. Beaucoup de problèmes viennent du complexe par rapport aux Beaux-Arts, certaines personnes ont un complexe avec le mot « Arts appliqués ». Mon analyse aussi, c’est qu’à l’École il y a beaucoup d’artistes ratés ou de gens qui ne sont que professeurs et qui n’ont pas d’activité ailleurs. Il y a une espèce de hargne, de frustration à reverser quelque part. Or pour moi les Arts Déco, c’est la transmission du savoir-faire, donc si on ne fait pas, je ne sais pas ce qu’on va transmettre. Et donc s’il y a quelqu’un qui transmet et qui emmène dans des projets intéressants, parce que je faisais faire aux étudiants des projets avec l’extérieur, ça suscitait de la jalousie.
Et votre activité professionnelle à l’extérieur, elle était reconnue par la direction ?
Je me suis bien entendue avec Tourlière. Peduzzi [Richard, directeur de 1990 à 2002], je le connaissais depuis trente ans. Je n’ai pas eu de difficultés avec lui, il ne s’est pas tellement occupé de mes projets. Et celui d’après, je ne me suis pas du tout entendue avec lui… Je ne me suis pas laissée faire. Je suis partie à la retraite quand Gallot [Geneviève, directrice de 2008 à 2013] arrivait. Je la connaissais parce que j’avais travaillé avec elle à la Culture. J’ai fait encore des conférences d’histoire du graphisme en vacations pendant trois ans. On me disait « Qu’est-ce que tu fais là ? », c’était déplaisant. Dans cette école que j’aime vraiment beaucoup, j’ai toujours trouvé les gens cavaliers.
Avec ces cours d’histoire du graphisme, vous étiez aussi reliée aux théoriciens ?
Le groupe des théoriciens était plus sympathique, moins prétentieux. Il y avait moins d’ego. C’est Thierry Chabanne qui était responsable avant [Jean-Louis] Pradel de la section. Je lui ai dit : « Je n’ai pas d’expo, j’ai du temps, je peux travailler avec les documents que j’ai et proposer des conférences», il m’a répondu « C’est une très bonne idée, je vais le proposer pour la rentrée prochaine ». C’est venu des Sciences Humaines. Les graphistes, pour les références, ils bricolaient dans leur coin, c’était léger.
Vous parliez de femmes graphistes ?
Oui, j’ai même fait un texte sur les femmes graphistes, il y a eu une exposition il y a deux ou trois ans dans une école à Bruxelles. L’autre chose que j’ai faite, c’est, pour les éditions des femmes, pour leur dictionnaire des créatrices, des textes sur des femmes graphistes. C’était très ambitieux comme projet, très intéressant à faire. En plus de faire les textes, j’avais mis dans mon projet de cours de faire la maquette du dictionnaire, ça a été un projet d’un semestre. Il y avait un échange avec les Éditions des femmes, on a eu plusieurs réunions. Ils ont eu cinq projets de maquettes magnifiques des étudiants des Arts Déco, un projet a été retenu, mais ils n’en ont rien fait.
Avec un regard rétrospectif, si vous regardez votre carrière aux Arts Déco, est-elle pour vous égale à celle d’un homme ?
Égale à celle d’un homme, voire même supérieure, ce qui me valait des jalousies. J’avais toujours eu deux salaires, je ne me suis pas tellement accrochée à la hiérarchie des profs mais mon sentiment, maintenant, avec du recul, est celui-là : j’ai dû faire ma place mais à la fin j’ai eu la même chose que si j’avais été un homme.
Et avez-vous été écoutée comme un homme ?
Oui, j’ai eu l’impression d’avoir été écoutée, dans les réunions de profs. Je n’ai pas été dans les instances, j’ai toujours refusé. Evidemment, j’avais toujours des ennemis qui allaient dire le contraire de ce que j’avais proposé, mais ça fait partie de la vie.
Dans les jurys de concours, comment ça se passait ?
Par rapport aux étudiantes, je faisais très attention à ne pas faire de différences, et je me chiffonnais avec mes collègues masculins qui eux ricanaient dès qu’il y avait des jolies filles. C’était plutôt sur les jambes ou les yeux qu’ils allaient dire « Oui, il faut la faire entrer » ou pas. Il y en avait qui passaient juste leur temps à mater.
Et coordonnatrice, vous n’avez jamais souhaité l’être ?
Non, ce que j’ai vu des coordonnateurs, c’est que c’était des danseurs mondains. Ils ne faisaient pas tellement avancer les choses, ils faisaient avancer leurs pions à eux, ils se protégeaient entre eux. Il y a eu des coordonnateurs de secteurs comme Communication visuelle qui ne défendaient que leurs pions à eux et en avaient rien à faire du reste. Moi je faisais tache. J’étais en dehors de ça, ça ne m’intéressait pas. C’est tout de même le secteur de Communication Visuelle qui était le plus machiste. Je voyais bien dans les jurys de concours d’entrée, les jurys de diplômes, que certains de mes collègues n’étaient pas toujours réglos.
Est-ce que vous avez été témoin de propos ou de gestes sexistes ?
J’ai repris à plusieurs reprises un collègue qu’on appelait le frôleur, c’était son surnom (il est à la retraite depuis pas mal d’années) – il frôlait les étudiantes ; sous prétexte de corriger, il s’asseyait tout près. Un jour il y a une étudiante qui me dit : « Margo, vous ne pourriez pas dire quelque chose à votre collègue ». Je n’avais pas vu. Et donc je lui ai parlé, je lui ai dit « Tu laisses tomber ça » mais il a réitéré. Il y avait deux frôleurs dans le secteur de graphisme, un plus âgé que l’autre. Il y avait aussi quelque fois de la part de mes collègues un excès d’autorité, ils s’énervaient plus facilement avec les filles qu’avec les garçons pour certains. Quand j’étais dans un groupe d’enseignants, je rectifiais le tir. Et tout le monde a le droit au même temps d’enseignement. J’avais des collègues qui à partir de Noël ne s’occupaient plus de certains étudiants parce qu’ils ne les trouvaient pas bons, ce qui n’est pas acceptable. J’ai eu maille à partir avec quelques-uns de mes collègues. On a toujours moyen de sortir quelque chose de quelqu’un. Souvent la réflexion, c’était : « Elle est mollassonne »… évidemment, elle ne va pas faire du karaté toute la journée… Il y avait pour certains une tendance à passer plus de temps avec les garçons. Il y a des étudiantes qui ont souffert de ne pas trouver leur place. Ça dépendait des promotions. Il y a eu des années où il y avait des promotions formidables, et tout allait bien, les garçons et les filles, pas de différence. Et d’autres années où il y avait trois têtes de pont et, les autres, il fallait les traîner, les filles n’étaient pas contentes. À l'époque, on travaillait en groupe, la dynamique se créait en atelier – ou pas.
Et pour les profs femmes ?
Il y a des profs qui étaient plus caricaturées que d’autres dans les toilettes, parce qu’elles n’étaient pas très jolies ou parce qu’elles avaient été déplaisantes. Je me disais toujours : « Si un jour, je me vois dans les toilettes, je m’en vais, j’arrête d’enseigner ». Je pense qu’il y a eu plus de problèmes pour les femmes pour le personnel administratif. Je pense qu’il y avait des femmes dans les bureaux qui n’étaient pas très bien traitées, par les étudiants, par les profs, méprisants – les profs les prenaient pour des servants, hommes ou femmes. Il y a de l’entre-soi social aux Arts Déco. Moi le souvenir que j’ai quand j’étais aux Arts Déco, autant étudiante que prof, c’est que je trouvais que les profs se prenaient très au sérieux et traitaient mal le personnel, comme leur domestique – « Et je vous avais déjà demandé ça et vous ne me l’avez pas donné », ce genre.
Des propos sur le physique ? renvoyant à des attendus du genre ?
Oui. Moi j’ai eu des réflexions sur le fait que je me comportais de manière masculine, évidemment, même si j’étais habillée très provocante, je résistais. En fait j’ai toujours résisté à ce qu’on voulait m’imposer. Je me suis mariée très tard, et j’ai eu un enfant à 40 ans. J’avais eu droit à des réflexions de certaines personnes « Tu devrais faire comme tout le monde, te marier et faire un enfant », j’y ai eu droit à partir de trente ans, je prenais ça à la rigolade.
Quand vous étiez enceinte, vous étiez à l’école ?
Oui, j’ai pris très peu de congés avant d’accoucher, j’ai enseigné et après, j’ai pris des congés normaux. Il n’y a pas eu de difficultés. Mais j’ai le souvenir que personne ne prend des nouvelles de personne. Dès qu’il y a une difficulté, on n’entend parler de personne. Et puis quand on est parti, on est mort. C’est curieux, 25 ou 30 ans de collaboration riche, on s’en va et on n’entend plus rien. C’est finalement pas très chaleureux, malgré les apparences.

Lucile Cornet-Richard
étudiante
de 2016 à 2020
avec
Alexandra Piat
le 12.04.21

- Normes
- Soutien
- Représentation
- Engagement
- Silence et parole
- Déséquilibres
- Langage inclusif
- Design for care
- Sororité
- Féminisme
Entretien de
Lucile Cornet-Richard
étudiante de 2016 à 2020
le 12.04.21 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Lucile Cornet-Richard. J’étais en BTS à Duperré, en Design d’espace et je suis entrée en deuxième année aux Arts Déco, en 2016. J’ai fait un Erasmus en Grèce. J’étais dans le secteur Architecture intérieure. Nom qu’il faudrait vraiment revoir ! C’est aussi lié à ta question parce que pour certains (même à Paris, même chez des architectes) quand tu additionnes Architecture intérieure aux mots arts décoratifs, ça peut être décrédibilisant. On pense que tu vas faire de la déco : tapis, bougies, très bien choisir le plaid qui ira sur ton canapé. C’est pas une combinaison facile surtout quand on est assez jeune et quand on arrive face à des gens en archi, qui sont des hommes de quarante-cinquante ans à qui tu demandes des stages… Ils trouvent ça « mignon et sympa ». C’est quelque chose à vraiment défendre « l’architecture » des espaces habités du quotidien : par une attention aux gestes, aux temps, aux matériaux etc., je pense que ça nous aiderait que l’on renomme le secteur (au plus proche des approches multiples qu’on nous transmet), et donc notre pratique. De manière rétro active, ça la fera aussi évoluer, et fera naître de nouvelles formes ou pensées.
Par rapport à notre sujet de l’expérience genrée aux Arts Déco, qu’est-ce que spontanément tu aurais envie de partager ?
Je me suis sentie assez protégée aux Arts Déco. Parce que naviguant dans un monde où, depuis la Manaa, il y a principalement des femmes et très peu de garçons dans les classes. Par cette composition de classes, il y a plein de sujets qui sont plus faciles à aborder (règles, tristesses, sexualités…). Ou aussi parce que je suis tombée sur les bonnes personnes, mais c’était en général assez facile d’y évoluer.
À la fois c’est facile, et à la fois je pense qu’il ne faut pas déconnecter les Arts Déco de sa ville. Les gens qui sont aux Arts Déco portent aussi l’image ou les codes de Paris. Moi c’est par là que d’être une femme aux Arts Déco, je ne trouvais pas ça toujours évident, parce qu’il y a implicitement des codes esthétiques ou des normes physiques. Si je me refais une représentation des Arts Déco, il y a principalement des femmes et principalement des femmes maigres. Il y a des petits moments où ça m’a un peu posé question. J’avais l’impression que tout le monde était tout le temps très bien habillé, avait le comportement ou la manière de parler qui allait très bien avec ses habits, etc. La maîtrise exacte de son image. Cette importance de la représentation, je la ressens souvent dans Paris, dans ce milieu de l’architecture et du design, où nous incarnons notre métier, nos projets. Je sens que je ne perçois pas du tout mon corps de la même manière quand je suis aux Arts Déco que quand je vais croiser des copains des Beaux-Arts de Quimper, par exemple. Je m’y sens peut-être plus libre, sous moins de codes. Il y a un maintien et une image du corps qui ne sont pas du tout les mêmes : il y a plus de corps différents.
Tu relies ça à la classe sociale ?
Carrément ! C’est aussi pour ça que je me pose cette question-là. Avant, j’étais à Montaigu, en Vendée, puis à Duperré. Je viens de Nantes et je ne viens pas d’un milieu bourgeois culturellement. On lit des livres, on est déjà allés ensemble au théâtre ou à l’opéra plein de fois, mes parents sont fonctionnaires (professeure et administrateur adhoc) et ne sont pas d’un élitisme culturel comme ce qu’on peut rencontrer à Paris. Je pense que c’est ce qui m’a troublée pendant un moment. Je n’avais jamais navigué avec des gens de ce milieu culturel. Je n’ai jamais été complexée par mon corps, j’ai un corps qui rentre dans toutes les normes « demandées ». Mais c’est une des premières fois en deuxième ou troisième année, où je me suis posée des questions de représentation, d’habits, de coupe de cheveux, de trucs dont d’habitude je me fichais complètement.
Est-ce que dans l’école, tu t’es toujours sentie assez libre et à l’aise de travailler partout ? Avec tous les outils et dans tous les endroits ?
Non. Les causes sont multi-factorielles. Je ne suis pas instinctivement manuelle, donc il faut que je sois en confiance et guidée et que j’ai réfléchi avant pour couper un truc, etc. J’ai dû aller (je n’ose même pas dire le nombre de fois) mais très, très peu de fois dans les ateliers bois et métal. Il y a plein de raisons différentes. Très honnêtement, je crois que ça me fait peut-être un peu peur, que j’ai un peu la flemme d’être confrontée à un truc que je ne sais pas faire et qu’on me répète que je ne sais pas le faire. Et encore un truc bête, mais disons-le, c’est qu’en archi, on est entourés principalement par des femmes. Et dans les ateliers, à moins que j’en ai loupés, je ne vois principalement que des hommes. Je ne sais pas si c’est exactement comme ça que ça se joue dans ma tête, il y a aussi le fait que la pratique n’est pas forcément assez intégrée ou obligatoire dans notre cursus d’Archi… Mais maintenant que je suis à l’EnsadLab en recherche, une fois que le Covid ne sera plus un obstacle, je sais que je vais y retourner. Parce qu’en regardant mon cursus aux Arts Déco, je me suis dit que quand même, c’était un peu ridicule de pas me sentir à l’aise et donc de ne pas aller aux ateliers aussi régulièrement que ce que j’aurais pu.
Tu as dit que dans ton secteur il y avait plus d’enseignantes, quel effet ça avait ? Est-ce que tu voyais une différence quand c’était des enseignants ?
Jusqu’en quatrième année je n’ai eu que des profs femmes, sauf deux ou trois profs hommes en cours de maquette, de morphostructure ou en théorie. Là on se pose des questions orientées femme-homme, mais je me pose rarement ces questions comme ça personnellement.
Pour le diplôme une très grande partie des échanges se faisait en visio depuis chez nous. Il y a un moment où c’était très difficile, au sujet de ce que je voulais faire après, payer mon loyer, trouver un job, la pression de mes parents, etc. Et un soir où on devait avoir un compte rendu avec Pauline [Marchetti, enseignante] et Marc [Iseppi, enseignant], j’ai littéralement craqué, je me suis effondrée en larmes. Là, c’est plutôt Pauline qui a pris le rôle de consolation et d’écoute. Mais, je connais mieux Pauline notamment parce qu’elle a suivi mon mémoire et que j’ai fait un stage chez elle pendant quatre-cinq mois.
Aussi, toutes les questions d’éco-féminisme dans mon diplôme, ça a été bien mieux reçu par mes professeures femmes. Pour les autres je crois que ce n’était pas vu comme nécessaire, ou ça ne trouvait pas sa place dans mon diplôme. Je ne sentais pas non plus de réception pour ces questions-là. Ce n’était ni virulent, ni offensif, ni critique, mais ce n’était pas vraiment discuté.
Ton diplôme, c’était sur quel sujet ?
Mon diplôme c’était le réaménagement du Collège Travail Langevin à Bagnolet. Avec des références justement autour de l’éco-féminisme ou de Ivan Illich, qui parle de la société sans école etc. J’ai fait des ateliers avec des collégiens et collégiennes, on a fait des cartes sensibles, des cartographies des ressources humaines, végétales, minérales, etc. On a glané plein d’éléments végétaux, on a fait des expériences comme de la teinture végétale, de l’impression végétale, de la taille d’objets en bois… L’idée, c’était en leur montrant la différence dans le vivant qui les entoure, de parler de la différence au sein du collège. Et c’est en montrant, par exemple, la multiplicité de la couleur verte des verts qu’il y a dans le paysage qu’ils ont eux-mêmes fait la traduction avec la multiplicité des couleurs de peau.
Après toutes ces étapes de cartographie et d’expérimentation, on a fait plein d’interviews et les collégiennes ont écrit des discours. C’était vingt discours vers 2020. Elles ont parlé de leur religion, de leur couleur de peau dans le paysage, etc. À partir de ça, j’ai fait un projet d’architecture pour lequel j’ai proposé une intervention frugale : déplacer des éléments architecturaux démontables du collège vers le reste du territoire. Un aller-retour entre architecture et pédagogie. En se disant que si on modifie les lieux, on peut modifier les pratiques pédagogiques et donc la conscience de chaque adolescent et adolescente de son territoire. Transformer, en catalysant toutes les ressources sondées sur le territoire, ce collège : lieu de savoir en milieu d’apprentissage. Et c’est ce que je développe de manière plus construite et sur de nouveaux terrains pour cette recherche à l’EnsadLab.
Et par exemple, il y a une question qui s’était posée. En archi, les petits personnages qu’on met dans les perspectives, c’est toujours des gens blancs qui font trente-six kilos à tout casser et qui sont habillés type parisien, rive droite. J’exagère à moitié, vraiment. Ça on l’avait vraiment nommé, pointé et questionné lors d’un premier projet à Niolon à côté de Marseille, qu’on avait mené avec une association qui accompagne des personnes porteuses de trisomie 21. C’était drôle de voir comment dans certains projets il y avait des personnes filiformes qui habitaient ces lieux. Alors qu’en soi, on les dessine pour des personnes qui sont porteuses de handicap, bien plus petite que la « norme ». Dans mon diplôme[fig.34], cette question de la représentation dans le projet d’architecture s’est de nouveau posée. En tout cas, c’était un point important à considérer. Et je crois que ces questions de genre dans l’archi elles se posent aussi là. Pour construire une société, un monde plus inclusif, ça passe notamment par des toutes petites images.
Ton travail de diplôme semble assez engagé politiquement. Est-ce que tu as senti un encouragement dans ces questions, dans ces réflexions ?
Non. Mais il n’y a pas eu de critiques ouvertes, pas particulièrement d’encouragement ou d’appui (sur l’écologie, les migrants, etc.). Ce que je veux dire c’est que d’habitude, quand on a nos cours de projets, toi tu viens avec une petite idée qui est en devenir et le prof, il est là pour te faire faire un saut de kangourou vers là où tu pensais peut-être aller. En tout cas, il est là pour te chambouler vers un truc que toi tu inities un peu. L’école — et moi ça m’a beaucoup frustrée et là encore plus à l’EnsadLab — n’est pas un lieu de discussion politique. Quand tu parles de décroissance, franchement, peu rebondissent. Anti-capitalisme, personne ne rebondit. Féminisme, il ne faut pas trop le marteler, l’afficher tel quel. Vraiment, c’est un peu gris beige. Heureusement Roxane Jubert [enseignante depuis 1997] apporte un discours très tranché sur des questions écologiques notamment, et ça, ça me réjouit et me conforte. Je pense que parfois je passais pour une gaucho écolo qui se balade tous les week-ends en manifestation. Bon, ce n’est pas très grave, mais c’est vrai que pour moi ça n’a pas été du tout l’endroit d’émulation d’idées politiques.
Il y a une différence entre politique politicienne et vraie politique. La vraie politique, celle que tu abordes par exemple dans ton projet, ça devrait parler à beaucoup de gens et surtout à des designers.
Oui oui ! Jamais je n’ai parlé de partis politiques ou des verts ou de je ne sais qui. Parce que ce n’est pas comme ça que ça m’intéresse, mais par exemple de parler aujourd’hui de ce que fait Macron, pour moi, ce n’est pas une chose qui est politisée. C’est en fait le monde qu’on traverse et donc, c’est une question qu’il faut se poser, qu’il faut regarder et que critiquer, ce n’est pas forcément se positionner à sa gauche ou à sa droite. C’est juste prendre position pour ce vers quoi on veut aller.
Dans l’école, est-ce que tu as déjà vécu ou été témoin de propos ou de gestes déplacés au sens large, de l’ordre du sexisme ?
Non, quand tu parles de gestes, de paroles, etc., non. Par contre, des comportements… Je ne sais jamais comment les formuler, parce que pour moi, ça relève du sexisme, mais il y a une énorme partie d’éducation, de culture, du caractère de la personne, etc., donc c’est difficile. Mais à l’EnsadLab il y a des gens, des hommes qui parlent beaucoup et qui ne regardent pas si tu as commencé à parler. Ce qui se voit beaucoup moins en visio, mais quand on est autour d’une table, on voit quelqu’un qui est en chemin vers la parole. Il se redresse un tout petit peu et prend une micro respiration. Il y a des hommes qui ne prêtent pas attention pour laisser la parole à quelqu’un, qui serait potentiellement une femme. Donc, c’est plutôt cette prise de parole un peu écrasante, longue parfois qui de temps en temps, on va se le dire, relève un peu du sexisme. Mais ça se travaille et j’ai vraiment l’impression que ce sont des gens qui restent à l’écoute.
Entre le cursus initial aux Arts Déco et la recherche, est-ce que c’est différent. Est-ce que ça paraît plus difficile d’être une femme et d’exercer ta pratique librement ?
Dans la recherche ce qui est compliqué en étant une femme, c’est que par exemple, je veux m’entourer principalement de femmes pour travailler et pour faire ma recherche sauf qu’il y a plus d’hommes HDR (habilités à la direction de recherche) que de femmes. Et ça va être des hommes de soixante-soixante-cinq ans, surtout dans le milieu de l’archi ou du design. Il y a très, très peu de femmes HDR, et je ne vais pas prendre n’importe laquelle juste pour que ce soit une femme. Après, la recherche ce n’est pas évident, je ne sais pas si c’est parce que je suis une femme. Par contre, ce qui n’est pas évident, c’est de faire de la recherche en allant vers un département.
Nous à l’EnsadLab on a quand même « de la chance », j’ai l’impression qu’au sujet de tous ces sujets de genre, de décolonialisme, pleins d’attentions ou de considérations, certains entendent ou écoutent ou observent ou contemplent, etc. C’est quand même présent. Mais dans les administrations, ça ne l’est pas du tout. C’est quand même un peu violent de recevoir, pour un sujet de réaménagement de la cour d’un collège « On ne va pas faire confiance à une petite nénette de 25 ans »… C’est à un niveau de « moyen-âgerie » qui est bien plus incroyable qu’à l’Ensad. Je pense que ce sont des petites attentions, des manières de parler et des manières d’utiliser des phrases inclusives, etc. Moi, c’est ce que j’attends de l’EnsadLab, c’est qu’on arrête de m’envoyer des « bonjour à tous ». Pour certains, ça reste de la forme, alors que pour moi c’est du fond que d’utiliser un « bonjour à toutes et à tous ». Qu’au moins le mail, je le reçoive aussi pour moi. Parce qu’en plus, il n’y a pas de pré-doctorant au groupe Symbiose, on est trois filles.
Sur quel sujet était ton mémoire ?
Pour mon mémoire j’ai travaillé sur la patience. Ça s’appelait Patient : un corps en attente — Les non-lieux de la patience [dirigé par Pauline Marchetti, 2019]. C’était sur les espaces d’attente dans le milieu hospitalier. L’hôpital, pour mon mémoire, ou l’école pour mon travail de recherche, sont des formidables lieux d’observation d’analyse de ce qui se passe dans la société : le rapport au soin, à la vitesse, aux marges, à la rentabilité etc. L’enjeu était de voir à quel point, même si on a fait des avancées technologiques et médicales incroyables, la conception de l’espace n’a pas du tout changé. En naviguant un peu entre objectivité et subjectivité, j’ai voulu faire un état des lieux de l’hôpital aujourd’hui, et de son rapport aux malades, aux patients et à leur famille. Le parcours du patient est constitué je dirais d’environ 90% d’attente. En parlant de cette temporalité et de ces effets, je dénonce une situation qui reflète l’état des relations entre l’architecture et la société. J’ai tenté d’ancrer et de lier l’aspect physique du lieu à sa charge émotionnelle. Dans une société stressée comme la nôtre, l’hôpital est tout aussi surmené. Donc j’ai pris comme lieu d’observation les quelques lieux où le corps s’arrête, et attend. Le hall, la salle d’attente, le couloir, le cabinet, la chambre. On fait preuve d’une négligence envers ces espaces. C’est complètement délirant de se dire qu’un patient va devoir attendre, donc on lui met une salle d’attente avec des magazines qui datent de 2014. Les recettes sont encore d’actualité, mais les gars sont tous morts.
Est-ce que tu as inscrit ça dans une réflexion autour du care ?
Pour être très honnête aujourd’hui, oui, au moment de mon mémoire, pas du tout. Je pense que j’ai découvert vraiment ce vocabulaire-là en fin de quatrième année. Et en fait, là où je me dis que je suis contente de ne pas l’avoir su avant, c’est que c’était ce que j’avais envie de faire, c’était mon intuition liée à mon éducation, liée aux choses que j’ai croisée, qui m’ont chamboulé, énervé, émue. Donc c’était la manière dont j’avais envie de faire du design ou dont je regardais les choses, et elle était animée par mon intuition. Ensuite j’étais contente de me dire que ça avait un nom, mais aujourd’hui je le vois à toutes les sauces le care. C’est à dire que tu fais un câlin avec une personne c’est du care. Ce n’est pas parce qu’on fait une rampe accessible aux PMR que tout d’un coup, l’architecture est dans le care. La notion de care, par rapport à mes envies de vivre ensemble, de reconnexion à la nature, ces intuitions-là, qui peuvent ressembler, si elles sont un peu mal dites, à des discours de Miss France, finalement, ça m’a permis de consolider mes idées, de les spatio-historiser et de me rendre compte de qui parle de quoi, mais de ne pas vouloir à tout prix coller à cette chose-là. Maintenant, ça me permet quand même d’aller plus loin et ça me donne une exigence de pensée, mais ça ne m’a pas donné une nouvelle route en me disant que maintenant il fallait que je sois éco-féministe.
Dans l’école, est-ce que tu as ressenti le besoin et est-ce que tu as trouvé un sentiment de sororité, ou de communauté au sens plus large ?
Pas trop. Je pense que je n’en ai pas eu forcément besoin, mais aussi je pense que je ne fonctionne pas comme ça. Le groupe me déstabilise toujours un peu. Je vois que par contre, j’ai besoin d’avoir des figures qui me font me dire « Ah, ça, c’est possible ! ». M’entourer ou contempler des gens… Il est presque un peu trop fort ce mot, mais c’est un peu ça. Contempler des gens en me disant que ça ouvre un truc possible. Parfois ça passe par des choses minimes du quotidien, des coupes de cheveux, des manières de parler, des mots utilisés… Ça, ça me fait du bien. Et c’est là où quand même, c’est génial qu’il y ait autant de femmes parce que tu as un milliard de bouts de courage dans la journée, si tu as le moral du dimanche qui t’est resté dans les chaussettes du lundi… Je ne sais pas, je crois que c’est aussi en regardant la manière d’être, de vivre, de se déplacer des autres, en trouvant les autres chouettes, que tu trouves de la sororité qui te fait avancer.
Il y a aussi le fait d’avoir autant de prof femmes. Parce que quand j’ai fait des stages en archi, ce n’était au début qu’avec des hommes, je me disais que je n’allais pas réussir à aller avec de la joie et de la confiance sur un chantier. Donc, voir autant de femmes qui sont là — en plus on a de la chance parce qu’on a des profs qui sont toutes professionnelles — ça te donne des possibles. Ce n’est pas que tu vas ressembler à ça, mais oui, c’est possible d’être une femme, d’avoir fondé une agence d’archi, d’avoir trois gosses, de parler fort, d’avoir de grandes idées et de ne pas être d’accord là où ce serait convenable d’être d’accord. Ce sont des images dont tu as besoin pour te projeter. Quand on a beaucoup de femmes profs autour de nous, ça nous aide à imaginer notre métier : être une architecte.
Est-ce que l’école t’a donné confiance en toi et en tes capacités ?
C’est difficile de dissocier l’école du reste de ce qui nous traverse ou rencontre pendant ces années, mais je sais que j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Pauline Marchetti, qui est une des profs les plus exigeantes que j’ai croisées dans ma vie vraiment. Parfois c’est dur parce qu’elle te fait tout refaire, parce qu’elle te met vraiment en doute. Mais c’est parce que j’ai énormément douté, que j’ai pris confiance en moi, parce qu’après, elle sait te dire que tu as beaucoup évolué. Elle m’a vraiment beaucoup accompagnée et chamboulée. J’ai fait la troisième année et mon stage avec elle dans son agence-studio de recherche et après, elle était là lors de mon diplôme. Donc, il y a un suivi joyeux.
Ce qui est chouette avec les Arts Déco, même s’il y a mille choses à critiquer, c’est que comme c’est pluri-inter-transdisciplinaire, je vois toutes les choses que je ne sais pas faire. Ça m’a rendue super heureuse quand j’ai fini le diplôme qui s’était très bien passé, où les gens étaient enthousiastes, joyeux, bienveillants. Mais c’est aussi que je ne me disais pas « J’ai fini l’école, maintenant, je vais avoir un métier, un garage, un chien. » Je me suis plutôt dit « Ouah ! Il me reste tout ça à apprendre ! ». Et c’est là où ça m’a donné confiance, de pouvoir faire des choses que je ne savais pas faire, d’aller chercher des outils ou des gens, d’avoir eu la ressource à l’école. De pouvoir toquer à la porte de quelqu’un et dire ce que j’ai besoin d’apprendre. Je peux prendre des risques, parce qu’il y a des gens derrière qui peuvent m’aider ou m’épauler, me conseiller. L’école m’a donné une capacité d’enthousiasme, de la confiance et l’envie de « faire », l’envie d’y aller.
Je pense aussi que les gens dans ma classe forcément m’ont donné, transformée. C’est quand même fou aux Arts Déco d’avoir un sujet qui est lancé et huit personnes à côté de toi qui répondent de manières différentes. C’est hyper jouissif de se rendre compte de ça, et je pense que c’est ça qui donne confiance.
Quel regard tu portes sur la pédagogie à l’école ?
Il y a toute la question de la transition écologique : il faut qu’on arrête d’être en transition, il faut qu’on s’y mette tout de suite. On ne peut pas viser la transition, c’est juste le moyen, le moment où l’on apprend et on bouleverse, mais il faut viser l’égalité, l’équité, la justice et la justesse. Viser le bon sens en fait. Nos profs ne sont pas forcément formés aux éco matériaux, tout ça, donc ce ne sont que des gens extérieurs qui sont venus nous parler du pisé [mode de construction] ou d’autres choses comme ça. Ça reste hyper anecdotique et puis des conférences, franchement, si tu te fais deux heures et demi de conférence sur la terre, tu ne sais pas comment l’utiliser ensuite. Il faut le raccorder au réel, à la matière et au terrain-territoire. Il y a des bonnes intentions, mais tu sens qu’il va falloir que ça soit concret. C’est aussi à nous, en tant qu’élèves, d’agiter et emporter ces sujets, parce qu’on se rend compte et les profs le disent bien, que sur ces questions d’écologie, pour certains, on est plus alertes, parce qu’on est nés là-dedans.
L’École ce sont des personnes, des profs, des élèves, une administration, etc. Donc il faut que tout le monde puisse vraiment porter ces sujets-là. Et pour l’instant, ce n’est pas du tout le cas. Il y a des profs, qui eux vont vraiment habiter le sujet que tu vas leur donner. Tu vois qu’il y a des profs qui n’ont pas du tout le même enjeu de transmission. Et il faut plein de types de profs différents, je suis d’accord. C’est juste que là, sur ces questions d’écologie ou du rapport au genre ou au racisme, il faut que les profs soient plus engagés et qu’ils aient de vrais discours. Pas que ce soit au stade d’observation. Je suis étonnée qu’on ne nous fasse pas plus comprendre la responsabilité qu’on a. Ça, ça m’a vraiment hyper étonnée aux Arts Déco. Avant de rentrer en Manaa, à Montaigu, on nous a fait lire des livres. Il y avait Stéphane Vial, William Morris et quelqu’un d’autre. J’avais réalisé la place des designers dans la consommation, la pollution, l’obsolescence programmée et déjà ça me faisait réfléchir. Et pourtant, les profs ne parlaient pas de politique mais on nous a expliqué la responsabilité que c’était de produire des formes, des images, ou des espaces, dans quel contexte on arrivait. Et je suis étonnée qu’aux Arts Déco, on ne nous rappelle pas plus ça alors qu’en sortant, on va tous fabriquer des images, des mots, des formes, des espaces, qui vont prendre beaucoup de place dans le quotidien spatio-temporel des gens. J’aurais bien aimé avoir plus de profs comme Pauline, qui sont critiques sur la forme et sur le fond, qui viennent te rappeler de penser à ta responsabilité. C’est en ça que je pense que la pédagogie peut/doit évoluer, être plus critique, pas virulente, plus engagée, dans le sens d’impliquée ou raccordée au réel…
Toujours concernant la pédagogie, ça me semble hyper important d’avoir des profs de différentes générations et qui ne viennent pas que de Paris. Pour éviter une pensée et fabrication de Paris pour Paris dans Paris. Pour que l’on imagine un autre monde et que l’on bouleverse ce qui est établi, par les outils qu’on se construit à l’école, il faut qu’on soit accompagnés par de multiples profils. Et que tous·tes soient conscient·es de leur confort ou privilèges. Idem pour les élèves.
Je parlais de langage inclusif [fig.35] tout à l’heure, par exemple j’aimerais bien réussir à apprendre toutes les notions d’écriture ou de langage inclusif par l’école. Pour pas qu’on se retrouve avec des tournures de phrases horribles et que ce soit incompréhensible. J’ai l’impression que comme on est en train de créer, on est censé créer avec ces outils-là et pas les coller par-dessus après pour en faire une espèce de modelage dégueulasse. Donc, je suis vraiment étonnée que l’école, même avec autant de profs ou de théoriciens théoriciennes qui ont l’air plutôt alertes sur ces questions-là, ne prenne pas plus en main cet outil. Dans la pédagogie, je pense qu’il y a vraiment ça à prendre en compte, surtout dans cette ère de « transition » (genre, écologie…).
Est-ce que dans le cadre de tes cours (de théorie ou de secteur) tu as entendu parler de créatrices, de designeuses ?
Oui. C’est là où je crois que, comme l’école est faite par les profs et par les élèves, je suis allée chercher ce dont j’avais besoin comme apport. Par exemple, en allant aux cours de Marie Canet. J’ai eu ma dose de féminisme et après, peut-être que j’ai fait abstraction d’entendre principalement des hommes en archi, je ne sais pas. J’étais hyper heureuse, enthousiaste, chamboulée de ce cours, mais aussi parce que la personne n’est pas « normée ». Marie Canet je pense qu’elle n’est pas restée trop longtemps aux Arts Déco [Marie Canet est enseignante à l’École des Beaux-Arts de Lyon, et intervient pour un cours à l’Ensad], et donc elle n’a pas du tout la même manière de penser ou de présenter ses idées et ses cours que les autres profs. C’est ça qui m’a fait beaucoup de bien. Donc ensuite, peut être que je m’en fichais un peu d’avoir des références de femmes en cours d’archi. Rencontrer Marie Canet peut-être que ça m’a fait croire que l’école était complètement féministe et bouleversante. Je ne sais pas.
Tu parlais de sororité tout à l’heure, ce cours-là, il m’a fait cette sensation. On n’avait pas forcément de temps, il y avait une densité de choses énormes, mais par exemple, je me suis sentie beaucoup plus à l’aise par mail de poser des questions même mal formulées. J’ai l’impression que et le fond et la forme étaient chouettes et que j’avais la place de dire « je ne sais pas ». Ça n’a pas forcément été le cas dans tous les cours en archi ou à l’EnsadLab.
Est-ce qu’il y a des choses dont tu aimerais parler, sur lesquelles je ne t’ai pas posé de questions ?
Je ne me pose pas beaucoup ces questions-là dans ce schéma : femme ou homme. J’ai l’impression de plutôt parler de la personne en elle-même, son caractère, sa gestuelle, ses mots.
Par exemple au collège Travail Langevin pour ma thèse, je commence à travailler avec le département sur le réaménagement de la cour de l’école et une des choses importantes est de faire un espace qui soit équitable, égalitaire, inclusif entre garçons et filles. Cette question garçon-fille, me paraît mal posée car dépassée, mais finalement, elle est encore hyper utile parce qu’elle est non résolue. Parce que ça me semble être un non-sujet (non-débat), je ne m’y intéresse pas assez, et pourrais faire plus de lectures en ce sens. Et il faut faire attention, par exemple, au fait que les Arts Déco sont un cocon, où toutes ces questions-là, le monde queer, c’est largement acquis — ou du moins j’ai l’impression — donc à l’extérieur je crois que c’est aussi acquis et plusieurs fois je suis tombée de ma chaise.
Je pense qu’à l’école, on a tous·tes des expériences très différentes et surtout en fonction des secteurs dans lesquelles on a été. Si je te téléporte dans mes cinq ans aux Arts Déco, tu penseras sans doute différemment. Ayant été en secteur Design graphique mon vécu est forcément très différent. Il y a des vécus communs, on a fait la même école, mais il y a quand même dix écoles dans cette école.
Oui, c’est vrai. Et je vois bien que mon parcours par rapport aux sept autres élèves de ma classe est hyper différent. Personne n’avait suivi les cours de Marie Canet donc déjà ça donne des références très différentes. Ça te fait voir le monde très, très différemment.

Annabel Vergne
ancienne étudiante,
enseignante
depuis 2006
avec
Lucile Encrevé
le 24.02.21

- Minorité
- Déséquilibres
- Modèle
- Écoute
- Épanouissement
- Discrimination positive
- Âge
- Contournements
- Sexisme
- Relation aux étudiant·es
- Écologie
- Directrice
- Hommage
- Enfants
- Identification
Entretien de
Annabel Vergne
ancienne étudiante, enseignante depuis 2006
le 24.02.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Tu as été étudiante, avant d’être enseignante, je crois ?
Effectivement, je suis arrivée comme étudiante à l'Ensad en 1990. J'étais très jeune, je suis entrée à dix-huit ans. Je venais d'Angoulême. C'était un énorme changement pour moi. Je suis passée d’une petite ville à Paris, et aux Arts Déco, où les gens étaient tous plus âgés que moi. Il y avait seulement une autre étudiante qui avait 18 ans, mais c'était quand même assez rare d'arriver juste après le bac à cette époque. Je n'avais aucune connaissance de ce que pouvait être l’Ensad. J'étais très innocente, insouciante ; on m'avait dit que c'était un concours difficile et je m’étais dit : « Pourquoi pas ? J'essaie ». Je savais dès le début que je voulais aller en scénographie. L’École était en quatre ans. Je l’ai faite en cinq ans parce j'ai pris plus de temps pour écrire mon mémoire qui était la dernière étape du diplôme.
Il portait sur quel sujet ?
J’étais très intéressée par la représentation et la peinture. La Renaissance italienne me touchait beaucoup. Mon mémoire portait sur les Batailles de Paolo Uccello.
Les trois tableaux, dispersés dans trois musées [La Bataille de San Romano] ?
Oui, ce triptyque : j’ai essayé d’analyser quelle était la spatialité de ces trois panneaux une fois réunis. J'étais très intéressée par toutes les questions d’illusion de perspective et de fausse perspective. Et puis, il y a aussi dans ces tableaux un rapport à la vitesse et à la représentation du mouvement que je reliais au futurisme et à la chronophotographie et qui me parlait beaucoup. Finalement, je pense que le fait que ce soit des batailles, ça m'intéressait aussi parce que ça ne correspondait à rien pour moi. Mon directeur de mémoire était Romano Prada, il enseignait en scénographie, c'était quelqu'un d'assez étonnant, ingénieur de formation – il co-produisait les émissions Palettes avec Alain Jaubert et cela me fascinait complètement.
Il n’y a que des hommes dans ces trois tableaux, tu y pensais à l’époque, en tant que femme ?
Je ne me suis jamais considérée comme une femme… (si ça peut t’intéresser)… Je pense les relations, les rapports de personne à personne, pas du féminin au masculin. Mais tu as raison d’en parler car ce sont des questions importantes sur la manière dont on se situe soi-même. Est-ce qu'on est une femme parce qu’on est de sexe féminin, parce qu’on a des « qualités féminines » ? Cette question du féminin et de la féminité, disons que je n'ai pas eu envie de la traverser, je n’ai pas eu envie qu’elle me caractérise et, dans mon rapport aux autres, je n'en tiens pas compte. Je ne vois pas les choses sous ce prisme.
Il y a d’autres questions, posées par ces œuvres, qui restent importantes pour toi aujourd’hui ?
Peut-être la question de la mort. J'avais travaillé en 3eannée sur un projet de spectacle [fig.36], à l'Ensad, où j'avais utilisé des œuvres d’Uccello associées à un texte d'Antonin Artaud Uccello, Le poil [La Révolution surréaliste, n°8, 1erdécembre 1926] qui traitait de questions de représentation en peinture : un peintre, Uccello, peignait sa femme et était tellement pris par sa peinture qu'il en oubliait qu’elle était une personne vivante ; elle restait immobile en position de modèle, pour lui (et pour lui plaire), et elle mourait de faim, c’était symbolique et humoristique aussi.
C’est assez genré, non (même si la destruction du modèle, ça excède la question du genre) ?
Pour moi, il s’agissait de rapports humains, le modèle aurait pu être un homme… Mais tu as raison, quand je revois mentalement les images qui habitaient ce spectacle, c’était genré. J’avais demandé à la personne qui incarnait la jeune femme d’être dans une position d’accablement, assise et légèrement penchée en avant. Il y était question d’une chasse à courre avec des chiens et des chasseurs (évidemment des hommes) qui composait une image avec un point de fuite dans une forêt sombre, ce qui était vraiment l’image du piège, puis pour représenter symboliquement la mort de la jeune femme qui devenait donc image, j’avais imaginé un dispositif qui « dévorait le corps et le faisait disparaître », la jeune femme passait de volume à image.
En Scénographie, autour de toi, il y avait des enseignantes ?
Je pensais en priorité te raconter mon rapport avec une enseignante que j'ai eue, Françoise Darne [enseignante de 1991 à 2008]. Ce fut une personne importante pour moi, notamment parce que c'était la seule femme de notre secteur Scénographie. Elle est arrivée en même temps que moi aux Arts Déco. Pour moi, c'était hyper important de pouvoir travailler avec une femme. Françoise Darne avait dû batailler pour être là, c'était vraiment un monde d'hommes. Dans notre année, parmi les élèves, il y avait deux garçons et beaucoup de filles, on devait être neuf ou dix en tout. Et il n'y avait pourtant que des enseignants hommes, scénographes, en dehors de Françoise Darne. C'était problématique, c’était anormal pour moi qui ai vécu dans une famille très égalitaire. Et c’était assez incompréhensible : que devenaient les jeunes femmes qui faisaient ces études-là ? Pourquoi est-ce qu’elles n'étaient pas représentées ensuite en tant qu’enseignantes, puisqu'elles étaient là en train de se former ? A son arrivée, Françoise Darne se positionnait très différemment. Elle était très discrète, c'était sa première année, elle était aussi dans la découverte de sa position. Donc, elle ne ressemblait pas aux enseignants qui étaient déjà là : la différence était attractive. Elle disait peu, parlait très peu. En même temps, mon souvenir est qu’elle était très présente en terme d'accompagnement – elle était assez maternelle, même si elle ne voulait pas l'être. J'ai eu un rapport privilégié avec elle et un vrai attachement. Peut-être comme une représentation possible de moi-même. Quand je l'ai rencontrée, elle faisait des projets qui étaient prestigieux – j'ai pu aller voir des répétitions avec elle à la Comédie-Française et à l'Opéra Bastille. Elle représentait une réussite féminine, elle avait obtenu sa place et elle nous transmettait son expérience. À l'époque, on apprenait aussi beaucoup des autres étudiants du secteur – il y avait plus de transversalité, entre les années, on passait notre temps ensemble dans la salle noire à aider les projets de chacun.
Il y a des étudiantes avec lesquelles tu as gardé des liens ?
J'ai gardé une amie, Emmanuelle Sacchet, avec qui j'ai travaillé, au moment de sortir de l'École, avec le Conservatoire d'art dramatique. On avait envie toutes les deux de travailler avec un jeune metteur en scène, Jean Boillot. Et, plutôt que d'être en concurrence, on s'est dit que c'était plus intelligent et plus intéressant de travailler ensemble. On a collaboré, ça a consolidé notre amitié.
Et comment es-tu revenue, comme enseignante ?
J’avais eu quelques expériences de workshops en étant invitée, plutôt comme jeune plasticienne, par Jean-Paul Thibeau, aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Et ça m'a fait découvrir que c'était très riche, excitant, de pouvoir partager des expériences, d’être dans une position d'écoute : où on est écoutée et où on écoute beaucoup aussi. Je pense que c'est un rapport qui me plaît beaucoup, de découvrir des univers et de pouvoir rebondir et réfléchir sur un projet. Le travail du scénographe est aussi basé sur l’écoute – tu entends les désirs d'un metteur en scène (ou d’une personne qui porte un projet) et tu essaies d'être en adéquation à la fois avec ton esthétique, tes envies et ses envies, ses idées et tu composes avec tout ça. Comme scénographe, tu traverses vraiment les univers d’autres personnes. Et la question pour moi, jeune scénographe en 1990, était : est-ce qu'on doit en tant que scénographe avoir un vocabulaire personnel ou est-ce qu’on doit s’adapter au sujet ? Quelle place je me donne et qu'est-ce que j'impose ? Mon grand modèle, comme étudiante, était Marcel Duchamp, chez qui il y a de grandes variations formelles. Mais j'étais aussi très admirative de Claude Chestier, qui avait une formation de paysagiste et qui faisait les scénographies d’Éric Vigner. Il avait un vocabulaire plastique très fort. J'étais un peu dans ce grand écart. Aujourd’hui, je pense que je suis dans l'accompagnement. Je crois que, malgré tout, il y a toujours des formes qui reviennent et, quand je conçois un espace, je fais beaucoup évoluer mes espaces, j’enlève, je vais vers une forme d’épure. À l'époque où j’ai commencé à enseigner, j’avais envie de faire mes propres spectacles. C'était un engagement fort, mais c'était aussi très difficile d’en vivre et donc l'enseignement m’est apparu comme une façon d'être à la fois dans un rapport de recherche, de rencontres, de renouvellement, mais aussi dans un cadre financier rassurant pour chercher. Il y a eu deux départs à la suite en scénographie, l’École a recruté un homme, Raymond Sarti, puis une femme, moi. J’ai eu le poste grâce à mon travail mais aussi parce que j'étais une femme – on me l’a dit après. La parité commençait à devenir un vrai sujet lors des recrutements et des équilibres pédagogiques. Cela m’a été profitable. J’avais 34 ans. Je me sentais très jeune, ce qui a été fructueux. Les élèves adorent avoir des gens de leur âge. En fait, la continuité est très séduisante pour eux. Je sentais qu'il y avait une adhésion vers moi parce que j'étais jeune. Parce que j’étais une femme ? Je n’y ai même pas pensé…
Dans les réunions de secteur, est-ce que tu ressentais un côté déséquilibré ?
Non, ça ne me pesait pas, je ne le voyais pas. Pour moi, la difficulté, c'était l'âge, la différence d'âge – et également que mes anciens enseignants soient devenus mes collègues. Je suis dans un secteur où les enseignants sont très respectueux et ne sont pas dans un rapport de domination homme/femme.
Et quand Élise [Capdenat, enseignante depuis 2009] est arrivée, est-ce qu’il y a eu une complicité particulière ?
On était étudiantes presqu’en même temps, on était déjà amies lorsque nous étions étudiantes. Donc, c'est sûr que quand elle est arrivée, ça a créé une complicité supplémentaire. On est maintenant référentes du secteur ensemble. C'est la personne avec laquelle je sais que je peux le mieux travailler à cause de cette complicité de longue date.
Depuis combien de temps es-tu référente ?
Depuis cinq ans. Brice [Leboucq] a été coordonnateur dix ans et a « insisté » pendant un an pour que je devienne coordonnatrice. Ce n’était pas un désir de ma part – ce n'est pas un modèle pour moi d'être dans une position d’autorité. D’être à cet endroit, coordonnatrice ou référente, change complètement le point de vue qu’on peut porter sur l’École.
Et tu as participé aux instances ?
Au collège des coordonnateurs (dans mon souvenir, il n'y avait que des hommes). Ce collège était intéressant car on avait la possibilité de dialoguer, entre référents, à égalité de parole, même s’il y avait des secteurs très, très autoritaires, masculins, qui gardaient leur pré carré. Depuis, on ne se rencontre plus tous ensemble pour des discussions pédagogiques et c’est regrettable.
Et tu as été au CA [Conseil d’Administration], récemment ?
C’est un très mauvais souvenir, il fallait batailler pour être entendue. Les représentantes des enseignants étaient plus vindicatives, plus engagées et plus prêtes à monter au créneau dans les moments de désaccord. Mais c’était une lutte pour être entendues, nous le faisions pour le bien commun et nous étions perçues par les personnalités extérieures de l’École et par la direction comme des obstacles.
Mais dans l’École, comme étudiante ou enseignante, ça a été plutôt facile en tant que femme, face aux hommes ?
J’ai plutôt ressenti des difficultés dans le milieu du travail à l’extérieur de l’École – il y avait la difficulté d’être jeune et le fait d’être une femme. J’ai quand même remarqué, à l’École, que je change parfois de comportement parce que je suis avec un homme qui se comporte de façon machiste ; je contourne le problème en étant moi-même dans une posture féminine. Je ne suis pas dans la lutte, je vais accompagner pour obtenir ce que je veux obtenir. Enfin, disons que j'exploite mon côté féminin (pas trop) – mais c'est comme un retranchement, c'est clair. Je ne m’en réjouis pas !
Mais tu n’as jamais subi d’agissements sexistes ?
Je ne m'en souviens pas. Ce sont des choses qui peut-être ont existé mais que j’ai éludées. Comme quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Je ne dis pas que cela n'a pas existé, mais je n'ai pas mémorisé de moments. Il y a eu un technicien en scénographie qui était vraiment, vraiment très difficile, mais qui était difficile avec tout le monde ; il l'était encore plus avec les femmes – il a quitté l’École depuis. Il a été insultant, mais pas forcément directement vis-à-vis de moi. J'ai assisté à un moment avec une intervenante éclairagiste invitée. Il a fait une remarque très déplacée et d’autant plus humiliante que c’était devant des élèves. C’était tellement déplacé que l’on n'a pas su répondre, j'aurais dû le remettre à sa place.
Et les étudiantes, si problème il y a, elles viennent vous parler ?
Les filles viennent parfois se confier à moi et à Élise. On a plusieurs étudiantes qui ont eu de grandes difficultés et des relations vraiment difficiles avec les assistants techniques – elles ont eu du mal à travailler en salle noire parce qu’elles étaient mal jugées et recevaient des commentaires très désobligeants, voire humiliants. Leur parade est d’aller travailler en studio vidéo parce qu'elles y sont bien mieux accueillies.
Comment tu peux réagir ?
Clairement, je pense qu'on manque d'outils. J’écoute. Mais tant que c'est oral, ça n'a pas de poids juridique. Le passage par l’écrit est le seul levier que je vois pour l’instant.
Tu es un modèle pour elle ?
On m’a déjà dit que j’étais trop maternante, trop présente – comme un reproche.
C’est une attaque sexiste, ça, non, ce renvoi à la maternité ? Tu te sens maternante ?
Non ! Mais j'essaye d'être en empathie, de me placer de leur point de vue. Donc peut être que c'est une façon d'être maternante… j'essaie de les aider, de les outiller.
Être à l’écoute, on peut voir ça comme genré féminin. Tu n’es pas dans la domination.
C'est en train de devenir un problème de notre secteur. Elise et moi avons beaucoup écouté, fait des bilans, transformé nos enseignements. Et malgré cela, nous recevons des reproches très rudes de nos étudiants. C’est douloureux. Nos étudiants nous mettent à un endroit d'exemplarité impossible à tenir. Si on ne correspond pas à ce qu'ils attendent, on peut déchoir très vite. Il y a une très forte demande d’égalité dans les discussions, et les étudiants le ressentent comme un manque de respect et d’attention lorsqu’elle est perçue comme manquante, ce qui est malheureux parce que nous essayons vraiment de créer cette relation de partage et de respect.
Est-ce que dans toutes ces années d'enseignement, il y a eu des relations fortes, justement égalitaires, que tu as pu mettre en place avec certains étudiants à travers le Grand Projet ou à travers certains mémoires ?
Bien sûr ! Des gens que je considère maintenant comme des amis, que je revois – surtout des femmes, d’ailleurs. Je pense que les personnes qui me marquent, ce sont celles qui, d'une certaine façon, n'ont pas besoin de moi et ne me voient pas seulement comme une enseignante. Il y a Anne-Sophie Turion [diplômée 2010], dont j’ai suivi le mémoire et qui a fait son diplôme autour de la figure de Michael Jackson : elle s'était mise en scène dans une sorte de performance très plastique. On a de vraies affinités. Une autre étudiante qui m'a marquée – elle m’avait envoyé une lettre de remerciements en fin de 2eannée, ce qui est assez rare – s'appelle Sophie Kitching [diplômée 2014] c’est aujourd’hui une artiste, très créative ; elle vit à New York. Avec un autre enseignant de scénographie, Quentin Rioual, on est en train de construire un groupe de recherche autour de la scénographie et de l’éco-responsabilité, pour réfléchir aux manières de se positionner comme scénographe aujourd’hui et changer les pratiques dans la scénographie : j’ai invité quelques étudiantes (Charlotte Gautier Van Tour, Louise Douet-Sinenberg, Pia de Compiègne, Georgiana Savuta, Lisa Navarro) que je savais être intéressées et avec lesquelles je suis restée en lien, qui étaient en mesure de dialoguer, dans un rapport égalitaire, avec des professionnels.
Sur ces questions d’écologie, tu as été dès le départ une actrice forte dans l’École. Tu peux peut-être nous en parler ? C’est tout de même un engagement de femmes dans l’École, non ?
C'est vrai que justement, alors que le féminisme n'avait pas eu beaucoup d'écho chez moi, j'ai découvert l'écoféminisme. Tout d'un coup, je me suis sentie complètement en affinité, en compréhension avec cette pensée. Dans notre groupe de recherche actuel sur l’écoscénographie, il y a une majorité de femmes. Il y a beaucoup d'institutions qui se sont jointes à ce groupe de travail. Beaucoup de femmes. C'est impressionnant. C'est criant – on ne peut pas dire que c’est le hasard, ce sont des questions qui sont mieux comprises par les femmes. Et heureusement qu’il y a quelques hommes pour montrer que c'est possible aussi. Pour le manifeste « Pour une pratique soutenable de la création, Manifeste pour un monde durable à l’Ensad – Paris », quand on en a parlé avec Roxane [Jubert, enseignante depuis 1997], j'avais envie d'action. Pour moi, ce manifeste était un outil d’évaluation pour savoir qui à l’École pouvait porter ces questions, qui souhaitait les prendre en charge. Et, ce qui était intéressant, c'était de s’apercevoir que tous les postes de l'École étaient touchés, les assistants techniques comme l’administration étaient très intéressés, et très engagés. Et c'était aussi très féminin.
Tu as senti le soutien de la direction ?
Emmanuel Tibloux a été très enthousiaste et très positif. Il a soutenu notre manifeste et l'a intégré très rapidement au projet de l’École.
Directeurs ou directrice, tu as eu des relations semblables avec les uns ou les autres durant tes années à l’École ?
Je peux parler de Geneviève Gallot [directrice de 2008 à 2013], parce que c'est la seule directrice que j'ai connue. Je n’étais pas dans les instances, donc je n'ai pas mesuré à quel point c'était difficile de dialoguer avec elle – il y a eu cette lettre signée de tous les représentants enseignants (moins un) qui refusaient de siéger au CER [Conseil des Études et de la Recherche] et au CA, c’était très puissant comme revendication et c’était étonnant, finalement, que ce soit à l'encontre d'une femme. C’était une femme et elle se comportait comme un homme, sur le modèle masculin. Peut-être que c'est ce qui n’a pas été supporté, en fait ? Moi, elle m’a surprise. Le soir d’une première, je présentais un spectacle de danse à Beaubourg et je vois Geneviève Gallot dans la salle qui vient voir le spectacle ; c'était quelqu'un d’extrêmement professionnel, qui voulait savoir ce qui se passait dans l'École, ce que les personnes qui y enseignaient faisaient professionnellement. Elle était très, très impliquée. Elle souhaitait participer à toutes les décisions et elle était plutôt autoritaire. Mais elle avait aussi cette qualité de s'intéresser vraiment à ce qui se passait à l’École. Jusqu'à la fin, même si c’était quelqu’un qui imposait ses avis, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement engagé et j’ai toujours ressenti qu’elle le faisait pour le bien de l'École. Je pense que je l'ai appréciée.
Ton engagement écologique, il est lisible dans tes cours ?
Oui, je le transmets, par exemple dans un cours d'initiation à la maquette – je suis au début d'une réflexion sur : comment avoir une nouvelle attention aux choses, comment regarder les matières comme étant des éléments précieux. J'essaie de penser autrement notre rapport au vivant et à la nécessité. J'ai par exemple invité dans ce cours une étudiante qui venait de passer son diplôme, une fille incroyable, qui s'appelle Lucile Cornet-Richard. Je l’ai rencontrée par un hasard total. J’avais vu son installation de diplôme et je lui ai demandé si elle pouvait me présenter son travail. Elle était en Architecture intérieure avec un projet magnifique de diplôme, un modèle de pensée, basée sur la rencontre : elle n'est pas du tout dans la construction mais dans le déplacement des usages, dans des choses très fines – de l'analyse d'espace, des relations avec des collégiens (son projet porte sur le réaménagement d’un collège et sur des changements d’usage). C'est Lucile qui m'a éveillée à l'écoféminisme. C'est passé par une étudiante, c'est génial !
Dans tes cours, tu valorises les autrices et créatrices ?
C’est la prochaine étape… Je commence à mesurer que c'est nécessaire et que c'est anormal qu'on n’apprenne l'histoire de l'art qu’avec des artistes hommes. C’est vrai que pour moi, ça n'était pas un sujet, je ne regarde que le travail… La difficulté, c'est aussi de trouver des modèles féminins avec les mêmes capacités créatives, puisqu'elles ont été un peu mises de côté, elles n’avaient pas les mêmes possibilités pour s’exprimer.
Toi, tu as un enfant, ça a été compliqué de mener tout de front ?
Oui. Au moment où j'ai été enceinte, j'étais dans un grand moment de création, j'étais en train de commencer à construire un spectacle qui prenait un peu d'ampleur et au moment des répétitions, j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai compris que le processus de travail allait être très perturbé par cette naissance. Ça l’a en effet beaucoup perturbé dans le sens où ma grossesse est devenue plus importante que la création de ce spectacle. Faire un enfant, être dans la découverte de cette possibilité, c’est devenu plus central que créer, ça a déporté mon attention. Dans ces moments, ce n'est pas simple de rester connectée avec son travail personnel et son égo car c'est tellement magique, c'est tellement plus fort que tout, la vie en train de se créer, une personne qui est là. Je n’avais plus assez d’énergie pour tout faire. J'ai fait d'autres choses après, mais j'ai bien vu que je me suis déportée sur mon enfant parce que c'était plus puissant que tout. Mais j'ai vu aussi des femmes enceintes capables de répéter sur des plateaux, capables d'emmener leur enfant dans la salle de spectacle pour aller travailler sur le plateau. Ça dépend vraiment des capacités de chacun. Moi, je n’en étais pas capable.
Et l'École te donnait assez d'espace pour toi et ta relation avec ton enfant ?
Oui, car au bout de deux-trois mois de maternage, j'étais très contente de retourner travailler, de revoir les étudiants et de ne pas rester à la maison. Les étudiants, à mon retour, m'ont fait un cadeau de naissance. C'était très touchant – une petite boîte à musique pour mon fils.
Tu l’emmènes à l’École ?
Oui, un tout petit peu à l’occasion des Portes Ouvertes. Il est venu quelquefois. Je me souviens de l'avoir fait manger, d'avoir cherché un micro-ondes pour lui réchauffer son petit pot à deux ans !
Les étudiantes, elles savent que tu es maman ?
J'en parle peu. Le télétravail change les choses – quand mon fils rentre de l’école, il vient se poster devant l’écran et dit bonjour. Et en fait, je vois que ça les touche et les amuse. Mais je n'ai pas envie de me positionner comme mère aux Arts Déco.
Tu leur parles de tes créations ?
Je l'ai fait, au début quand je suis arrivée à l’École, parce que j'avais besoin de me positionner, pour qu’ils comprennent d’où je parle, mais je le fais de moins en moins aujourd’hui parce que j’ai l’impression de me répéter, j'ai presque l'impression parfois de passer un entretien professionnel. Suite à nos débats et aux retours des étudiants sur la pédagogie, nous avons décidé récemment de montrer plus nos travaux et nos créations au sein de l’École car nous avons identifié que nous devions nous positionner comme des professionnels et non uniquement comme des enseignants, et que montrer nos projets pouvait permettre un meilleur dialogue et du partage.

Nathalie Junod Ponsard
ancienne étudiante,
enseignante
depuis 2007
avec
Lucile Encrevé
le 17.11.20

- Épanouissement
- Rôles genrés
- Directrice
- Sororité
- Féminisme
- Concours
- Modèle
- Enfants
- Écoute
- Silence et parole
- Hommage
- Intersectionnalité
Entretien de
Nathalie Junod Ponsard
ancienne étudiante, enseignante depuis 2007
le 17.11.20 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Peux-tu nous présenter ton activité d’enseignement à l’Ensad ?
J’enseigne aux Arts Déco depuis 2007, c’est ma 13eannée d’enseignement. On m’a contactée pour savoir si ça m’intéresserait d’enseigner la lumière et la couleur, effectivement c’est mon domaine, c’est surtout mon médium en tant qu’artiste. De 2000 à 2002, je l’avais déjà enseigné à l’école d’art de Singapour auprès des étudiants de master 5e année. J’enseigne aux Arts Déco quelques heures par semaine car j’ai principalement une activité artistique qui me prend beaucoup et qui est internationale. À ce sujet, il a fallu m’organiser, ça a été possible, j’ai pu déplacer des cours, des workshops, on m’a laissé cette liberté à l’École. Cet enseignement est transversal et également interdisciplinaire, de la première année à la 5e année du Cursus et en Recherche (EnsadLab). J’ai créé à l’École un enseignement de la pratique artistique avec le médium de la lumière (et ses couleurs) basé sur l’expérimentation afin de générer des expressions diverses avec une palette d’outils de la lumière variée dans des espaces choisis, d’appréhender les phénomènes lumineux et ainsi d’aborder la vision dans ses dimensions physiques et perceptives, entre art et sciences, et en appui sur l’histoire de l’art. J’apprends également à savoir regarder, percevoir, savoir lire et observer non seulement la lumière mais notre environnement, en avoir une meilleure acuité, et ainsi le modifier en créant des univers plastiques imaginaires.
Tu es rattachée à un secteur en particulier ?
J’ai enseigné dans de très nombreux secteurs, presque chaque année j’ai découvert un secteur, aussi bien Design textile que Art-Espace, Design objet, Architecture intérieure, Photo/Vidéo, Scénographie, Design graphique… J’enseigne depuis 2007 en 1ereannée et depuis 5 ans je fais partie d’un groupe de recherche à EnsadLab, en co-dirigeant le groupe SAIL et actuellement collaborant au groupe Symbiose. Pendant plusieurs années, j’ai mené des Modules de Recherche et de Création [MRC – projets transversaux sur un semestre] en partenariat avec le Mobilier National que je connais bien, cette institution m’a commandé des œuvres, et pour laquelle j’ai une grande considération. Une des expositions des installations créées par les étudiants dans le cadre du MRC « Corps de lumière, exil » à la Manufacture des Gobelins a été sélectionnée par le commissaire de la Nuit Blanche en 2018. Depuis plusieurs années j’interviens dans un enseignement croisé avec l’école des Mines où se mélangent les ingénieurs et nos élèves. Auparavant, j’ai également organisé des workshops dans des écoles d’art et de design dans différents pays d’Europe et aussi en Inde, avec des étudiants et étudiants-chercheurs de l’École : c’était une très belle expérience, interdisciplinaire et interculturelle. Il m’était important que ces workshops donnent chaque fois lieu à une exposition, in situ, dans des galeries ou des lieux publics.
Dans toutes ces activités, as-tu eu l’impression de vivre une expérience spécifique en tant que femme ?
Je ne sais pas bien comment répondre à cette question. Quand je suis arrivée à l’École, j’ai cru voir de la surprise de la part de certains collègues hommes, étonnés que je puisse enseigner la lumière, en tant qu’artiste c’est pareil, c’est un peu la surprise qu’une femme puisse travailler le médium de la lumière dans des œuvres monumentales, avec la complexité technique qu’on peut imaginer. Il y a eu un peu de méfiance.
Comment tu l’as ressentie ?
Je suis quelqu’un de très intuitif. Sans les mots, je le ressens. Parfois par la jalousie visible dans l’attitude de certains collègues, je dirais. Lorsque je collabore avec des femmes enseignantes elles montrent plus de curiosité envers ce médium.
Tu nous as parlé de rivalité avec un professeur homme…
Tout à fait, un enseignant s’est posé en rival. Étant artiste, j’enseigne la pratique artistique de la lumière à partir d’expérimentations et de créations. Il a essayé de me mettre des bâtons dans les roues en essayant d’occuper les lieux que j’avais réservés pour mon enseignement – pour cela il faut un espace assez grand, où il est possible de faire l’obscurité. Il a essayé de prendre mon matériel pédagogique pendant que je donnais cours, une façon de me couper l’herbe sous les pieds. J’ai maintenu la route et j’ai vu que j’étais soutenue, par certains techniciens, qui appréciaient mon attitude générale, m’ont-ils dit, parce que je respecte les lieux et les personnes. En général j’arrive à résoudre les difficultés sans faire d’esclandre. En tant que femme dans l’École il est vrai que j’obtiens assez rapidement ce dont j’ai besoin pour conduire mon enseignement ; parfois cela agace des collègues hommes. J’ai l’habitude depuis toujours de me débrouiller par moi-même, j’en ai conscience de façon très forte depuis quelques temps, c’est ma force ; de mettre en place des protocoles, des liens sincères avec les autres, des soutiens qui font que ça marche agréablement et de façon respectueuse. En tant que vacataire je ne me sens pas pleinement dans l’École, j’ai l’impression d’être un électron libre, j’ai toujours eu une forme de liberté dans l’école par rapport à mon enseignement, soutenue par certaines personnes comme Vonnik Hertig [enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016], qui dirigeait le méridien Couleur-Lumière-Matière. Vonnik a été l’initiatrice d’un enseignement très porteur pour nous tous et les élèves. C’est une personne de très grande qualité. Et, j’ai été soutenue par la direction. Lorsque Geneviève Gallot [directrice de 2008 à 2013] a pris la direction de l’École, elle m’a tout de suite soutenue dans mes projets de workshops internationaux, notamment dans ce premier workshop que j’ai mené à Helsinki avec la Taik et TeaK (actuellement université Aalto), pour lequel j’avais obtenu un financement du ministère de la Culture, une bourse qui a servi à l’édition d’un catalogue et aux voyages. Elle a tout fait pour que ça se mette en place rapidement, alors qu’avant son arrivée à la direction cela pataugeait, les documents permettant cette collaboration entre les trois écoles d’art n’étaient pas signés. Elle l’a fait très rapidement. Ensuite chaque année j’ai mené un workshop à l’international avec des étudiants et des étudiants-chercheurs de notre école. Quand, à l’École, on a vu que j’avais des projets importants, d’une part de belles commandes publiques de l’état et du ministère de la culture pour des œuvres pérennes et, d’autre part, en plus des workshops internationaux, le projet à l’École de créer un Laboratoire expérimental de lumière avec le soutien d’un mécène (un de mes commanditaires), on a commencé à me demander beaucoup, vraiment beaucoup pour l’École, et j’ai fait comprendre qu’en tant que vacataire ce n’était pas possible. J’ai dit : « Il faudrait me contractualiser, il faudrait un poste ». On m’a répondu qu’il n’y avait pas de poste Lumière. C’était comme si j’avais demandé la lune. C’est surprenant. Il y a quelques années, il y a eu un poste « Couleur » à pourvoir à temps plein mais je n’avais pas envie de changer la nature de mon enseignement.
Tu cites deux femmes qui à des moments t’ont soutenue. Il y a eu de la sororité à l’École ?
Oui, j’en ai l’habitude en tant qu’artiste, je vois bien que quand je rencontre des femmes qui dirigent des institutions elles sont souvent les premières à encourager des femmes artistes dans leurs projets.
Et aujourd’hui ?
Je poursuis mon enseignement tel que je l’ai toujours imaginé depuis le début et en le faisant évoluer. Cette année c’est avec Roxane Jubert [enseignante depuis 1997] que nous avons conduit ensemble le workshop Typo-Lumière pour les élèves de Design graphique, une très belle collaboration. J’essaie le plus possible d’être à l’écoute du monde dans lequel nous vivons, à l’écoute des étudiant·es.
Dans le rapport aux étudiantes, est-ce que tu trouves qu’elles te regardent différemment, est-ce que tu es un modèle en tant que femme ?
Je suis féministe. Aux étudiantes, et surtout en 1ereannée, dans mes échanges avec elles, je leur tiens un discours très féministe en les encourageant dans ce choix qu’elles ont fait de venir à l’École : « Si vous êtes là, il n’y a pas de hasard, vous avez gagné ce concours d’entrée à l’École, c’est un concours très difficile » et je leur dis « Vous êtes plus nombreuses à l’avoir gagné par rapport aux étudiants et ce n’est pas parce que vous êtes plus nombreuses à vous présenter, puisqu’il y a autant de femmes que d’hommes qui s’y présentent». J’avais posé à l’époque la question au directeur des études. Ce sont les femmes qui majoritairement gagnent ce concours, elles y ont réellement leur place. Je leur dis également « Il va falloir poursuivre, ne pas lâcher et je veux, dans dix ans, entendre parler de vous. » C’est le discours que je leur tiens. Les étudiantes sont très intriguées par mon parcours. Je suis une femme, je suis artiste et expose régulièrement à l’international, et je suis mère, j’ai deux filles – certaines étudiantes sont très attachées à ça. Je leur dis : « Si un jour vous êtes mère, il ne faut pas se l’interdire pour des raisons professionnelles, il faut savoir s’organiser et surtout il faut poursuivre et ne pas lâcher ». Ma première grossesse, ça a été quasiment une catastrophe – quand ça a commencé à se voir, on m’a dit « On va vous fiche la paix » -, ma deuxième, je ne me suis pas laissée faire, j’ai maintenu le cap. Il me semble que certains étudiants seraient plus à l’écoute de la parole d’un homme.
Tu le sens comment, cette différence d’écoute.
Je vais le sentir quand il y a des enseignements où nous sommes réunis avec plusieurs professeurs dans un même cours. Certains s’affirment tellement pour en imposer.
C’est en 1ereannée que tu fais des cours à plusieurs ?
Il y a régulièrement des projets collectifs que plusieurs enseignants encadrent. Ils se sont toujours bien comportés. Mis à part que certains tentent de récupérer l’apport des autres enseignants y compris le mien pour leur image auprès de la direction.
Et envers les étudiantes, tu n’as jamais remarqué des phrases un peu limites ?
On me rapporte des choses, mais je n’ai jamais assisté à quoi que ce soit.
Est-ce qu’il y a des lieux qui te paraissent plus accueillants dans l’École en tant que femme ?
Tout d’abord l’accueil de l’école est en effet très accueillant ! Et pour mon enseignement j’atterris souvent dans le studio photo, au -2. C’est là que j’ai été soutenue. Je connais les lieux et les personnes qui y travaillent. Un autre endroit, je citerai notre groupe de recherche Symbiose, un groupe ouvert et multiple, et qui se féminise de plus en plus avec nos trois nouvelles étudiantes-chercheuses cette année !
Quand tu as fait des modules de recherche, c’est avec qui ?
Suivant les années j’ai proposé une collaboration à différents professeurs : Anne Ferrer [enseignante depuis 2003], Roland Schär, Jean-François Fourmond ou Luc Perera étudiant-chercheur dans notre groupe Symbiose, en recherche. À l’international, dans les écoles ou universités d’art, dans le cadre des workshops, je me suis plus souvent retrouvée à travailler en collaboration avec des collègues hommes. Quand il s’agit d’une femme, cela veut dire qu’ils sont deux, qu’elle collabore avec un homme.
Et dans les réunions, ça te pèse ?
J’ai tellement l’habitude. Ça ne me choque plus. Lorsque nous sommes plusieurs, hommes et femmes, je sens bien qu’on laisse aux hommes la parole plus longuement, alors que certaines femmes sont censurées soit totalement soit en partie. Dans des réunions en petit comité, ça a eu lieu avec un ancien directeur des études. Il écoutait moins les femmes.
En leur coupant la parole ?
Oui, on leur coupe la parole et on la donne à un homme. Moi, j’essaie de ne pas lâcher. Je termine le fond de ma pensée, je reprends la parole. Je l’ai évoqué à d’autres enseignantes, qui me l’ont confirmé.
Et Geneviève Gallot, dont tu as parlé, tu as vu sa direction comme positive ?
Vis-à-vis de moi positive au départ. Elle a vu ce que je pouvais apporter. Des projets comme les workshops par exemple, avec des écoles d’art en Europe, étaient soutenus. Mais elle a voulu pour l’école changer les choses très rapidement, en vue d’une école internationalement reconnue, mais pour cela elle voulait aller très vite, ça a été mal perçu.
Et toi comme étudiante, tu étais où ?
J’ai fait les Beaux-Arts à Nantes, le 1ercycle, et puis les Arts Déco, à Paris, à l’époque l’enseignement durait 4 ans. Dans les années 1980. J’étais dans le secteur scénographie, c’était un secteur très ouvert à toutes formes de créations spatiales, de nombreux artistes plasticiens créant des installations sont passés par ce secteur. Avoir suivi des études dans deux écoles différentes m’a beaucoup apporté dans ma pratique, cela a multiplié les approches artistiques.
C’était comment, comme femme ?
J’avais l’impression de me battre tout le temps. Aux Beaux-Arts, pour ma première création, j’ai dû mettre en place un certain nombre d’éléments comme obtenir un espace dans l’école afin de réaliser in situune installation à base de trois médiums dont la lumière (j’ai tout de suite su que c’était ça qui m’intéressait, la lumière). J’ai toujours suivi ma route, solitaire et sans modèle car à l’époque les artistes californiens du Light and Spacen’exposaient pas en Europe, on ne connaissait pas leur travail. C’était difficile. J’avais parfois l’impression de me battre contre vents et marées pour réaliser ce que j’avais en tête et, en même temps, dans ces deux écoles, mes professeurs m’ont soutenue en me permettant l’achat de sources lumineuses diverses ou particulières afin d’expérimenter et créer.
Les profs, ce n’était que des hommes ?
Oui, le corps professoral était très masculin. Plus tard, j’ai retrouvé un ancien professeur qui m’a dit « Mais toi, Nathalie, tu n’en faisais qu’à ta tête, à ta façon ». J’ai été surprise de sa réflexion et me suis souvenue qu’en effet je ne lâchais rien pour réaliser mes installations ou performances dont une à l’Ensad qui avec le recul m’avait paru dangereuse… pour le public venu y assister, mais tout s’était bien passé.
Et des enseignantes dans l’École, tu les repérais ?
Oui, j’ai eu Anne Poirier [enseignante de 1981 à 1984] comme professeure, immédiatement j’ai choisi son cours, et je dois dire que ça a été extraordinaire. Nous étions très nombreux à suivre son module qu’elle encadrait en étant attentive à nos démarches originales, il s’agissait de créer une installation, un dispositif ou un film ou encore de chercher un autre moyen d’expression en lien avec un site que chacun choisissait (en dehors de l’école) et de créer tous médiums confondus. Nous avons appris à faire un repérage personnel de ces lieux, une forme de topographie. Un sentiment de grande liberté et de confiance se dégageait d’elle et dans sa façon d’enseigner. Les notions d’espace, de lieux, de fictions, de métamorphoses et de temporalité se croisaient avec l’organique. Pour la citer : « Vivre dans toutes les dimensions du temps, aussi bien le futur que le passé et le présent ». Cela a été un grand plaisir que de la retrouver lorsque nous exposions ensemble dans l’exposition « Décor et installations » en 2011 invitées par la curatrice et historienne de l’art Françoise Ducros.
Est-ce qu’il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ?
Oui, le fait d’enseigner la lumière, cela signifie ouvrir le champ de la perception, après quelques cours lorsque nous abordons la lumière-couleur je distingue rapidement chez certains étudiants une vision différente de la vision générale. Il y a du daltonisme, des différences de vision de la couleur. On n’est plus dans le sexisme, on est dans la différence. Souvent les étudiants ne souhaitent pas en parler, ils pensent qu’ils ont tout intérêt à le cacher. Ils ont appris à faire comme s’ils voyaient les couleurs normalement, ils créent leur propre protocole pour les nommer, je m’en rends compte assez rapidement. Je préfère au contraire les encourager à travailler en s’appuyant sur leur propre vision. Car ces étudiants qui ont une autre vision et donc une autre perception du monde environnant cela peut être une qualité en soi, ce n’est pas un handicap. Car ils sauront créer pour ceux qui ont cette même façon de percevoir. Parfois il y a deux ou trois élèves dans ce cas dans un seul groupe de vingt. Quand j’ai commencé à enseigner à l’Ensad, il n’y en avait pas. Aujourd’hui, ils ne se censurent pas eux-mêmes et passent le concours d’entrée, c’est bon signe.

Léonore Camus-Govoroff
étudiante
depuis 2016
avec
Alexandra Piat
le 02.04.21

- Contournements
- Engagements
- Représentation
- Discrimination positive
- Féminisme
- Harcèlements
- Inclusion
- Manque de collectif
Entretien de
Léonore Camus-Govoroff
étudiante depuis 2016
le 02.04.21 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Léonore Camus-Govoroff. Souvent, on m’appelle Léo par habitude. On a souvent écorché mon prénom, donc j’ai switché pour Léo et ce prénom masculin me convient aussi. Pour les pronoms, j’utilise elle et ael. Je n’utilise pas trop ael en français, mais c’est la traduction du « they » en anglais. Je suis en cinquième année en Art-espace. Dans mon travail, avant je faisais principalement de la performance et des installations et là, j’ai un peu arrêté la performance. Je pense que c’est aussi venu avec le questionnement autour de mon genre, la manière de montrer mon corps et aussi de réfléchir à l’identité physique qui nous construit et qui n’est pas forcément en accord avec notre genre. J’ai beaucoup moins envie de travailler avec mon corps qu’avant.
Est-ce que spontanément tu as des choses à dire au sujet de ton expérience aux Arts Déco, liée à ton genre ?
Je pense que je me suis moi-même fermée l’accès à des ateliers. Pour plusieurs raisons, notamment parce que je n’avais pas le langage technique, mais aussi parce que je suis perçue comme meuf. J’ai parfois la flemme de devoir bosser avec des mecs, notamment ceux qui ont un statut d’autorité. Cette année je m’en émancipe un peu parce que je veux faire évoluer ma pratique, mais il y a certains endroits où je ne suis pas allée à l’école du fait de savoir que, soit les profs, soit les équipes techniques qui géraient les ateliers, n’étaient pas forcément « girl friendly ». Par exemple, depuis qu’un témoignage avait été partagé à propos d’un technicien, j’ai complètement arrêté d’aller dans cet atelier parce que je ne veux pas bosser avec des gens qui font ça. C’est un peu comme ça que j’ai fait mon parcours à l’Ensad, sans être directement victime de violence. Je pense que j’ai subi du sexisme, mais pour moi, que ce soit à l’école ou en dehors, tant que ça ne touche pas à mon intégrité physique et que ce n’est pas de l’ordre de la violence vraiment conflictuelle, je ne fais plus trop attention, malheureusement.
Si tu ne vas plus dans certains endroits de l’école, est-ce que c’est seulement parce que tu as entendu ces témoignages, ou est-ce que c’est aussi à cause de comportements vis-à-vis de toi, de l’ordre de l’infantilisation, du préjugé sur ton travail, etc. ?
Je ne sais pas si, si mon travail était moins engagé plastiquement, je réagirais et je prévoirais de travailler de la même manière. Mais je n’explique jamais mon sujet de A à Z et toute la partie sémantique. En général, je passe directement aux choses techniques. C’est un peu compliqué parce qu’il y a notamment des ateliers qui sont dangereux si on ne sait pas y travailler, de ce fait, on peut se sentir infantilisé. Je l’ai ressenti dans un atelier et j’y ai plus jamais remis les pieds. Mais d’un autre côté, c’est un atelier où je ne savais pas utiliser les machines. Donc peut-être que ce sont aussi des personnes qui ne sont pas formées à la pédagogie, mais qui ont de très bonnes connaissances techniques. Peut-être qu’il faudrait apprendre à former pédagogiquement de manière générale, le corps enseignant et technique, pour qu’on se sente plus libres et moins infantilisés. Pour qu’on se mette moins de barrières.
Tu dis que ton travail est engagé, est-ce que tu peux en dire plus ?
Oui, sur des questions surtout de féminisme, de bio-politique aussi, ce sont des termes que je mets sur mon travail. L’année dernière, j’ai essayé de parler de questions un peu plus larges, de parler d’écologie, de rapports de domination, que ce soit inter-espèces ou inter-humains. Mais c’est encore un terrain que je maîtrise moins et où je ne me sens pas 100% légitime de parler. Alors que le féminisme j’ai autant mon background de vécu, que mon background plutôt universitaire de lectures, etc. C’est vraiment quelque chose dans lequel je me sens à l’aise. Aujourd’hui, je m’émancipe, ma pensée a évolué. Ce que je suis a évolué donc je tends vers autre chose, mais à tâtons pour l’instant.
Ce travail-là, tu dis que tu ne l’expliques pas forcément de A à Z, pour te protéger j’imagine, est-ce que lorsque tu évoques les sujets de fond qui animent ton travail, les réactions sont négatives ? Ou simplement peu intéressantes peut-être ?
En deuxième année, j’ai fait ma première grosse sculpture qui était vraiment super frontale. C’était un moulage d’un corps de femme crucifié sur une croix en bois accroché en shibari, et ça faisait un pentagramme sur le torse. Bien frontal ! Tu ne peux pas éviter le sujet. J’avais eu des retours de mecs de ma classe, des trucs un peu vaseux, un peu à côté de la plaque qui partaient dans tous les sens. Donc il y a des moments, quand je veux bosser sur un truc précis, technique ou autre, je ne parle pas de ma sémantique. Je fais mon truc et comme ça j’évite de me prendre ce genre de remarques qui ne m’apportent absolument rien, ne sont pas constructives et en plus sont bercées par un petit peu de misogynie pas super agréable. Je fais du zigzag pour aller là où je veux, sans qu’on m’embête.
Est-ce que dans tes cours de manière générale — de création, de théorie, etc. — tu as l’impression que ça manque de représentation de créatrices, de femmes ?
Oui, c’est sûr. Je me souviens d’un cours notamment. Ça vendait trop du rêve sur le papier et finalement, on a passé un semestre à parler que de deux mecs, théoriciens en plus, pas du tout artistes. Je n’étais pas venue pour ça. J’ai aussi suivi un cours sur le cinéma, et là pour le coup je ne me souviens pas non plus avoir entendu le nom d’une réalisatrice.
Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres secteurs, mais en Art-espace ce qui est très bien, c’est qu’en fonction de notre travail personnel, les profs font vraiment un effort pour donner à chaque étudiant ou étudiante des références qui peuvent nourrir son travail. Et maintenant, on a plus de profs femmes que hommes. Enfin, il y a des femmes qui sont misogynes, mais ça va on n'est pas trop mal loti en Art-espace. Il y a un désir de mixer les références et de nous apporter les références les plus complètes. Je me souviens en deuxième année, j’avais demandé à parler avec Catherine Strasser [enseignante depuis 2003] et je lui disais que ça m’embêtait pas mal parce que dans tous les cours d’histoire de l’art que j’avais suivis, autant au lycée que dans mes premières années à l’Ensad, j’avais eu plein de références masculines et que moi-même je connaissais plus de références masculines que féminines. Ça me dérangeait et elle m’a fait une liste d’artistes, d’autrices, etc. Je pense que dans tous les cas, elle l’aurait fait naturellement, mais elles sont assez à l’écoute sur ce dont on a besoin.
Est-ce que tu as l’impression d’avoir subi une sorte de sexisme bienveillant, c’est-à-dire que parce qu’on est une femme, ou parce qu’on est perçue comme telle, on obtient des trucs plus facilement ?
Un genre de discrimination positive ?
Oui, ce qui ne veut pas dire que ce soit agréable, évidemment !
Oui oui ! Il y a des ateliers techniques, quand t’arrives et que t’es une meuf/perçue comme meuf, on te file un peu plus un coup de main que quand t’es un mec. Ça m’est arrivé que je ne touche pas un outil et que tout soit fait pour moi — j’avoue, ça m’arrange parfois parce que le taff est bien fait ! — mais tu vois qu’il y a des mecs qui galèrent un peu plus…
Ça peut être totalement bienveillant. Mais je crois que quand t’es une meuf c’est parfois difficile de savoir si c’est fait parce qu’on pense d’office qu’on ne doit sûrement pas savoir faire, si c’est parce qu’on est dans un rapport de séduction avec toi, ou si c’est fait parce que la personne est juste sympa et qu’elle a envie de te rendre service.
Oui, et c’est cool parce que sur le coup tu es contente, ton truc est super bien fait. Mais tu te dis aussi que t’aurais bien voulu apprendre à le faire. Donc c’est bien tout de suite, mais sur le long terme, un peu moins.
Tu as parlé de l’équipe pédagogique en Art-espace, il y a l’air d’y avoir beaucoup de femmes, est-ce que tu peux parler un peu plus de l’équipe et de l’accompagnement que l’équipe vous apporte ?
Quand je suis rentrée en deuxième année, il y avait trois hommes, deux femmes. Depuis, deux nouvelles profs sont arrivées et l’un des hommes est parti à la retraite, donc la non-parité s’est inversée, on va dire ça comme ça.
Le suivi qu’on a de chaque prof est assez différent. Il y a aussi de la misogynie provenant de femmes. Mais il y a aussi de la bienveillance, je pense notamment au suivi de ma directrice de mémoire. Je ne sais pas à quel moment tu peux définir quelqu’un comme militant ou militante, mais elle est engagée et féministe. Et du coup, avec certains mecs de la classe en troisième année, ça ne passait pas. Mais d’un côté tant mieux. Moi je trouve ça normal que ça ne passe pas avec certains comportements.
Tu as parlé de ton sujet de mémoire, quel était ton sujet ?
Il s’appelle Aucune excuse ne vous sera présentée [fig.37] [dirigé par Kristina Solomoukha, 2020]. Au début, l’idée n’était pas forcément de parler de cinéma. Mais ça faisait trois ans que j’étais à l’Ensad. J’ai choisi mon sujet en début de quatrième année. Ça a été super compliqué. Je ne sais pas si c’est comme ça dans les autres sections, mais dans l’art contemporain, il y a quand même un certain entre soi et c’est un milieu élitiste. D’une certaine manière, on est formés à correspondre à ce milieu. Moi ce truc élitiste, au bout d’un moment, ça me pesait un peu. Il y a cette impression de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais avoir les bonnes références, de ne pas être assez cultivé·e et je me suis dit que je ne voulais pas que ça transparaisse dans mon mémoire. Je voulais parler de ce qu’on appelle la culture populaire. Je voulais vraiment que ce mémoire puisse être lu par quelqu’un qui n’a pas fait d’histoire de l’art, qui n’a pas fait d’études d’art, qui n’est pas forcément cinéphile — je parle vraiment du cinéma de grande distribution — et puisse lire et comprendre. Ça m’arrive encore aujourd’hui de lire des livres que de par mon cursus je suis censé·e comprendre et que je ne comprends pas, je trouve que c’est assez violent. C’est comme ça que je suis arrivée au cinéma. Il y a vraiment cette culture de masse qui est développée, c’est la branche de la culture dont on peut parler avec le plus de monde. Avec la musique, je pense que c’est le cinéma qui fédère le plus.
Bien sûr je voulais aussi parler de féminisme. Le livre d’Iris Brey venait de sortir [Le regard féminin – Une révolution à l’écran, 2020]. Et j’en avais entendu parler, je l’ai lu et je me suis dit que j’allais écrire mon mémoire là-dessus. En parallèle, j’avais lu pas mal de choses avec des chiffres, au moment où le film J’accuse de Polanski était sorti. Ça a fait remonter plein de choses. Avec ma directrice de mémoire, on a décidé de faire un parallèle entre le nombre de femmes travaillant dans l’industrie cinématographique et la représentation des violences sexuelles à l’écran. Dans ma première partie, je montre qu’il y a très peu de femmes qui sont embauchées et qui travaillent, malgré le fait qu’elles soient nombreuses dans les écoles. En parallèle, je montre que dans une grande partie des films où l’équipe est majoritairement masculine, les violences sexuelles sont représentées de manière super « border » et érotisées.
Est-ce que durant ta scolarité aux Arts Déco tu as été témoin ou victime de choses qui se rapportent à des violences sexuelles, au sens très large ? Propos sexistes, gestes déplacés, ou autres.
Il m’est arrivé un truc. Je vais utiliser une expression que je déteste, ce n’était pas méchant. Ce n’était pas méchant parce que j’ai le bagage de ce que j’ai vécu et qu’il y a des choses qui m’atteignent beaucoup moins que la portée de la violence qu’elles pourraient avoir de manière générale. C’était une remarque droit dans les yeux sur le fait que je portais un t-shirt en dentelle et qu’il ne fallait pas s’étonner si on regardait mes seins. Je me suis retrouvée trop gênée à m’excuser de mon t-shirt et à me cacher les seins. C’était de la part de quelqu’un qui est censé nous encadrer. Ça ne m’a pas marquée plus que ça, mais c’est le seul truc que j’ai vécu de ce niveau-là.
Est-ce que tu as d’autres choses à dire sur des sujets que je n’ai pas abordés ?
J’ai bientôt fini l’Ensad donc je pense que ça appartient de manière plus légitime aux personnes qui sont dans l’école. Et j’avoue que moi j’ai un peu envie de larguer l’Ensad une fois que c’est fini. Mais d’un point de vue des nouvelles démarches de l’administration, qui se veut devenir de plus en plus inclusive, j’aimerais savoir si ce sont des vrais choix ou si ce sont des questions politiques. Si les choses vont vraiment être mises en place. Je parlais à une copine en première année qui est racisée [qui appartient à l’un ou plusieurs des groupes sociaux subissant le racisme], elle m’a dit « Le premier jour dans l’auditorium la première chose que j’ai faite, c’est compter les personnes racisées. Je fais ça par habitude. On était peut-être quatre arabes et quatre noirs ». On reçoit des mails, on nous fait signer des chartes, on nous bassine avec l’inclusivité — je ne dis pas que c’est mal, mais pour l’instant… Je sais que c’est quelque chose qui prend du temps à mettre en marche et que le directeur n’est pas là depuis longtemps donc c’est sûr que tout ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut aussi faire changer les mentalités des personnes qui font passer les entretiens, etc. C’est un travail de longue haleine. Je trouve que pour l’instant, la couverture est jolie, mais qu’il faudrait s’attaquer au contenu.
J’en parlais avec mon prof Alain[Declercq], qui lui fait partie du jury de concours depuis longtemps et il me disait que le fait que les jurys de l’année dernière aient eu lieu par visio, ça leur avait permis d’avoir beaucoup plus de mixité. Parce que déjà, il n’y a pas l’obstacle de se déplacer à Paris pendant deux jours, etc. Rien que ça, ça modifiait un peu le type de personnes qui se présentait au concours. C’est peut-être quelque chose vers lequel il faut aller, après, ce n’est pas de notre ressort.
Est-ce que dans l’école tu as ressenti un sentiment de communauté, de sororité ?
Là je suis en cinquième année, je ne connais presque personne parce que l’année dernière, je n’étais pas à l’école de l’année. En Art-espace, on était très peu par promo, jamais plus de huit ou neuf. Je ne sais pas comment ça a évolué maintenant puisque je suis sur la fin, mais on a majoritairement été très soudé·es, notamment avec les personnes de ma classe, même si tu n’as pas d’atomes crochus avec tout le monde. Je me suis vraiment sentie bien, Art-espace c’est comme une espèce de cocon, tu es tout·e seul·e au quatrième étage, tout au fond du couloir. Je me suis sentie bien dans ce cocon et j’ai évolué uniquement dans cet espace.
Après, je ne suis pas allée dans d’autres écoles donc je ne peux pas dire si c’est différent ailleurs, si c’est spécifique à l’Ensad ou si c’est quelque chose de plus global. Mais c’est aussi à double tranchant. D’un côté, il y avait ce cocon. Mais il te coupe complètement de l’extérieur et des autres. Et je me rends compte qu’il y a peut-être un manque de cohésion générale. Il y a toujours quelque chose de l’ordre de « Moi, je fais mon truc. Ça, ou ça ne me gêne pas, ou ça ne m’atteint pas directement, donc je ne vais pas, ne serait-ce que m’y intéresser. ». Je ne sais pas si c’est le fait qu’on soit divisés dans toutes ces sections qui fait qu’il y a moins de mélange et de coordination, mais je pense que c’est peut-être quelque chose qui manque à l’Ensad. Plus de cohésion, je ne sais pas trop.
Est-ce que ton cursus à l’école t’a permis de te sentir plus en confiance, plus forte, plus en capacité ?
J’ai développé des compétences techniques et plein de nourriture intellectuelle. Mais de manière générale, je pense que le système éducatif français, de la maternelle jusqu’au post-bac n’est pas fait pour mettre en confiance les gens. Je sais que j’ai appris plein de choses, que j’ai évolué et que je fais un travail qualitatif, j’espère. Mais je ne dirais pas que l’Ensad m’a appris pleinement à m’affirmer et à affirmer qui je suis ou même à affirmer mon travail. Je pense que c’est aussi un manque de confiance plus général et que ça fait aussi partie de ma personnalité. Je cache très bien mon jeu de grande timide qui a peur de montrer son travail et qui se remet tout le temps en question. Mais, même si je pense que c’est normal de douter avant le diplôme, parfois, dans le discours de certaines personnes de notre équipe pédagogique, j’ai un peu l’impression qu’on nous envoie à l’abattoir plutôt que l’on nous prépare à faire quelque chose de bien dans lequel on doit avoir confiance.
Quel est le sujet de ton diplôme ?
La pièce principale va être une fontaine de décoction de plantes contraceptives et ma salle de diplôme va être aménagée de la même manière que les jardins de cloîtres. C’est le niveau un d’un jeu vidéo. Chaque pièce est un item que tu peux prendre pour partir avec toi et continuer ta vie dans le jeu. En fait, le monde un c’est ma salle de diplôme et c’est un cloître dans lequel vivait une communauté de bonnes sœurs lesbiennes mercenaires qui ont dû l’abandonner. Il y aura des armes, des plantes toxiques, et une fontaine.

Anonyme C
avec
Lucile Encrevé
le 11.03.21

- Déséquilibres
- Enfants
- Sexisme
- Directrice
- Care
- Épanouissement
- Âge
- Hommage
Entretien de
Anonyme C
le 11.03.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Quel est ton parcours ?
Cela fait douze ans que je suis à l'École. J’ai été au service de la communication, où je ne suis plus depuis septembre. Je m'occupais de toute la communication interne, c'est-à-dire de la newsletter, des diffusions sur les écrans d’accueil, des rapports avec les étudiants – tout ce que je recevais (pour les concours liés aux partenariats, les appels à collaboration, les résidences pour des artistes), je le faisais suivre aux élèves. Dans le cadre de la newsletter, je faisais des interviews filmés de jeunes diplômés qui ont une actualité, avec Lydia [Mazars ; responsable de la photothèque et des recherches historiques]. Je m’occupais aussi, et m’occupe toujours, du programme « Égalité des chances » avec la Fondation Culture & Diversité, qui travaille avec nous depuis sept ans, avec des résultats plutôt positifs. Je coordonne également un post-diplôme Artiste Intervenant·e en Milieu Scolaire (AIMS) qui existe depuis 2016 – je travaille notamment avec Joanna Pawelczyk [enseignante depuis 2018]; il est réservé à des jeunes diplômés, des Arts Déco et d’autres établissements, qui interviennent pendant une année scolaire dans une classe. Depuis septembre, tout en gardant des missions de com. interne, je suis plus précisément chargée de tout ce qui est diversité sociale au sein de l’École, qu’on mesure pour une école avec le taux de boursiers, qui ne veut pas forcément dire grand-chose mais est le seul outil dont on dispose. Avec la Fondation, je vais régulièrement dans les lycées partenaires, pour expliquer aux élèves, dès la classe de 1ère, ce qu’est une école d’art, publique, et comment on y entre, pour leur présenter les Arts Déco. Je sélectionne des élèves sur critères sociaux, des jeunes motivés et intéressés. On organise des rencontres avec des professionnels et on leur propose le stage « Égalité des chances », qui a lieu pendant une semaine, organisé à tour de rôles par les structures qui participent (les Arts Déco mais d’autres aussi comme les Beaux-Arts ou la Fémis). On les aide à s’orienter, à passer les concours et on les suit jusqu’à l’insertion professionnelle. J’ai aussi monté un groupe de travail Diversité sociale avec des étudiants et des profs et ça se passe bien.
Les femmes y sont majoritaires ?
Il y a plutôt des femmes. Chez les profs, il y a Anna Bernagozzi [enseignante depuis 2004] mais aussi Nicolas Nemitz, qui m’a toujours aidée sur ces questions (il était mon acolyte pour la fondation Culture & Diversité). Pour toutes mes actions auprès des jeunes, j'aime bien faire venir un étudiant, face à lui c'est plus facile pour des lycéens de se projeter. J’ai constitué mon groupe avec les étudiants qui s’étaient déjà investis, et ce sont toujours les mêmes : beaucoup de femmes, issues de la diversité, qui ont des parcours singuliers. Quant au post-diplôme, j’ai commencé avec un homme et depuis ce ne sont presque que des femmes… Dans les stages, en général, il y a beaucoup plus de filles. Cette année, le stage a eu lieu en visio, avec beaucoup moins de jeunes : j’ai proposé de faire des séances de rattrapage pour ceux qui n’avaient pas été sélectionnés, j’en ai « récupéré » quinze, dont quatorze filles. Je pense que c'est encore très difficile pour les parents de ces enfants d’imaginer qu’ils vont faire des études sans lien direct avec un emploi, donc si c’est la fille à leurs yeux c’est moins grave que si c’est un garçon.
Toi, avant d’être à l’École, que faisais-tu ?
Au départ j’ai fait un Master 1 en Histoire de l'art à la Sorbonne, j’ai travaillé sur le catalogue raisonné d’un peintre, Hector Hanoteau, un paysagiste qui a collaboré avec Gustave Courbet, et après j’ai fait un Master 2 en muséologie à l’École du Louvre, j’y ai fait un mémoire de conservation préventive qui était comme une enquête sur Pierre Skira, un spécialiste du pastel. Ensuite, j'ai travaillé pendant dix ans au musée du Louvre. Je m'occupais d'organiser des parcours de visite pour différents publics. J'ai d'abord travaillé pendant cinq/six ans pour les enfants, on essayait de trouver des nouveaux parcours de visite adaptés à ce public, on a monté des ateliers pédagogiques. Après, j'ai changé de public, dans le même service. Je me suis occupée du public handicapé : les sourds – on faisait des visites en langue des signes -, les aveugles – on a monté un espace tactile, on a organisé des visites le jour de fermeture car la plupart ont des chiens d’aveugle, jour où on organisait aussi des visites pour ceux qui sont en fauteuil roulant pour que ce soit pour eux plus agréable. Ensuite, j'ai eu envie de travailler dans la com., sans avoir fait des études de com. J'ai passé un concours, qui m’a permis de bénéficier de la mobilité interne. J’ai vu qu'il y avait un poste qui se libérait aux Arts Déco. J'ai été embauchée par Vincent Bouvet, qui était à l'époque chef du service de la com. et des éditions. Je me suis formée sur le terrain.
À l’École, est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une expérience spécifique en tant que femme ?
Ce qui a été difficile en tant que femme, c'est d’être une mère de quatre enfants. Je ne le dis pas trop, pour moi ce n'est pas une référence d'avoir quatre enfants. Depuis que je suis aux Arts Déco, je n’ai jamais eu un seul arrêt maladie et même pour mes enfants, je n'ai dû m'arrêter que deux fois parce que, globalement, je n'avais pas envie que mes enfants soient une espèce d'excuse pour ne pas aller bosser ; et puis comme je ne travaille pas le mercredi (et le nombre de fois où on me cale des rendez-vous le mercredi, où on fait des réunions le mercredi, comme si ce n’était pas enregistré !), je me dis, si j’ai un jour d’absence en plus, je serai perdue pour la semaine. J'ai toujours été un peu stressée là-dessus. Donc, aux Arts Déco, c’était vu assez négativement d'avoir quatre enfants et je ne l'ai pas très bien vécu. J'ai eu des réflexions désobligeantes à ce sujet : une fois, on m'a dit : « Tu ne connais pas la contraception ? » ; j’ai trouvé ça un peu raide ; après on m’a dit : « Tu es catho tradi ? » ; quand j’avais annoncé à la RH [responsable des Ressources Humaines] que j'attendais mon quatrième enfant, la réaction avait été : « Quatre enfants ? On ne vous invitera plus nulle part. » ! J’avais trouvé ça dur et cette réflexion m’est vraiment restée en travers de la gorge – je ne l’ai pas comprise. Et ensuite j’ai entendu souvent : « Ah ma pauvre, tu as quatre enfants », même si parfois ça se veut positif : « Oh, comment tu fais avec quatre, moi déjà avec un je ne m’en sors pas ! ». Quand j’ai eu ma quatrième, cela faisait un an que j’étais aux Arts Déco, j’étais hyper gênée, on l’a annoncé à Vincent avec Anne-Sophie [Krebs ; chargée de communication, responsable du développement digital] – parce qu’on est tombé enceintes en même temps et on devait s'arrêter en même temps, à quinze jours près. On était tendues, alors que c’est censé être un « heureux événement » – mais Vincent a été très positif, c’est quelqu’un de bienveillant. Je n’ai jamais voulu que mes enfants soient une source de reproche…
Tu les emmènes à l’École ?
Ils sont tous venus – pour les Portes Ouvertes.
Si l’un d’eux était malade, tu aurais pu l’emmener ?
Pas trop, non. Ce n’est pas forcément lié à l’École, qui est quand même très bienveillante, c’est lié à ma nature (et je me suis un peu détendue avec le temps). Dans le contexte actuel, dans les visios, on voit les hommes avec leurs enfants sur les genoux (hyper sages), pas les femmes. Les hommes sont très à l’aise, tout le monde trouve que c’est hyper mignon, vraiment sexy – une femme, on dira plutôt qu’elle est désorganisée, pas concentrée, pas professionnelle, qu’elle n’a pas su gérer si elle se retrouve derrière son écran avec un enfant dans les bras ; une femme avec un enfant dans une réunion en visio, ça ne passe pas du tout ; donc elle se retient, elle se freine.
Je suis d’accord, je n’ai vu d’enfants qu’avec des hommes (c’est comme un accessoire branché, même si consciemment ça part sans doute d’un bon sentiment), moi je n’ose pas (et mes filles ne sont pas très sages !). Sinon, dans ton contexte de travail, tu as toujours eu le sentiment que l’équilibre hommes/femmes était satisfaisant ?
C'est plutôt féminin au premier étage. Et les rapports y sont assez sains entre les hommes et les femmes, c’est plutôt harmonieux – même s’il y a des propos de certains hommes qui restent quand même limites. À l’École, dans le cadre du concours, en tant que secrétaire de jury, je suis toujours tombée sur des profs qui ont pris la peine de me demander mon avis. Je n’ai jamais été maltraitée. Mais il y a eu quelques fois des réflexions méprisantes sur les candidates type « Oh, celle-là, c’est vraiment la cagole du Sud ». Je pense qu’aujourd’hui il n’y a plus ce genre de réflexions… Quand je suis arrivée, il n’y avait déjà plus de profs qui sortaient avec des élèves… ce qui est tout de même limite incestueux, et qui paraissait normal quelques années auparavant. Dans l’École, la domination elle se porte aussi ailleurs, depuis toujours : l’enseignant est toujours au-dessus de la personne administrative, il est protégé; l’exigence n’est pas la même.
Et longtemps l’administration était féminine, quand les enseignants étaient essentiellement des hommes. Par rapport à tes supérieurs hiérarchiques, il y a une différence quand ce sont des hommes ou des femmes ?
Difficile de dire si c'est lié au caractère ou au sexe. J'ai connu Geneviève Gallot [directrice de 2008 à 2013]. J'étais au garde à vous quand elle rentrait dans mon bureau. Elle n’aimait pas du tout qu’on lui réponde. Avec Marc Partouche [directeur de 2013 à 2018], j’avais un lien assez marrant. J’arrivais toujours la première dans le service et lui venait tous les matins dans le bureau pour discuter, c’était friendly.
C’était donc plus difficile avec la directrice ?
J’ai conscience que ça a été compliqué pour elle (et c’était une bosseuse, qui a fait par ailleurs des choses pour l’École), mais le management, ce n'est pas inné. Il faut savoir faire confiance. Un vrai manager est là pour faire grandir ses équipes, ce qui nécessite du temps.
Toi, depuis le Louvre, tu es dans une démarche d’attention aux autres. Est-ce que tu sens ton investissement comme genré féminin ?
Non, pas forcément. Je vais te donner un exemple contraire, car je travaille beaucoup avec Luc Chopplet, qui est le directeur de la prépa publique des Beaux-Arts, la Via ferrata, c’est un homme extraordinaire qui porte un tel soin aux étudiants issus de la diversité ! Donc, il n’y a pas de règles sur le soin. Après, il y a un terrain familial. Ma mère a toujours fait des trucs pour les autres et nous a montré l’exemple.
Cette attention, tu la sens entre les femmes du 1erétage ?
Non, il n’y a pas de solidarité féminine. Au contraire, je trouve que dans l'École, il y a beaucoup d'aigreur. Souvent chez les femmes. Je pense qu’il y a un problème de management. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé leur place – parce qu’on ne leur a pas donné une bonne place. Il y a beaucoup de rivalités. Chacun aime bien dire que son voisin ne fait rien… c’est hyper courant. Mais dans le service de la com., ça marchait hyper bien, on est copines, on est très proches. C’était un trio qui fonctionnait, aussi bien personnellement que professionnellement : là, il y avait une vraie solidarité. Maintenant, je suis autonome…
Est-ce que tu sens une opposition jeunes/vieilles au 1erétage (parce que beaucoup de gens m’en parlent) ? Vieillir dans l’École, ça a l’air difficile…
Certaines le vivent très mal. Il y a un clivage qui s’installe. Les jeunes qui arrivent se soutiennent (c’est normal) et ne sentent pas forcément très bien accueillis, ce qui accentue la séparation. Il y a des femmes, dans l’École depuis longtemps, qui manquent de reconnaissance, qu’il faudrait mettre plus en valeur en leur trouvant des missions liées à leurs talents.
D’autant plus que ce sont des femmes. Sur certains terrains, les femmes ont vraiment le sentiment de perdre beaucoup en vieillissant, donc il me semble que tu as raison et qu’il faudrait d’autant plus compenser, sur le terrain professionnel, et être extrêmement attentifs. J’ai une dernière question, pour finir : est-ce qu’il y a des femmes qui t’ont inspirée dans l’École ?
Nathalie [Foucher-Battais ; chargée de la communication institutionnelle et événementielle à l’Ensad jusqu’en 2018] m'a beaucoup inspirée. Elle a fait toute sa carrière aux Arts Déco, plus de vingt ans, elle était rentrée comme emploi jeune, comme Anne-Sophie [Krebs]. C'est une fille exceptionnelle. Elle a toujours été très bienveillante avec tout le monde, hyper sérieuse, hyper professionnelle, ça a été mon modèle de femme exemplaire. Dans l'École, il n'y en a pas beaucoup : elle n’était jamais dans le jugement, cherchait le meilleur de tout le monde, en allant jusqu’au bout dans son travail.

Félicie Parent
étudiante
de 2014 à 2019
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 10.11.20

- Rôles genrés
- Résignation
- Malaise
- Contournements
- Injonctions
- Féminisme
- Hommage
- Déconstruction
- Sororité
- Culture féministe
Entretien de
Félicie Parent
étudiante de 2014 à 2019
le 10.11.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je m’appelle Félicie Parent. Je suis rentrée en 2014 en première année après avoir fait une prépa publique. Ensuite, je suis rentrée en Scéno et je suis diplômée depuis 2019. Pendant mon échange à l’étranger je suis partie un an en Israël.
Dans le questionnaire [envoyé dans le cadre du projet Chères toutes] tu parlais d’expériences désagréables en lien avec ton genre. Est-ce que tu as eu le sentiment de ne pas être prise au sérieux de la même manière que les autres parce que tu étais une femme ?
C’est surtout sur le plan physique que ça m’a impactée. Le fait de se sentir de base considérée moins forte dans les ateliers. J’en ai beaucoup souffert parce que j’étais très costaud à l’époque. En Scéno tu passes ta vie à déplacer des projecteurs, à monter des échelles avec des choses lourdes dans les bras, c’est très physique. Je trouvais ça énervant parce qu’à peine tu mettais un pied sur l’échelle qu’on imaginait de toi que tu n’allais pas y arriver. Je pense que c’est l’expérience en atelier qui m’a le plus agacée avant de partir en échange. Pour moi, il y a la période avant mon échange et après mon échange. Mon séjour en Israël a été vraiment hyper politisant. À mon retour, je n’avais pas du tout le même regard. Mes trois premières années aux Arts Déco j’étais moins sensible, j’ai moins regardé ou analysé ce qui se passait.
Tu dirais que quand tu es rentrée, tu avais une sorte de pouvoir supplémentaire parce que tu étais consciente de ce qui se passait autour de toi ?
Oui, j’avais commencé à déconstruire le sujet du genre aussi. J’étais plus sensibilisée, capable d’analyser.
Tout ce que tu as vécu avant ton échange, est-ce que tu en étais consciente ou c’est venu après ?
Je me rendais compte qu’il y avait des choses qui n’allaient pas, mais je ne me rendais pas compte à quel point c’était important. C’était comme si c’était une fatalité : « Voilà, ça se passe comme ça. C’est agaçant. Mais on ne peut rien y faire ». Je me souviens de moments pas cool avec des techniciens d’un atelier. On en parlait, mais on ne se disait pas « Ça ne va pas du tout ». Sinon, je n’ai jamais eu ce rapport-là avec les profs. Je n’ai jamais ressenti un jugement ou être considérée comme moins agile ou moins intelligente parce que je suis une fille.
Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ce qui s’était passé dans cet atelier ?
C’est très vague. Je ne m’en souviens plus très clairement. Je me souviens de l’un d’eux qui était libidineux en général avec des filles. On le retrouvait avec une seule fille dans une pièce ou aussi un copain m’avait dit qu’il était tombé sur lui en train de parler super proche à une fille dans un coin de l’atelier et que c’était un peu bizarre. Tout le monde se demandait un peu ce qui se passait. Il y avait un rapport de séduction avec les filles. Et c’est pour ça qu’on se posait des questions. De mon côté, moi, je n’ai pas vécu ce genre d’histoire.
Comment vous vous sentiez sur votre échelle quand on vous signalait que vous n’alliez pas y arriver ?
J’étais très énervée parce que je suis très à l’aise sur les échelles. J’ai l’impression qu’il y a un truc de pouvoir aussi, et détachée d’un truc sexiste. Comme si choisir quelles actions sont réalisables par qui, permettait de garder le contrôle. C’est quelque chose que j’ai beaucoup moins senti au plateau vidéo, où j’ai fait mon projet de diplôme. Mais sinon il y a plein de moments où j’ai fait des compromis parce que j’ai préféré ne pas rentrer en discussion avec les « techos » [technicien·nes] pour pouvoir faire mon travail. Ça c’est un problème aussi, de décider de ne pas réagir pour pouvoir travailler.
Quand je pense à cette histoire de domination et de pouvoir dans les actions, je pense au fait qu’il y a plein de fois en Scéno, où ils ne voulaient pas qu’on fasse des choses. Ils ne voulaient pas qu’on descende le pont, ils ne voulaient pas qu’on monte à la tour passerelle pour pouvoir accrocher des projecteurs en hauteur. Ils étaient extrêmement contrôlants. Pour des histoires de sécurité.
Est-ce que c’était pareil que vous soyez des filles ou des garçons ?
Oui, je crois. La salle noire elle est blasante parce qu’elle est extra mais qu’on ne peut rien y faire. C’est un grand espace, il y a de la hauteur sous plafond. Peut-être y a-t-il plus de dangers que dans d’autres secteurs ? Si un projecteur te tombe dessus c’est quand même vraiment pas cool. Y travailler est donc engageant : dès que tu veux faire une action, tu dois prendre mille mesures de sécurité.
Quel rapport tu entretenais avec les profs hommes et femmes ? Est-ce qu’il y a une différence dans les relations à eux et elles ?
Alors moi je suis plus proche des profs femmes, puisque c’était aussi les référentes de secteur. J’ai une super connexion avec Élise [Capdenat, enseignante] qui a suivi mon projet de diplôme. Je suis vraiment allée vers elle, et ai pu avoir des attentes envers elle de l’ordre du lien maternel. Un rapport, mère-fille. Je ne sais pas si c’est sain ou pas sain, mais je me suis rendu compte de ça à la fin de l’année. En tout cas, je n’ai jamais senti un déséquilibre par rapport au genre dans mon rapport avec les professeurs. J’ai eu aussi de belles relations avec des profs hommes. Il y a eu parfois des profs femmes avec qui j’ai moins connecté et qui ne sont pas rentrées dans la boucle de mon travail ou autre. Ce n’est pas marqué, ni vraiment réfléchi, mais je dirais que je suis en général plus proche des femmes que des hommes.
Est-ce que tu as ce sentiment de pouvoir te confier ou de pouvoir parler plus librement de ton travail avec elles ?
Non, parce que souvent, ce sont les profs de sciences humaines qui m’ont beaucoup portée. Je pense à Stéphane Degoutin et à Benjamin Delmotte [enseignants] par exemple. J’ai fait souvent appel à eux sur des questions de sciences sociales et de sciences humaines. Ma relation avec Benjamin Delmotte était très importante pour moi, c’était mon directeur de mémoire. Donc je ne dirais pas qu’il y a une distance en plus, parce que c’était un homme, mais le rapport était tout de même différent. En tout cas, je suis sûre que mon rapport est encore différent en fonction de si c’est une femme ou un homme, et que c’est quelque chose que je n’ai pas encore complètement déconstruit. Cela me travaille pas mal. Le fait de changer de comportement ou d’appréhender la personne différemment en fonction de son sexe.
Je fais le parallèle avec des statuts dans le travail, qui sont associés à des classes sociales. Je suis éclairagiste donc je passe ma vie à travailler avec différentes équipes d’électriciens ou de techniciens lumière, et souvent ça me prend la tête ces histoires de distanciation et de différenciation sociale en fonction de si tu es dans l’équipe de conception ou dans l’équipe technique. Ça me touche beaucoup le fait que ce soit aussi cadré et qu’on attende des techniciens d’être un peu « bas de plafond » pour s’occuper uniquement de la partie technique et de ne pas venir participer à la partie « créa » . J’ai l’impression que, en tant que créateur, j’attends que les techniciens avec qui je bosse ne soient pas du même milieu social que moi et n’aient pas les mêmes capacités d’analyse et je trouve ça terrible ! Je m’en veux de penser ça, ça me fait réfléchir, parce que je trouve que les techniciens apportent quelque chose de fabuleux aux projets. C’est vraiment une construction sociale dans mon esprit depuis longtemps, et je me demande si elle n’est pas nourrie à l’école, ce qui m’embêterait sincèrement. Après j’ai aussi une maman qui est danseuse et qui passe sa vie à parler du côté bourrasque des « techos » de théâtre. J’imagine que c’est aussi à cause de ça que j’ai été plus sensible à ce qui se passe en atelier. Je ne suis pas fière de cette réflexion.
C’est vrai que les responsables d’ateliers ne sont pas traités de la même manière que les profs. Que ce soit par les étudiant·es ou par les enseignant·es eux-mêmes. On voit pourtant que sur des projets à long terme comme le diplôme par exemple, ce sont les responsables d’atelier qui sont le plus présent·es pour toi et font avancer ton travail. On pense aussi peut-être qu’avec les profs, comme ils sont considérés comme ayant plus d’autorité sur nous, ils ne se permettront pas certaines choses, alors qu’avec les techniciens, il y a plus de proximité possible.
C’est un préjugé sur le milieu social, cette idée qu’un milieu social n’aurait pas déconstruit le sujet du genre comparé à un autre.
Tu disais que l’école était le lieu où tu étais devenue féministe, est-ce que tu peux en dire plus ?
Je suis sortie avec un garçon de l’école pendant les trois premières années des Arts Déco. C’est un mec formidable mais qui est super macho et qui attendait de moi d’être comme une nana de magazine. Il m’a vraiment foutu la pression pour que je sois hyper belle, que je sois épilée et autres joyeusetés. Notre couple était basé sur un système de représentation, et ça m’a travaillée très fort. Quand on s’est quitté, j’étais en Israël et je me suis rendu compte que cela ne me correspondait pas. En plus de la découverte de la situation politique en Isräel, de l’écriture de mon mémoire qui l’était aussi, j’ai commencé à lire des écrits engagés et à devenir féministe. C’était déjà quelque chose qui commençait à se mettre en place tout doucement chez moi, avant de partir en échange, avec la lecture, par exemple, des Vulvettes Underground[fig.38] [fanzine féministe né aux Arts Déco en 2016, fondé par Bérénice Motais de Narbonne] où différentes personnes à l’école qui étaient féministes, s’étaient rassemblées pour écrire et dessiner. C’est aussi en côtoyant ces personnes-là, que ça a commencé à me titiller. Je pense a une nana de Scéno féministe, plus ancienne que moi qui s’appelle Cléa Arnulf [étudiante de 2010 à 2015] par exemple. Elle fait partie des Tyrassonores, une fanfare féministe qui a commencé aux Arts Déco. Ou bien Irène Iron aussi. Je les ai rencontrées toutes deux par le biais de la fanfare
Ces nanas me paraissaient hyper féministes. Irène, elle joue du suba et c’est presque un acte militant je trouve. Elle joue du suba en talons avec des robes à fleurs et c’est magique. Elle faisait souvent des petites BD qui étaient sur Facebook. Il y avait aussi Claire Duplan qui a publié une BD après sa sortie des Arts Déco. Ça s’appelle Camel Joe et c’est une diplômée d’Image imprimée. Il y avait d’autres gens dont j’ai oublié les noms.
Les Vulvettes Underground, tu en as fait partie ou tu étais juste amie avec elles ?
J’étais juste curieuse. J’allais voir le stand et j’avais acheté leur fanzine. Je parlais un peu avec Cléa qui était très engagée. C’est elle je crois qui a transformé les Tyrassonores en fanfare féministe et qui publiait des rapports sur les femmes qui disparaissent du monde du spectacle à partir de la sortie des études. Des chiffres, des statistiques sur la difficulté d’être une nana dans le monde du spectacle qui m’avaient choquée.
Comment est-ce que la communication était faite dans l’école autour de ce fanzine ? Vous avez parlé du stand, comment est-ce que c’était vendu ?
C’était très ponctuel. Je pense qu’il n’y a eu que deux moments où il y a eu un stand. C’était des filles et il y avait un garçon, un ami de Claire Duplan, si je me souviens bien. Il et elles avaient fait une annonce sur le groupe Facebook de l’Ensad et une page facebook dédiées aux Vulvettes Underground. Je crois qu’il y avait eu un petit marché de Noël aussi. Je ne sais plus exactement si Cléa faisait partie de la rédaction. En tout cas, elle était une image pour moi de personne engagée.
J’ai commencé à me sensibiliser à la question donc pendant que j’étais avec ce garçon. Quand on s’est quitté, c’était un peu une libération. Je me disais « Je ne vais pas m’épiler, je vais commencer à chercher à avoir une autre posture avec mon nouvel amoureux ou avec les gens qui m’entourent. ». Et quand je suis rentrée en France, j’ai emménagé avec une super copine des Arts Déco, une nana qui s’appelle Héloïse Ferlay, qui elle aussi avait commencé à déconstruire le sujet du genre et à devenir féministe. Ça a été vraiment la coloc de la BD engagée. C’était trop bien. Elle m’a fait lire plein de trucs qui étaient très forts. On était dans le quartier de la prostitution à Strasbourg Saint-Denis à Paris et j’ai commencé à vachement réfléchir sur le rapport de séduction qui, pour moi, est super lié aux sujets féministes. Le fait d’être toujours dans un rapport de séduction avec les mecs. Ça a été vraiment le moment clé où j’ai commencé à être très claire sur ce que je voulais, ce qui me rebutait, mes envies de déconstruction du genre, tout ça.
Est-ce que ça s’est ressenti ensuite dans ton travail ?
Au début, quand je suis rentrée d’échange, j’ai voulu faire un projet de diplôme sur le côté genré des produits d’hygiène, des savons, des shampoings. Et après, je suis arrivée dans le quartier de la prostitution et je me suis rendu compte que je trouvais les putes moins aguicheuses que les publicités dans la rue. Je ne comprenais pas que les unes soient interdites et pas les autres. J’ai commencé à faire des recherches là-dessus avec l’aide de Stéphane Degoutin et Benjamin Delmotte et j’ai compris que j’étais en train de parler de l’objectivation du corps en parlant de prostitution, de publicité, du fait d’avoir des injonctions énormes sur le corps de la femme. C’était quelque chose qui tournait déjà en boucle dans ma tête avec les injonctions que j’avais reçues moi-même. C’est devenu le sujet de mon diplôme. Les choses que j’ai écrites à ce moment sont devenues le centre du spectacle.
Est-ce que tu t’es sentie retenue ou plutôt encouragée dans le fait d’aller vers des sujets comme ceux-là, par les profs ?
Les professeurs de sciences humaines m’ont vraiment poussée à aller là-dedans. Au début, j’avais très peur, j’avais l’impression de n’être pas du tout capable de traiter de sujets politiques. Je n’étais pas du tout politisée et, c’est Benjamin, quand j’ai choisi mon sujet de mémoire, qui m’a dit « Mais tu sais, c’est politique, il va falloir que tu fasses une partie là-dessus ! ». Je ne voulais pas et ne pensais pas du tout y arriver. Et puis finalement, tout le mémoire était complètement politique et Benjamin m’a accompagnée. À la rentrée de la cinquième année, pour le diplôme il s’est passé la même chose et Stéphane m’a aussi donné plein de lectures. Stéphane et Benjamin m’ont vraiment soutenue.
J’ai l’impression que pendant la cinquième année j’étais accompagnée comme il le fallait. Mes profs de Scéno me parlaient d’esthétisme et me parlaient des enjeux des espaces que j’étais en train de dessiner et les profs de sciences humaines m’accompagnaient sur le fond. C’était super. J’ai trouvé ça très cohérent.
J’ai eu une prof qui a très mal réagi à mon sujet de diplôme. Quand j’ai présenté mon projet au dernier rendu avant le diplôme, elle m’a dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Que c’était du féminisme des années 60/70 et que j’étais complètement hors de propos et ça avait été un peu dur. Il y a deux profs du secteur avec qui l’échange ne s’est jamais bien passé. Le second prof, à ce même rendu, m’a demandé si j’étais donc en train de les séduire, car j’avais exposé mes recherches sur la séduction et l’image. Peut-être que je m’étais mal expliquée, que ce rendu n’était pas assez précis. Peut-être que ça ne leur parlait pas. J’imagine que j’ai aussi ma part de responsabilité dans cet échange qui n’a pas fonctionné. Sinon, le reste de l’équipe pédagogique était au top.
Tu parlais de sororité [solidarité entre femmes] et d’initiatives féministe qui commencent à émerger à l’école, est-ce que tu peux en dire plus ?
C’est trop bien ce qui se passe depuis deux ou trois ans à l’école. Il y a des propositions de partout, c’est super chouette. Le sentiment de sororité, d’entraide dans la lutte féministe, je l’ai eu avec pas mal de monde. Je pense à ma copine Héloïse, avec qui on s’est vraiment serré les coudes, on s’est beaucoup entraidées dans les lectures, les conseils. C’était comme un soutien de sœurs. Je le ressens aussi quand toi tu écris un mémoire sur le féminisme. Je l’ai aussi beaucoup ressenti quand j’ai recruté une équipe de dix performeurs pour mon projet de diplôme, qui étaient tous des gens qui avaient pas mal déconstruit le sujet du genre. C’était vraiment super d’évoluer avec une équipe comme ça. Je pense aussi à Emmanuelle Sainte Fare Garnot, une prof de perspective en deuxième année Image imprimée et Scéno, avec qui j’ai eu une super relation d’entraide.
Tu parlais beaucoup de livres. Est-ce que tu pourrais nous dire s’il y a un livre ou plusieurs qui t’ont vraiment marquée sur la question du féminisme, du genre, du sexisme, des femmes ?
Celui qui m’a le plus marquée c’est King Kong théorie de Virginie Despentes, bien sûr. Après, il y a une bande dessinée de Aude Picault [ancienne étudiante], que j’aime beaucoup, Idéal Standard, qui m’a beaucoup marquée sur le sujet du couple. Ça parle de genre, mais surtout du couple, du schéma exclusif. Aude Picault c’est une ancienne des Arts Déco, elle fait des bandes dessinées trop bien. Toutes les bandes dessinées de Liv Strömquist aussi. En ce moment je suis en train de lire La rose la plus rouge s’épanouit, et ça me fait trop réfléchir sur cette histoire de rationaliser les sentiments amoureux et donc, de s’empêcher de tomber amoureux. Commando Culotte [de Mirion Malle], Camel Joe… J’avais fait une bibliographie pour mon sujet de diplôme, de tous les bouquins qui m’avaient parlé.
Pourriez-vous revenir sur votre Grand Projet ? Quel était votre sujet précis de diplôme ?
L’objectivation des corps. C’était une performance. J’avais choisi le terme de performance parce que c’est un spectacle qui pouvait prendre place à plusieurs endroits et non pas forcément dans un lieu qui accueille du spectacle. C’est une pièce de vingt minutes avec dix danseurs. [fig.39] Ce qui est intéressant, c’est que ce sont des non-danseurs, des gens qui ne savent pas danser à qui j’ai un peu appris à bouger pour le projet. Le but était de se mettre en scène dans l’espace public principalement, j’avais envie que ce spectacle de danse soit à côté des putes de la rue Saint-Denis. Il y a quatre scénettes qui parlent de l’objectivation des corps et qui s’appuient sur différentes notions pour la montrer. Le rapport à la séduction, cette contradiction entre l’érotisation des publicités et l’interdiction de racoler de la prostitution de rue… Je relie ces choses personnellement à l’objectivation des corps.
Ce sont donc dix non-danseurs qui bougent de manière très simple derrière une vitrine. J’ai construit un décor qui représente une grande vitrine pour les représentations en intérieur, sur scène. Et dans l’espace public ça prend lieu dans un magasin vide proposant une vitrine assez large pour nous accueillir. Dans les deux cas, il y a des interactions entre le devant et l’arrière de la vitre. Le but est de parler de la mise en scène du corps et des injonctions.
Il semble que le féminisme dans votre cas, est passé principalement par les étudiants et les étudiantes, par cette sororité. Est-ce qu’il y a quand même des cours qui vous ont transmis quelque chose autour du genre, du féminisme ?
Ça s’est passé entre étudiants, avec des conseils de lectures de Benjamin. C’est lui qui m’a recommandé Camel Joe par exemple, qui m’a donné le contact de Claire Duplan[fig.40]. Et Stéphane m’a prêté les Liv Strömquist. J’ai l’impression que quand Stéphane me prêtait ses livres, c’était un peu comme si lui aussi, il était en train de chercher sur le sujet et il me les passait parce qu’on en parlait. C’était plutôt du registre de l’échange que du cours.
Sinon, j’ai eu un cours avec Marie Canet sur Playboy qui était hyper féministe. Je pense que c’est le seul cours que j’ai eu dans ces thématiques. Elle faisait un cours sur Playboy, ce que c’était et tous les objets de domination liés à la représentation du playboy et de son inventeur. La suite de ce cours parlait de la maison de cette architecte très connue, Eileen Gray, qui a travaillé autour du système du boudoir. [fig.41] Elle le décrivait comme un acte féministe, permettant un espace de liberté, de cachette, et de réflexion propre aux femmes, un espace équivalent au bureau, mais n’existant pas encore pour les femmes. Elle nous a raconté l’histoire autour du Corbusier qui avait été infâme avec cette femme, qui était devenue lesbienne, et indépendante, ce qu’il n’avait pas supporté. Ce cours était super.
Les profs de théorie comme Marie Canet, sont des profs qui sont très demandés pour les mémoires. C’est un moment assez intime, où tu entretiens des échanges riches avec quelqu’un de manière régulière, et pendant un bon moment. Je trouve que tu crées des liens avec le prof qui te suit, il peut y avoir un peu d’admiration qui se met en place. C’est un peu compliqué de sortir de ça, car ce sont des profs charmants, qui sont des puits de connaissances. J’ai des copines qui n’arrêtaient pas de parler d’à quel point elles étaient amoureuses de certains profs, et je trouve ça chelou.
Ça peut exister avec des profs femmes, on est parfois complètement fascinées par une personne qui est là pour nous donner un savoir. Si cette personne est vraiment sur la même longueur d’onde que nous sur des thèmes intellectuels, c’est très humain d’avoir un attachement.
Complètement ! J’ai l’impression qu’on va vers des gens en général qu’on admire, comme on peut le faire en amour. Mais, je ne peux pas m’empêcher de voir un truc un peu genré dans cette admiration qu’on peut avoir pour certains de nos profs. Je me demande si c’est parce que moi, je suis dans des rapports hyper hétéronormés et que j’ai été éduquée comme ça. Je suis en train de taper sur ce système hétéro en ce moment, mais il y encore plein de choses qui m’habitent et qui sont dures à déconstruire.
C’est peut-être justement très hétéronormé de voir de la séduction là où en fait il y a simplement une connexion intellectuelle et une amitié, entre un prof et une élève.
On est aussi très biaisées par notre regard féministe de rationalisation de tous les rapports de séduction. On se dit « Ah elle a ce rapport-là, parce que c’est un échange avec un homme ». Peut-être qu’on n’aurait pas relevé le truc, si c’était un mec qui disait qu’il était trop amoureux d’une prof.
[fig.41]L’hétéro-normativité, c’est vraiment quelque chose. C’est très récent pour moi de favoriser les filles, c’est à dire de donner plus d’importance aux relations que j’ai avec des filles. Je dis tout cela avec mon prisme de meuf hétéro cisgenre [dont l’identité de genre correspond au genre qu’on lui a assigné à la naissance]. J’ai l’impression d’avoir été éduquée à toujours favoriser les garçons. On m’a tellement appris à être disponible pour les mecs, à les penser prioritaires. Du coup j’ai pu décider par exemple, lors d’une arrivée dans un groupe, une fanfare en l’occurrence, que je n’aurais pas d’histoire d’amour avec des garçons, parce que je ne veux pas rentrer dans un rapport de séduction avec le groupe. Aussi parce que je veux prioriser mes amitiés avec des filles. Je ne veux plus passer à côté d’amitiés parce que ça a soit disant moins d’intérêt qu’une histoire d’amour. Je trouve que Virginie Despentes parle super bien de ça. Dans King Kong théorie, elle va même jusqu’à dire que c’est un système, un cercle vicieux de domination qui fait que les hommes dominent de par ces injonctions sociétales et qu’on nous apprend à les aimer pour cela. On nous met dans la tête en même temps que nous serions faites pour cela. Les mecs sont d’autant plus dominateurs parce qu’eux ne sont pas dans ce rapport-là. Quand tu penses que tu dois séduire l’autre absolument, il a un pouvoir sur toi.
Il y a récemment un livre que j’ai lu, qui parle beaucoup de ça c’est Moi, les hommes, je les déteste, de Pauline Armange. Elle parle de ce choix politique de favoriser les femmes autour de soi, car les hommes sont déjà omniprésents. De développer une vraie sororité aussi.
À l’école est-ce que vous avez entendu des phrases sexistes, qui induisaient des stéréotypes de genre ?
Je pense qu’il y en a eu plein quand j’étais en première, deuxième ou troisième année, mais que je ne les ai pas relevées. En rentrant de mon échange, je me suis positionnée directement dans une recherche féministe par rapport à mes profs. Je pense que grâce à ça, ils faisaient attention, et que donc toute cette année-là, je n’ai rien relevé dans les échanges que j’ai pu avoir avec mes profs. Par contre, j’ai relevé plein de phrases qu’on m’a dites dans ma vie sentimentale, que j’ai utilisées ensuite dans mon projet de diplôme. Par exemple « S’épiler, c’est comme ranger sa chambre quand on reçoit. »…
Est-ce que dans les références qui vous ont été données dans vos différents cours il y avait une majorité ou une totalité d’hommes ?
Sur le sujet féministe principalement que des femmes, Aude Picault, Virginie Despentes, Claire Duplan, Liv Stromquist… Mais quand j’ai écrit mon mémoire sur la file d’attente, j’ai lu pas mal de livres de sociologie, et là il y avait quasiment que des hommes. À part Wendy Brown qui a écrit Murs - Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique et qui était d’ailleurs la référence la plus importante de tout mon mémoire. Mais bon ça a toujours été très présent qu’on ne nous donne que des références d’artistes hommes, parce que ce sont « les seuls qui sont connus », les seuls qui ont eu la place, le temps, la possibilité de faire des choses…

Agnès Krief
chargée d’études
documentaires
jusqu’en 2015
avec
Lucile Encrevé
en 02.21

- Déséquilibres
- Hommage
- Enfants
- Absence de reconnaissance
- Silence et parole
- Agissements sexistes
Questionnaire de
Agnès Krief
chargée d’études documentaires jusqu’en 2015
envoyé en 02.21 avec
Lucile Encrevé
L’interviewée a préféré répondre à l’écrit au questionnaire « test », après longue conversation téléphonique retraçant ses années à l’École avec Lucile Encrevé.
Quelle est votre expérience de l’Ensad ? Est-elle à vos yeux liée à votre genre ?
Retraitée depuis 2015, j’ai occupé la fonction de chargée d’études documentaires à la Bibliothèque de l’Ensad. Je ne pense pas que mon « genre » ait eu une quelconque incidence sur mon parcours professionnel. À noter quand même que la profession de chargée d’études documentaires dans la Fonction publique est essentiellement féminine.
Avez-vous constaté que des secteurs étaient à l’École moins accueillants que d’autres pour vous en tant que femme ou pour les femmes ?
Comme pour l’ensemble de la société française, certains secteurs professionnels à l’Ensad sont « réservés », et les différents corps professionnels manifestement « genrés ».
Portail de la fonction publique 2020 : 62% de femmes parmi les agents. Lesquels, d’ailleurs ?
Ensad à mon départ en 2015 :
- Le personnel administratif : essentiellement féminin. 80% ?
- Le corps professoral : essentiellement masculin. Néanmoins, durant mes dernières années de carrière, le recrutement d’enseignantes se faisait plus fréquent.
- Le corps des techniciens : essentiellement masculin/ beaucoup de métiers manuels pratiqués généralement par des hommes (métal, bois…)/métiers « tissu » (vêtements, tissage… ) généralement pratiqués par des femmes. Stéréotypes qui évoluent ?
- Les élèves : en majorité des filles. Existe-t-il des statistiques ? [En 2020, 64,89 % des étudiant·es sont des étudiantes]
Néanmoins, en ce qui concerne les chefs de services, selon les années, j’ai pu constater un semblant de parité. Les chefs de services changeaient plus fréquemment que le personnel administratif, en place souvent plus longtemps.
Avez-vous le sentiment qu’on attend de vous à l’École un investissement spécifique liés à votre genre ?
Non, jamais.
L’École est-elle un espace qui vous semble différent par rapport au monde extérieur ?
L’École est un espace protégé, mais je ne pense pas que ce soit le fait de la direction. L’École est un microcosme qui fonctionne comme la société française dans son ensemble, dont elle est le parfait reflet, avec ses travers et ses bons côtés. Facteur prépondérant : l’École bénéficie de moyens financiers importants, ça se ressent à tous les niveaux, enseignement, ateliers, locaux, mobilier, voyages d’études etc. dépenses diverses et variées/ gaspillage parfois ! Énorme chance pour les élèves qui bénéficient d’un matériel performant pour travailler, idem pour le personnel / ex : changement fréquent de PC / idem pour les profs / à la bibliothèque nous n’avons jamais fait aucune restriction pour l’achat de livres, revues, vidéos et autres outils de travail.
Et puis le lieu lui-même, l’architecture, la localisation exceptionnelle dans Paris…
J’ai eu des relations conflictuelles avec une supérieure hiérarchique, et des relations un peu tendues avec d’autres femmes chefs de service… beaucoup plus rares avec des hommes, même si c’est arrivé aussi. Banal, banal, quand on s’éternise quelques décennies dans un poste dont l’environnement immédiat est essentiellement féminin. Au quotidien, les hommes Ensadiens se sont toujours comportés avec moi et avec mes collègues proches conformément à la bienséance de rigueur. Je n’ai jamais eu connaissance de dérives, mais je suis consciente que le corps enseignant a toujours cadenassé son espace et qu’il était difficile pour les femmes de faire leur place…
1/ je n’en faisais pas partie, donc ça n’est qu’un ressenti et une observation « à distance ».
2/ les choses, au moment de mon départ, semblaient néanmoins évoluer.
Connaissez-vous des parcours d’anciennes étudiantes, enseignantes, membres du personnel qui vous inspirent ?
Au sein du personnel administratif, celui que je connaissais le mieux, j’ai rencontré beaucoup de femmes intelligentes, ouvertes, travailleuses, discrètes et efficaces, disponibles, toutes dévouées à l’École : Christine Boussat, secrétaire de Direction. Arlette Bérand et beaucoup plus tard Naima Salimi, à l’accueil… solaires, toutes les deux. Arlette Maternatti, chargée des expositions. Brigitte Gomez, qui a longtemps été responsable de la bibliothèque : une personnalité originale, donc déconcertante, une grande amoureuse des livres.
Et la plus extraordinaire qui avait, en plus de ses qualités professionnelles, une dimension humaine peu commune : Madame Rooke qui a été une secrétaire générale atypique, au sens le plus noble du terme. Pour preuve : quand je suis rentrée à l’Ensad, Madame Rooke travaillait avec Michel Tourlière, alors directeur de l’établissement [1971 à 1990]. Tous deux octroyaient à l’ensemble du personnel administratif une demi-journée hebdomadaire de congé. Cadeau idéal pour les mamans, pour régler les problèmes personnels, pour éviter l’absentéisme, pour instaurer une ambiance de confiance, de compréhension, de « prise en compte », réciproques. La plupart des mamans utilisaient cette demi-journée bénie pour s’occuper de leurs enfants, le mercredi ! Ce « cadeau » a été supprimé aux alentours de l’année 1995, je crois, après un « recadrage administratif », sans appel !
Plus tard, j’ai travaillé à la bibliothèque avec Lydia Mazars [responsable de la photothèque et des recherches historiques à la bibliothèque], dont j’ai apprécié le professionnalisme, la grande discrétion, le sens des responsabilités, les qualités humaines. Je suis aussi devenue l’amie d’Isabelle Humbert [responsable de la matériauthèque], dont le dynamisme communicatif est un vrai bonheur. J’ai et je continue à apprécier sa façon de travailler, de s’investir pleinement avec foi, enthousiasme, sérieux et j’admire sa grande curiosité pour tout, de grandes qualités qu’elle met au service de l’École. Question : dans quelle mesure l’École a-t-elle pris et prend-elle en compte, aujourd’hui, tout ce dévouement ?
J’ai suivi, un temps, quelques élèves filles, mais j’ai oublié leurs noms. Force est de constater que je me souviens davantage des garçons, peut-être parce qu’ils étaient moins nombreux… J’ai entretenu de belles relations avec des enseignantes : Miranda Skoulatou [enseignante de 1983 à 2013], Betty Le Guen [enseignante de 1983 aux années 2010], Pascale Gleizes [enseignante de 1972 à 2013], Arlette Ginioux [enseignante de 1994 à 2009]… Toutes avaient une très forte personnalité, pour certaines « volcanique » et c’est ce que j’appréciais chez elles. Je ne pense pas qu’elles aient eu à souffrir de l’environnement masculin à l’École et quand bien même, je pense qu’elles auraient su se défendre avec une énergie farouche !
Vous êtes-vous sentie en minorité dans votre secteur/espace de travail ou lors de réunions/commissions/jurys ? Y a-t-il eu une évolution au cours de votre carrière ?
NON et pour cause ! À l’inverse, l’absence d’hommes dans le domaine de la documentation est certainement dommageable à l’ensemble de la profession. Absence de parité, mais dans l’autre sens. J’espère que les choses changent.
Pensez-vous que travailler dans vos équipes avec d’autres femmes est un atout ? Pourquoi ?
Je n’ai travaillé qu’avec des femmes à la bibliothèque, ce fut globalement enrichissant et parfois étouffant. Nous étions très différentes les unes des autres, tout en ayant un objectif commun : faire de la bibliothèque un lieu privilégié pour l’étude et l’enrichissement culturel, l’ouverture intellectuelle etc. Une belle mission, nous avons bien travaillé dans ce sens et formé, longtemps, une belle équipe solidaire. A une époque, un homme, Jean-Pierre Bouguier, a travaillé avec nous, c’était très « équilibrant », c’était un homme intelligent, très cultivé, respectueux de nous toutes. J’ai conservé avec lui des relations amicales, vingt ans après son départ. Un autre homme a travaillé à la bibliothèque, l’expérience fut différente. Conclusion : tout est relatif à tout ! Il n’y a pas de règle ! C’est l’individu qui compte, pas son genre.
Une direction masculine entraîne-t-elle des relations spécifiques ? L’arrivée de femmes à des postes de direction a-t-elle entraîné des changements pour vous ?
Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de différence entre une femme et un homme à un poste de direction, tout dépend de l’individu qui dirige, avec intelligence ou pas. Si on attend d’une femme un comportement spécifique à son état de femme, on est piégé ! J’avoue l’avoir été, d’où ma déception ! J’ai travaillé, au début de ma carrière, avec un conservateur des Bâtiments de France à Montpellier, c’était un homme délicieux, intelligent, cultivé, humain. On se serait tous damnés pour ne pas le décevoir. J’ai travaillé plus tard avec une conservatrice des Bâtiments de France à Paris, elle était abjecte et faisait régner dans son service une ambiance délétère. J’ai travaillé sous les ordres d’une conservatrice de bibliothèque avec qui je n’ai pas eu de bonnes relations. Mes déboires avec elle, bien que pesants parfois, étaient en fait anecdotiques surtout au regard d’autres univers professionnels, oh combien plus rudes et destructeurs ! Oui, l’École est une espace protégé, très protégé, dans lequel il m’a été possible de me défendre, parfois avec éclats et débordements, sans mettre en danger mon gagne-pain !
À l’Ensad, l’arrivée de femmes à des postes de direction m’a plutôt déçue. [Si on attend d’une femme un comportement spécifique à son état de femme, on est piégé ! J’avoue l’avoir été, d’où ma déception/ je me cite…] Je les ai trouvées plus dures que leurs prédécesseurs hommes, comme si elles avaient la volonté d’effacer toute expression positive de leur féminité. La revanche à prendre était parfois trop évidente. L’effet sur le personnel a été négatif. Je pense en définitive que leur posture tenait plus à leur personnalité, à leur histoire, qu’à leur genre. Quand j’observais le comportement « décevant » de ces femmes aux commandes de l’École, je pensais souvent à Madame Rooke : c’était une femme qui s’imposait avec force, avec une poigne indéniable, mais sans brutalité, qui travaillait avec une énergie positive, sans ménager son dévouement pour l’École. Ce que j’appréciais particulièrement c’est qu’elle connaissait bien « son » personnel, qu’elle respectait, et par-dessus tout qu’elle était honnête, sans condescendance, ni mépris, sans concessions non plus, avec ceux qu’elle administrait. Autant de qualités indispensables dans un « petit » établissement : l’École n’est pas une multinationale où le personnel est noyé dans la masse. Une très belle figure de femme. Je l’ai beaucoup admirée, toujours respectée et beaucoup regrettée, d’autant que celles qui lui ont succédé n’ont malheureusement jamais eu ce profil, loin de là !
Lors des réunions ou de discussions à l’École, votre parole est-elle entendue à l’égal de celle d’un homme ?
Je n’ai jamais eu de problème dans ce domaine, je me suis toujours fait entendre quand j’avais à le faire, gentiment ou brutalement.
Avez-vous déjà eu la sensation que l’on répondait positivement à vos demandes, parce que vous étiez une femme ?
Je ne me suis jamais posé cette question. J’ai eu la chance de voir mes demandes la plupart du temps satisfaites. Dans les meilleurs des cas avec une argumentation solide, dans les pires des cas en élaborant une stratégie de combat ! Quoiqu’il en soit, je suis presque toujours arrivée à obtenir ce qui me semblait nécessaire pour un meilleur fonctionnement du service, donc pour l’École… en toute humilité.
Les étudiant·es vous considèrent-ils/elles à l’égal d’un homme ?
Je n’ai jamais senti de différences dans leurs comportements. Mes relations avec les élèves ont été bonnes, sans discrimination, de part et d’autre. Ma démarche était de satisfaire au mieux leurs demandes, le fond et la finalité de ma fonction.
Avez-vous été victime à l’École d’un sexisme bienveillant ?
Non, je n’ai eu à subir ni sexisme, ni bienveillance genrée.
Avez-vous été l’objet de remarques sexistes ou de traits d’humour déplacés liés à votre genre ?
Ça m’est arrivé. Ma réaction, foudroyante et sans ambiguïté, a réglé instantanément le dérapage. À part ces anicroches qui ne m’ont pas perturbée, les hommes que j’ai rencontrés à l’Ensad, administratifs à tous niveaux hiérarchiques, enseignants, élèves, se sont toujours comportés « normalement » avec moi, une « norme » plutôt respectueuse, souvent amicale.
Avez-vous été victime au sein de l’École d’agressions liées à votre genre ?
Jamais au grand jamais !

Florence Miailhe
ancienne étudiante,
enseignante
de 2001 à 2016
avec
Lucile Encrevé
le 08.02.21

- Déséquilibres
- Sexisme
- Vacataire
- Mandarinat
- Dévalorisation
- Relation aux étudiant·es
- Silence et parole
- Hommage
- Aura masculine
- Modèle
- Âge
- Féministe
- Histoire des créatrices
Entretien de
Florence Miailhe
ancienne étudiante,
enseignante de 2001 à 2016
le 08.02.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Vous avez d’abord été étudiante à l’École, je crois ?
Oui, je suis entrée à l’École en 1976 et j’en suis sortie en en 1980 avec un diplôme en spécialisation gravure.
Vous vous souvenez de professeures femmes ?
Je crois que je n’ai eu qu’une femme comme enseignante, Béatrice Saalburg [fig.42] [enseignante de 1969 à 1998]. Elle était formidable. Il y avait certes des femmes à l'École, mais presque exclusivement dans les sections mode et textile.
Vous n’avez jamais été témoin ou victime d’actes sexistes comme étudiante ?
Non, jamais aux Arts Déco. On entendait parler d’enseignants qui sortaient avec des élèves, mais à l’époque ça ne choquait pas vraiment. Par contre des « blagues » sur les filles qui étaient rentrées parce qu’elles étaient jolies ou bien foutues, oui.
Vous vous sentiez comment dans l’École ?
Bien. J’ai même été déléguée des élèves avec une autre fille, très active. Moi, j'étais un petit peu en retrait, un peu timide. J’étais assez naïve. On avait du mal à comprendre les enjeux politiques et les batailles de pouvoir qui se jouaient au sein de l’École. Sinon, je me souviens qu’on avait pu assister au concours d'entrée aux Arts Déco en tant qu'observateurs et observatrices, c'était vraiment intéressant.
Puis vous êtes revenue à l’École comme enseignante…
Je suis rentrée en 2001 à 45 ans et j'y suis restée quinze ans.
Vacataire pendant quinze ans ?
Oui, mais je ne pense pas être restée vacataire parce que j'étais une femme. L’École a bien dérapé sur le sujet des vacataires : je n'étais pas la seule et on a été nombreux et nombreuses à être resté·es vacataires beaucoup trop longtemps. Peut-être qu’on n’aurait jamais osé proposer un statut de vacataire à un homme avec le même type d’expérience dans le métier, et sans doute qu’il ne l’aurait pas accepté. C’est peut-être le fameux plafond de verre qui fait que des femmes se sentent illégitimes sur certains postes. D’un autre côté, aucun poste n’avait été ouvert dans le département animation qui à l’époque n’était pas très bien vu. C’était vacataire ou rien.
Vous étiez enseignante en quelles années ?
En deuxième année d'animation. Quand je suis entrée à l’École, le cursus durait quatre ans, dont deux ans d'enseignement général et deux ans de spécialisation. Au début, j’enseignais l’option animation aux élèves de 1ereet 2eannées, une matinée par semaine. Sébastien Laudenbach et moi avons intégré la section animation quand les études à l’École sont passées à cinq ans dont quatre de spécialisation : il fallait des enseignants pour la deuxième année.
Il y avait un équilibre hommes/femmes en animation ?
Non, pas du tout, il n’y avait que Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015]. Ils essaient de se rattraper aujourd’hui. Depuis mon départ, trois femmes sont entrées dans l’équipe. Ça n’en fait jamais qu’une de plus… À l'époque, c’était François Darrasse, que je connaissais bien, qui m’avait proposée, en disant que ce serait bien d’intégrer une femme. J’ai été prise en discrimination positive, ce qui ne me fait pas très plaisir. Comme ce choix n’avait pas fait l’unanimité, ils ont pris deux personnes en même temps, Sébastien, qui venait à peine de sortir des Arts Déco, et moi, qui avais quinze ans de carrière en tant que réalisatrice et des films reconnus dans le milieu du cinéma d’animation.
Et ça, ça peut être compris comme une réaction quand même sexiste, cette impossibilité de prendre une femme sans compenser en prenant un homme en même temps.
C’est toujours difficile à dire. C’est pour ça que j’ai hésité à répondre à votre demande d’entretien : je n’aime pas me retrouver dans la position de prétendre que j’aurais pu mériter mieux. Et puis, je suis très contente que Sébastien ait été pris en même temps que moi, on a fait un binôme super pendant toutes ces années. J’ai beaucoup aimé travailler avec lui.
Et au final, c’est lui qui est toujours à l’École, avec un contrat.
Quand il y a eu une première ouverture de poste contractuel, personne ne m’a dit que je pouvais postuler pour un mi-temps. Cela représentait six heures de travail que je faisais largement en tant que vacataire sans compter les heures supplémentaires non payées. Je ne pouvais pas réserver plus de temps à l’enseignement pour pouvoir me consacrer à mon travail de réalisatrice. Du coup, Sébastien s’est présenté seul. Il n’a pas été retenu et le poste d’animation n’a pas été pourvu. Quand Fabienne a pris sa retraite, il y a eu une autre ouverture de poste. Les enseignants de la section ont proposé deux postes à mi-temps à François Colou et François Vogel, avec, comme critères, les compétences de Fabienne (l’apprentissage des différents outils numériques). J’ai eu l’impression que Sébastien et moi avions été un peu oubliés alors que nous étions responsables du programme pédagogique de la deuxième année. Un peu pour montrer l'absurdité des choses, nous avons présenté notre candidature sachant qu'effectivement, nous ne correspondions pas au profil demandé. Nous n’avons bien sûr pas été pris. C'était la fin de l’année et je me suis dit : « Je n'y retourne pas, c'est trop ». Je l’ai annoncé au dernier moment. Et je me suis rendu compte qu'en étant vacataire, on n’était rien du tout. En dehors même de ce statut très désavantageux, ça faisait quinze ans que je travaillais aux Arts Déco et personne, au niveau de l’administration, ne m'a dit « Merci » ou « On est désolé que tu partes ». J'aurais bien aimé pouvoir claquer la porte, mais il n'y avait pas de porte à claquer.
C’était un geste, quand même.
Oui, mais il n’avait aucune importance. Ce n’était même pas une démission. Tu ne renouvelles pas ton contrat de vacataire, c'est tout.
Dans le secteur, ils ont réagi comment ?
Ils étaient embêtés.
Vous aviez quelle place dans l’équipe ?
La section a été créée par un enseignant et il la considérait un peu comme son bébé. C’était assez dur de changer ce qu’il avait mis en place. Je crois qu’il avait peur que ça lui échappe. Il avait déjà son programme établi sur les troisième et quatrième années. C’est pour cela qu’avec Sébastien, on a été très longtemps cantonné à la deuxième année. Là on pouvait faire ce qu’on voulait comme programme. Mais on était obligé d’avoir un programme pour « débutants », et seulement sur une journée par semaine. Alors que j’aurais aimé avoir des cours plus directement liés à mes compétences de réalisation et d’animation directe. C’est très tardivement que Sébastien et moi avons pu avoir deux élèves chaque année dans le cadre du Grand Projet de 5e année. C’est longtemps resté un domaine réservé. J’ai l’impression que les élèves le ressentaient comme ça : il y avait les grands profs et les deux petits profs, un peu à côté.
Dans le cadre des Grands Projets, vous établissiez, en tant que femme, une relation particulière avec les étudiantes ?
Je crois que oui. J’ai suivi plusieurs Grands Projets d’étudiantes dont celui de Marion Lacourt [diplômée en 2013, illustratrice, graveuse et réalisatrice de films d’animation ; son film Moutons, Loup & Tasse de Thé… a reçu le Prix Émile Reynaud 2019 et elle enseigne aujourd’hui à l’Ensad]; celui d’Angèle Chiodo [diplômée en 2011, doublement primée par le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand pour son film La Sole, entre l’eau et le sable, 2012, membre du collectif Babouchka]; ou de Dahee Jeong [diplômée en 2012, elle a reçu notamment le Cristal du court métrage à Annecy en 2014 pour Man on the Chairet le prix Emile Reynaud 2016 pour son film La Chambre vide]. Dahee dort chez moi quand elle passe à Paris et je partage mon atelier avec Marion Lacourt. Les étudiantes sont souvent plus réceptives aux critiques et aux suggestions que l’on peut leur faire. J’ai plus suivi de projets de filles. Je me sentais sans doute plus proche de leur univers. Suivre un Grand Projet crée des liens assez forts, parce que, la plupart du temps, les élèves parlent d’eux-mêmes dans leurs films. Il faut faire attention à ne pas créer par procuration. Le suivi des grands projets est un lieu de pouvoir, et d’influence gardé vraiment jalousement. Je ne sais pas si c'est un truc d'hommes. Peut-être. De mon côté, j’essaie de ne pas changer le projet en fonction de ce que j'ai dans la tête, j’essaie de me mettre à la place de l'élève et de faire en sorte que ce qu'il ou elle veut faire soit le mieux possible par rapport à là où lui ou elle se trouve. Et je vais essayer de ne pas pousser les choses vers ma propre conception de l'animation ou vers ma propre conception d'une histoire. On ne réussit pas toujours. Mais comme on travaillait toujours à deux enseignant·es, on essayait d’équilibrer.
Dans les réunions de secteur, vous étiez écoutée ?
Dans l’ensemble, oui. J’essaie même peut être un peu trop d’imposer mes idées. On a eu des discussions assez vives. C’est parfois difficile d'avoir le ton juste, savoir écouter et se faire entendre sans élever la voix; rester dans la mesure. J’ai l’impression que c’est d’autant plus dur en tant que femme.
Mais en tous cas vous vous y sentiez légitime grâce à vos films ?
Oui, je me suis sentie légitime parce que j'avais déjà une carrière professionnelle importante. J’avais fait la preuve de mes compétences par mon parcours. J'avais déjà réalisé cinq films [les courts-métrages Hammam, Schéhérazade, Histoire d’un prince devenu borgne et mendiant, Au premier dimanche d’août et Conte de quartier]. Ma mère aussi a été aussi enseignante à l’Ensad [Mireille Miailhe, enseignante de 1980 à 1986]. Pour la génération d'avant, cette question de la légitimité pour une femme était encore plus difficile, surtout que Mireille était autodidacte. Elle est entrée aux Arts Déco en toute fin de carrière. Elle avait presque 60 ans et l’impression qu’elle pouvait transmettre un petit quelque chose de ce qu’elle avait compris du dessin et de la peinture. Elle a eu Françoise Roy comme étudiante [étudiante de 1979 à 1983 ; enseignante depuis 1989; elle a dit au sujet de Mireille Miailhe dans une conversation téléphonique avec L. Encrevé le 20 mars : « Elle m'a beaucoup appris. Je l'aimais beaucoup. Elle m'avait invitée chez elle à prendre le thé, elle nous a montré ses dessins. On était épaté]. Mireille était enseignante en dessin artistique, sans doute parmi les premières à l’Ensad.
Comme femme, dans les champs du dessin et de la peinture, une des premières en effet (en peinture, il y a eu Pascale Gleizes dès 1972).
Je trouve que l’École ne met pas assez en avant les femmes enseignantes ni leur travail. C’est dommage. Ma mère a été une résistante, une militante, avec une œuvre impressionnante, c’était une peintre très douée, elle a un dessin magnifique. En 1952 elle est partie faire un reportage dessiné en Algérie pour dénoncer la colonisation. Elle était avec Boris Taslitzky. C’est lui entre autres qui l’a fait « entrer » à l’École. Ce serait bien de faire une conférence sur son parcours.
Comme enseignante, vous avez senti que c’était difficile pour les étudiantes d’avoir si peu de femmes face à elles ? Parce qu’elles le disent aujourd’hui…
C’est assez récent. J’ai rarement entendu les étudiantes se plaindre d’avoir des hommes enseignants et pas assez de femmes. L’admiration pour les « maîtres », c'est rarement sur les femmes que ça se porte. Peut-être parce qu’il n’y en a pas encore assez. Mais ça change. Les jeunes femmes sont beaucoup plus conscientes aujourd’hui de la façon dont les hommes peuvent prendre le pouvoir sur elles, intellectuellement. Je ne sais pas si dans la section animation elles appréciaient d’avoir mon regard de femme réalisatrice sur leur travail. Si elles sentaient la différence. Il faudrait leur demander… Par contre, en tant que prof femme, face à certains garçons, dès qu’on parle technique, ils ne nous écoutent pas, ils ne croient pas ce qu'on leur dit, alors qu’il y a un tas de choses qu’ils ne savent pas. On est nombreuses à ressentir dans le cadre de notre travail le même type de comportements de techniciens qui se croient obligés de nous expliquer de façon un peu condescendante des choses que l’on connait très bien.
Pour les étudiantes, vous avez pu être un modèle ?
Peut-être, oui, je ne me rends pas bien compte. Il y a beaucoup d'élèves, filles et garçons mais surtout des filles, avec qui je suis toujours en contact. Il y en a qui ont été stagiair·es, assistant·es ou que j’ai fait travailler sur mon long métrage, comme Agnès Patron [diplômée en 2011, elle vient de recevoir le César du meilleur court-métrage d'animation 2021 pour son film L’Heure de l’ours] ou Aurore Peuffier [diplômée 2015, réalisatrice et animatrice]. J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ont pu être inspirées par un travail comme le mien. Des élèves me demandent comment on fait quand on est une femme et qu'on a des enfants. Je pense que c'est important de montrer qu'on y arrive – j’ai accouché de ma fille au moment de la sortie de mon premier film ; c'est du concret.
À l’École, les étudiant·es attendaient de vous quelque chose de maternel ?
Le côté mère un petit peu. Mes enfants grandissaient en même temps que les élèves. Quand j'ai commencé à enseigner en 2001, mes enfants avaient dix et quinze ans. Et puis après, ils avaient l'âge de mes étudiants, puis ils ont été plus âgés qu’eux. Il y a le problème du vieillissement des femmes. À un moment, on vous considère facilement comme dépassée. En tant que femme, on passe facilement d’objet de désir à mère et grand-mère. Les hommes, eux, restent des hommes.
Vous leur parliez de votre travail, aux étudiant·es ?
Rarement. Je ne me sentais pas très à l’aise à mettre en avant mon propre travail. Et en fait, j'ai un peu regretté que les autres profs en parlent peu de leur côté.
Votre travail, que je vois comme hyper tactile, vous le considérez comme genré ?
Il est très féministe – je le pense, en tous cas. Genré ? C'est bizarre comme les choses changent… À mon époque, certaines réalisatrices disaient : « On fait des films, on ne fait pas des films de femmes ». Mais ça me semble évident que la plupart des réalisatrices ont une façon différente d’aborder certains thèmes, comme par exemple, le corps ou l’intimité.
Quand vous dites féministe pour votre travail, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Je n’essaie pas de faire des films militants. Je ne me dis pas : « je vais faire un film qui traduise une expérience de femme ». Mais le « militantisme » est là, à l’arrière-plan. En faisant Hammam, je voulais parler des corps des femmes : des corps gros, maigres, vieux…; en parler d’une manière différente de la représentation qui passe par les affiches, les journaux, les publicités. Le film nous fait entrer dans l'intimité du hammam et dans une certaine intimité des femmes. C’est un regard de femme sur d’autres femmes. Sans jugement de valeur. Un homme n'aurait pas pu faire un film sur le hammam comme le mien. Dans Schéhérazade [1995], je voulais raconter l’histoire d'une femme qui risque sa vie pour sauver ses compagnes, d’une héroïne, qui, par ses récits, arrive à sauver le monde. En Égypte les frères musulmans brulaient les exemplaires originaux des Mille et une nuits. C’est aussi à sa manière un film militant.
Et votre film qui va sortir, lié aux migrants, La Traversée ?
Je voulais faire un film sur les migrations. J'ai commencé à travailler sur ce film il y a douze ans. Je viens d’une famille juive qui a fui Odessa en 1905, au moment des pogroms en Ukraine. Mes arrières grands-parents ont traversé toute l'Europe pour arriver en France avec neuf enfants. En 39-40 ma mère, de cette même famille, est partie de Paris pour gagner la zone libre avec son frère ; elle avait dix-huit ans. Elle passait son temps à dessiner ce qu’elle voyait autour d'elle. J’avais envie de coupler mes histoires familiales avec les histoires actuelles de migration ; raconter un « conte migratoire » intemporel. J’ai écrit le scénario avec Marie Desplechin. C'est le récit d’une sœur et d’un frère qui sont obligés de quitter leur famille pour tenter de gagner un pays plus clément. C’est aussi une histoire de transmission. Comme ma mère, la jeune fille dessine et c’est son carnet de croquis qui rythme le récit. Pour faire le carnet de Kyona, l’héroïne, je me suis servie des dessins que ma mère faisait entre quinze et vingt ans.
Elle s’en est sortie, votre famille ?
Oui, ils ont eu de la chance. Ma mère était assez militante et elle s’est tout de suite rendu compte qu'il fallait partir et ne pas porter l'étoile jaune. Elle a convaincu ses parents de ne pas aller se faire recenser en tant que juifs et de gagner la zone libre. Ma mère a rencontré mon père, qui était un militant communiste et l’un des responsables de la Résistance à Toulouse avec Jean-Pierre Vernant.
Vous dites que votre film est une histoire de transmission. Sur cette question, par rapport aux étudiantes, est-ce que vous avez été attentive à leur parler d’autres créatrices ?
Non, pas spécialement. Je n’ai pas mis forcément en avant le côté « femme artiste ». Mais je devais certainement en parler parce que moi, un de mes grands modèles, c'est Caroline Leaf, une réalisatrice québécoise que j'adore. C'est elle qui m'a donné envie, entre autres, de faire de l'animation. Je l’ai rencontrée et j’ai pu lui dire qu’elle avait été un modèle pour moi; et de temps en temps je rencontre de jeunes réalisatrices qui me disent que mes films les ont motivées pour commencer l’animation.

Anonyme E
avec
Lucile Encrevé
le 05.02.21

- Épanouissement
- Écoféminisme
- Agissements sexistes
- Enfants
- Relation aux étudiant·es
Entretien de
Anonyme E
le 05.02.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Peux-tu pour commencer nous présenter ton parcours ?
Je suis italienne, de Bologne, et je suis à l’École depuis 16 ans. J’ai une formation assez atypique, par rapport aux autres profs de Sciences-Humaines : j’ai étudié la traduction, en Italie, et, par la suite, en Allemagne, la sémiologie. Qu’est-ce que c’est un designer aujourd’hui si ce n’est pas un interprète de notre société ? En Allemagne, j’ai commencé à travailler pour des sociologues-futurologues, ce que j’ai continué à faire quand je suis arrivée en France. Je suis rentrée dans le design par cette approche sociologique ; par mes intérêts aussi, que j’avais développés pendant mes études où j’avais traduit deux livres qui parlaient de questions éminemment contemporaines – les conséquences sociologiques de la déforestation d’un côté et, de l’autre, les conséquences de la gentrification accrue dans les villes. Des journaux m’ont demandé d’écrire sur le design. Je me suis mise à travailler principalement comme journaliste et comme consultante. Des écoles, comme l’école d’Art et de Design de Reims, m’avaient appelée pour donner des cours de prospective dans le Design. Un de mes clients était un ancien élève des Arts Déco, école que je ne connaissais pas, et m’a dit qu’on cherchait quelqu’un en Design industriel.
Tu as passé un concours ?
Oui. Le directeur de l’époque de la section de Design industriel était un Allemand qui venait de l’École d’Ulm. Je pense qu’il s’est battu pour que ce soit moi qui ait la place. Mon fils avait un an, je me suis dit que c’était quelque chose de sûr. Ensuite j’ai vraiment découvert l’enseignement, la relation avec les étudiants : et je suis toujours aussi passionnée, c’est toujours comme si c’était le premier jour (ça me permet d’aller au-delà de tout).
Quand tu es arrivée, tu étais la seule femme de ce secteur ?
Il y avait une autre femme qui était coloriste, qui s’occupait vraiment de la théorie de la couleur, Martine Duris [enseignante de 1980 à 2006]. Elle était super, on avait de très beaux échanges. Après, j’ai suggéré, avec un collègue, que Florence [Doléac ; enseignante depuis 2005] arrive, peu de temps après – on échange beaucoup, c’est une artiste, elle est très généreuse. En Design industriel, il y avait deux-trois personnes assez étranges mais après, Design industriel et mobilier ont fusionné pour former Design objet. Comme femmes, il y a eu aussi Agnès [Audras ; enseignante depuis 2000] et puis Vonnik Hertig [enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016] qui sont intervenues. Mais je ne regardais pas ces questions-là, je ne vois pas la différence de sexe : je vois des êtres humains. Mais bien sûr c’était assez masculin comme environnement, au départ, le Design industriel. Il y a quelque chose de masculin dans la vitesse, dans la volonté d’imposer des formes, dans la vision fonctionnaliste du Design. J’essaie d’apporter une autre vision, plus globale, un regard différent et ouvert. En Design, pour moi, les questions de l’empathie, de la générosité et de l’humilité sont fondamentales. Il s’agit d’inviter à ressentir la vision de l’autre. Bruno Munari disait que le designer c’est celui qui arrive à regarder le monde avec les lunettes de son voisin. On fait pour les autres.
C’est toujours présent dans tes recherches actuelles.
Oui, là je prépare l’expo « Infinite Creativity for a finite world », c’est l’acte final du projet européen dont je m’occupe depuis quatre ans [« From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture » (EU 4Cs), développé dans le cadre de Creative Europe, le programme de l’Union Européenne en soutien à la culture et à l’audiovisuel], un éloge de la diversité par la pratique du design et principalement de l’écodesign, projet qui n’est pas assez valorisé alors qu’il est vraiment au service des étudiants – l’important pour moi, c’est que les élèves puissent y participer, je l’ai traduit par un MRC [Module de Recherche et de Création] et cette année je l’ai transformé en quatre Studios, il y a Alexia [Venot ; diplômée Design textile matière 2017] qui porte un studio sur le vivant et la ville avec un background écoféministe. Le design pour l’innovation sociale, il a toujours été forcément accompagné d’une approche durable.
Sur ces sujets, tu te sens écoutée ?
Écoutée, oui, mais comprise, peut-être pas complètement, parce que j’arrive avec un regard différent, ouvert, peut-être pas assez direct, ciblé et dans le contrôle. Ma façon de voir les choses est très rhizomique, je sens que parfois c’est incompris. Voir les choses dans leur globalité, il me semble que c’est féminin.
Tu as ressenti du sexisme ?
Je ne l’ai pas pris comme ça, encore une fois ça n’est pas une question de sexe, il s’agit d’un comportement paternaliste, hiérarchique, parfois exprimé devant les étudiants de façon très violente, ça, ça a pu me blesser. Ma grande capacité pour l’oubli me permet de rester toujours positive et confiante. Tu es aussi un peu comme ça, je crois. Bien évidemment, il y a des situations qui sont plus complexes. Je les vois, je les évite.
C’était plus fort avant ?
Il y avait plein d’hommes âgés, paternalistes. Avec certains, c’était complètement fou, maladif presque. J’ai eu le droit à plein d’allusions sexistes par rapport à mon origine italienne… J’ai le bénéfice du doute de l’étrangère qui ne comprend pas, parfois ça aide. Aujourd’hui, c’est différent et c’est devenu presque une norme l’équilibre hommes/femmes. Et ça me fait tellement rigoler quand ça vient de gens paternalistes, parce que ce n’est pas sincère, parce que c’est une obligation.
Tu as évoqué ton fils. Tes enfants, tu les as emmenés aux Arts Déco ?
Oui, ils connaissent très bien l’École. Mon premier était assez cool, il ne pleurait jamais, il faisait partie de moi, je l’emmenais partout, je l’imposais. J’allais dans le bureau du directeur et je l’allaitais pendant l’entretien. J’étais complètement dingue ! On ne me disait rien. Je veux voir cette école comme quelque chose d’accueillant.
Les étudiants, je sais que tu les entoures beaucoup, il y a un côté maternant ?
Oui, je ne sais pas si c’est le côté féminin ou le côté italien. Il y a des rapports culturels très différents en Italie. Le rapport aux étudiants demande beaucoup d’attention, beaucoup d’empathie, et c’est quelque chose qui, dans ce monde qui va de plus en plus vite, devient difficile. Pour moi, il faut faire les choses ensemble. La société française, je la vois, je la ressens, comme un engrenage, avec des roues de différentes dimensions qui se touchent à un moment donné pour faire fonctionner l’engrenage quand c’est nécessaire mais qui n’ont pas de contact et d’échanges. En Allemagne, dans une Berlin en pleine ébullition (cinq ans après la chute du mur), où j’ai fait une partie de mes études entre 1994 et 1996, je me sentais actrice de la reconstruction sociale de la ville. Si je reprends l’analogie de l’engrenage, Berlin était comme une grosse roue ; et tout le monde poussait cette roue ensemble. Je continue à avoir des rapports avec énormément d’anciens élèves, j’entretiens les relations, par exemple l’autre jour avec une ancienne élève de Design objet que je sentais exceptionnelle et qui est devenue une commissaire et critique d’art assez connue, qui s’est établie à Berlin : Liberty Adrien [Diplômée 2011]. Elle a eu la bourse du Cnap pour ses recherches féministes [bourse de recherche curatoriale du Centre national des arts plastiques, pour son étude consacrée depuis 2016 à l’histoire des acquisitions d’œuvres d’artistes femmes dans la collection du Cnap.].
Au niveau des étudiants, en DO, c’est équilibré entre filles et garçons ?
Oui, assez équilibré, depuis qu’on est « Design objet ». Au début il y avait plus de garçons, quand on était « Design industriel ».
Et dans tes projets liés au social et à l’écologie, est-ce que les femmes s’investissent plus ?
Pas forcément, je ne vois pas ça comme des projets sexués, même avec les revendications écoféministes, qui nous permettent de mieux comprendre les relations qu’on doit instaurer avec la nature. Je ne fais pas de différence entre filles et garçons – il y a des garçons qui sont beaucoup plus féminins que des filles, c’est assez relatif. Dans les Essai d’essais [textes des élèves de troisième année de DO, encadrés par A. Bernagozzi, rassemblés dans les ouvrages Essai d’essais], les questions liées au genre reviennent souvent, et aussi portées par des garçons.
Il y a des figures de femmes qui t’ont marquée parmi les étudiantes ?
Je peux te parler de Pauline Deltour [diplômée 2007] qui aujourd’hui est une jeune designer assez connue. J’ai longtemps accompagné les étudiants à Milan pour leur voyage avec le secteur – je me suis occupée de ça pendant plusieurs années – Pauline voulait rencontrer Konstantin Grcic ; moi, à l’époque, j’étais journaliste, je connaissais tout le monde du design, et je connaissais bien Konstantin : on a pris rendez-vous avec lui, à la Triennale, et elle a eu son premier stage juste après, elle a été la première femme à rentrer dans le bureau de Konstantin Grcic en Allemagne.
Et parmi les étudiantes dont tu as accompagné le mémoire ? Je sais que tu en as accompagné beaucoup.
J’ai dirigé le mémoire de Camille Zonca, ce qui l’a amenée à s’ouvrir sur la collaboration, la transversalité dans le métier, ce qui se retrouve dans Label Famille, créé avec des gens d’autres secteurs[« une nouvelle génération de créateurs à la croisée de l’art, du design, du conseil et de la stratégie » ; titre du Grand Projet en 2015 de Cyril Quenet (Design graphique), Anne Bourrassé (Photo/vidéo) et Camille Zonca (Design objet)] – c’est un éloge de la diversité. Son mémoire, ça s’appelait : Le co-design citoyen [2014], c’était sur l’importance, justement, de la co-création dans le design. Et puis, il y a Carmen Bouyer, une autre fille géniale, qui est très active dans l’écoféminisme[artiste, éducatrice et organisatrice d’événements engagée pour le respect de la nature et de l’humain], j’ai dirigé son mémoire, elle venait de Design textile et matière, elle est venue à mes cours et a rejoint Design objet [Diplômée 2012]. C’est elle qui avait monté l’AMAP [Association pour le maintien d’une agriculture de proximité], ça faisait partie de son Grand Projet. Elle a fait à l’École en février 2020 un workshop inter-écoles dans le cadre du projet « Faire projet, faire ensemble. Célébrer la diversité par le design, pour une société plus résiliente et conviviale », toujours dans le cadre du projet EU 4Cs, conçu pour réfléchir collectivement à l’implication des écoles de design dans les sujets de migration. En ce moment, nous sommes en train de préparer un deuxième workshop inter-écoles pour inviter les étudiants à initier des actions directes pour la diversité et l’inclusion par le design.

Cléa Arnulf
étudiante
de 2010 à 2015
avec
Alexandra Piat
le 25.11.20

- Rôles genrés
- Déséquilibres
- Hommage
- Mysogynie intériorisée
- Représentation
- Engagement
- Plafond de verre
- Santé mentale
- Bienveillance
- Pouvoir
Entretien de
Cléa Arnulf
étudiante de 2010 à 2015
le 25.11.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Je suis une femme cis [cisgenre, dont l’identité de genre correspond au genre qu’on lui a assigné à la naissance], blanche, de vingt-neuf ans, d’ascendance bourgeoise même si je gagne mal ma vie. Je suis valide. J’ai une formation de scénographe, mais je suis artiste plasticienne et je suis diplômée des Arts Déco depuis 2015.
Est-ce que tu peux nous parler un peu du secteur Scéno ? Quelle ambiance il y avait dans le secteur, parmi les élèves et avec les profs.
La Scéno est une section qui s’est énormément féminisée. C’était déjà le cas quand je suis arrivée. Chez les élèves et les profs. Je crois que l’on avait même un corps professoral assez mixte. C’est un secteur qui, de toute façon, même dans le milieu professionnel, s’est beaucoup féminisé donc on arrive un tout petit peu après la bataille. Et à la fois, la bataille n’est pas complètement menée parce que dans le métier lui-même il y a énormément de sexisme. Juste le fait d’entrer sur un plateau et de se sentir un peu mal à l’aise parce qu’on sent qu’on est la seule femme ou qu’il faut adopter certains comportements pour que ça fonctionne. Après en secteur Scéno, c’est vrai que c’était le genre d’atelier où on faisait les bonhommes, avec tout ce que cela comporte d’ambiguïté. C’est à la fois une forme d’émancipation quand tu es une femme, de pouvoir construire des trucs, et à la fois c’est une manière de se conformer à ce qu’on attend d’un scénographe. Mais sur tout le plan théorique, il y avait une grande place donnée à la réflexion et ce côté intellectuel pouvait être considéré comme féminin, et c’était ok.
Mais dans le vrai métier de scénographe, il peut y avoir une opposition entre les gens qui fabriquent et les gens qui pensent, qui conçoivent. Quand tu commences, tu es souvent dans la construction, dans le faire, et il y a une dévalorisation des gens qui pensent parce qu’ils ne sauraient pas tenir une visseuse, etc. Finalement, ces gens qui pensent étaient souvent des femmes, donc, pouvait aussi s’ajouter une couche misogyne. Quand tu étais un gars qui faisait de la « constru » il y avait une forme de valorisation. Qu’est ce que tu faisais en réaction à ça ? Tu faisais la meuf qui faisait de la « constru ».
Les techniciens de Scéno, franchement, ils ont toujours été biens, même assez dévoués. Mais dans certains ateliers, je sentais quand même qu’il y avait un comportement à adopter pour y entrer. Une amie à moi savait qu’il ne fallait pas qu’elle mette du rouge à lèvres en atelier parce que ça la décrédibilisait techniquement d’être trop féminine, c’est associé à quelque chose de superficiel. Et par opposition par exemple, en métal, Pascal [Autissier] est quelqu’un de très gentil qui prenait toujours les personnes sous son aile et y compris les grands débutants et les grandes débutantes. L’un dans l’autre, il y avait quand même cette espèce d’ambiance avec des ateliers qui étaient occupés principalement par des étudiants. Par leur éducation, ils se sentaient légitimes à aller dans ce genre d’endroits et à être bien là-bas. Ça donnait une ambiance un peu virile, cette manière de prendre l’espace, de se sentir compétents. Donc c’est pas facile d’arriver dans ce contexte, surtout qu’on était beaucoup de filles à se sentir complètement incompétentes en technique de bricolage. Il y a tout l’extérieur qui arrive à l’intérieur, c’est normal, il n’y a pas d’étanchéité entre l’école et le patriarcat.
Peut-être qu’il faudrait faire une espèce de formation à l’entrée de l’école où tout le monde apprend à bricoler et tout le monde apprend à coudre, ou une espèce de remise à niveau peut-être genrée, pour qu’il n’y ait pas d’inégalités ensuite. Par exemple il n’y a presque pas d’hommes en Textile. Mais il y a un technicien et c’était un bon contre exemple parce que c’est quelqu’un qui n’entre dans aucun cliché. C’est un peu une nouvelle masculinité.
On dit souvent que le secteur Design textile est plus bienveillant que d’autres, globalement.
C’est possible et c’est intéressant d’ailleurs, parce que je n’ai pas l’impression que ce secteur a la reconnaissance qu’il mérite. Quand on voit les travaux de diplôme, c’est d’une subtilité et d’une grande intelligence. Cela met en jeu le toucher, le sens de la matière, la composition graphique mais aussi le travail en trois dimensions, en macro, le tout avec beaucoup de sensibilité et un vrai esprit de recherche laborantine. Et pourtant ce n’est pas un secteur « phare ». Les designers graphiques, c’était plus à la mode, c’était un peu les « cool kids » et d’ailleurs c’était très masculin comme secteur, j’ai ce souvenir-là. Ils prenaient beaucoup de place. Nous on était serrés à douze dans une espèce de placard à faire nos maquettes et eux ils jouaient au ping-pong tellement ils avaient de place. Il y avait quelque chose de l’ordre de l’impertinence : et l’impertinence au masculin, elle est toujours un peu fun.
Dans les ateliers de l’école, il revient souvent des sensations différentes, d’un côté on dit qu’il est plus facile d’obtenir ce que l’on veut quand on est une femme, de l’autre que l’on doit en faire beaucoup pour obtenir ce dont on a besoin, que l’on doit absolument prouver que l’on mérite. Est-ce que tu as ressenti ces choses-là ?
Je pense que c’est assez juste. Néanmoins je n’ai pas eu l’expérience du privilège masculin. Pour moi, c’était un peu normal d’aller déployer des stratégies pour obtenir quelque chose. Il a pu y avoir la stratégie de « Je ne sais rien faire, aidez moi », la jeune fille en détresse. La stratégie de la séduction aussi ou en tout cas, une forme de séduction. D’ailleurs, faire la jeune fille en détresse c’est un peu ça.
Et ce rapport de séduction-là, c’était assez présent ?
Oui, je pense qu’il y avait beaucoup de filles qui faisaient ça. Je dis pas du tout ça pour jeter la pierre parce que c’est une stratégie comme une autre. Si ça marche, ça marche.
Est-ce que vous en parliez ensemble entre étudiantes ?
On n’avait pas une conscience là-dessus. D’ailleurs en Scéno, il y avait presque une forme de misogynie de la part des femmes, quelque chose de l’ordre de « Il ne faut pas être trop fifille », « Regarde elles sont trop fifilles alors que nous on est des vraies pros du bricolage ». Et puis, c’était avant #metoo, c’est-à-dire que quand on savait qu’untel était un peu « chelou », on en parlait, on se fichait de lui, on partageait ces expériences mais ce n’était pas de manière très consciente, en tout cas pas avec une conscience politique, féministe.
Dans les projets que tu réalisais, est-ce qu’on classait ta pratique dans des clichés ?
Personne ne m’a dit que je faisais un travail trop féminin ou ce genre de choses. Bien sûr, il est possible qu’on se soit auto-censurées, en ayant compris les codes. Parce que le but du jeu quand on rentre dans un secteur est de coller à notre discipline donc, si les codes sont masculins, on les apprend.
Est-ce que tu as le sentiment que tu as appris au sujet de designers et d’artistes femmes et hommes à peu près de manière égale ?
Clairement non. Mais je pense que si tu es prof et que tu ne fais pas l’effort absolument conscient et éclairé, c’est impossible. On a eu d’excellents historiens de l’art que j’aimais très fort, quelques-uns faisaient un tout petit peu attention à parler de femmes, mais ce n’était certainement pas paritaire les références qu’ils donnaient. Après, dans les interventions extérieures, on a eu beaucoup de femmes en Scéno. Par exemple, une éclairagiste extraordinaire a suivi mon diplôme, Caty Olive, ainsi qu’une constructrice, Emmanuelle Debeusscher. Après, tout le monde était blanc, et ça ça se retrouve ensuite, j’ai vu très peu de personnes racisées [qui appartiennent à l’un ou plusieurs des groupes sociaux subissant le racisme] à la technique au théâtre.
En deuxième année, on a eu Marguerite Bordat, une super costumière et scénographe, qui pour le coup nous a un peu marqués parce qu’en deuxième année, on découvre le secteur. Et avec mes copines, c’était un peu un « rôle modèle » pour nous.
Tu as dit que tu avais été représentante en CER [Conseil des Études et de la Recherche], est-ce que tu peux en parler un peu ? Est-ce que vous avez eu des combats particuliers ?
Déjà on avait mené un combat en première année, c’était folkorique. On avait fait la révolution…
J’ai l’impression que ça arrive tous les cinq ans !
Oui c’est pour ça que je suis un peu cynique. On avait occupé des amphis pour créer la nouvelle école. On avait même une chaîne de télé avec Elliot Lepers qui était à l’école à l’époque et qui aujourd’hui a vraiment fait carrière dans la politique et la communication. C’était un excellent politicien déjà. On avait fait une espèce de manif créative avec des marionnettes géantes dans la rue pour protester.
C’était sur quel sujet ?
Il y avait l’idée de dire qu’on voulait que les élèves soient au centre de la réflexion sur la pédagogie. On voulait limiter les partenariats avec les entreprises privées. C’était super utopiste, un peu niais, je pense. En tout cas, c’était la révolution de la première année, mais c’était assez fondateur parce qu’on a été beaucoup à se rencontrer à ce moment-là. Et aussi, c’était inter-année. J’avais pu rencontrer des gens de plein de secteurs. L’idée, c’était aussi de dire : « C’est une école qui se revendique pluridisciplinaire, mais finalement il y en a assez peu, ce n’est que de la com’ et nous on va faire de la vraie pluridisciplinarité ». Mais c’était super compliqué de faire bouger les choses, il y avait plein de dysfonctionnements et ça nous dépassait, on n’avait pas vraiment de pouvoir dessus. On pourrait faire un entretien entier sur la question de refondre la pédagogie à l’école.
Dans tous ces combats-là, est-ce que tu dirais qu’à cette époque-là, tu avais un combat féministe déjà ?
Non, clairement non. Je pense qu’il est arrivé à la fin de l’école. D’ailleurs, ça peut se ressentir dans la fanfare. On était une fanfare fondée à l’école suivant les modèles des années précédentes et un peu liée au fonctionnement des fanfares qu’on appelle « Bôzarts » c’est-à-dire venant des écoles d’archi. À l’école, le vent changeait, c’est-à-dire que les fanfares n’étaient plus du tout à la mode et on se faisait jeter des canettes de bière dessus, on se faisait arrêter par le DJ… Après on jouait comme des manches donc c’est un peu compréhensible. Mais on aurait pu avoir un peu de soutien !
Si je dis ça c’est parce que c’est à la sortie de l’école que tout est arrivé en même temps, avec la prise de conscience féministe. Je crois que ça a été le cas pour beaucoup de personnes, pas que dans le monde des écoles d’art ou de la fanfare. Ça a été la période #metoo. Entre temps on a eu de graves problèmes d’agressions sexuelles au sein même de la fanfare, et on a assumé qu’on était une fanfare féministe. On a pris des décisions concrètes par rapport au recrutement, parce que plus les fanfares vieillissent, plus elles se masculinisent. Les fanfares des Arts Déco faisaient partie des fanfares les plus mixtes qu’il y ait. Il n’y avait pas le choix, quand il y a 70-80% de meuf étudiantes, tu en retrouves au moins 50% dans les fanfares. Il y a une fille qui s’appelle Juliette [Michez, étudiante de Centrale Paris] qui a fait tout son mémoire de sociologie sur les femmes et la fanfare (si tu interroges Irène [Buigues, ancienne étudiante, elle a réalisé les illustrations des statistiques de ce mémoire] elle t’en parlera).
La fanfare s’appelle Les Tyrassonores, elle est en confinement, mais elle est absolument active et plus féministe que jamais. Si on fait un peu d’histoire, c’est quelque chose qui était quand même issu de sociétés populaires en opposition aux sociétés savantes, à la musique. C’étaient des défilés qui défiaient l’ordre public, qui parodiaient les fanfares militaires. Il y avait presque quelque chose d’anarchiste. À Paris, il y a une tradition très forte des fanfares d’écoles, notamment des grandes écoles, et donc souvent une majorité de mecs blancs, et de mecs blancs bourgeois. En ce moment, il y a une vraie réflexion, peut-être assez minoritaire, sur ces milieux-là.
Et maintenant, vous jouez mieux ?
On joue mieux. On est audibles maintenant !
Est-ce que tu as la sensation que l’école t’a apporté confiance en toi, en tes capacités ? Qu’elle t’a rendu plus forte ?
C’est une vraie question. Quand j’ai fini le diplôme j’étais super contente, ça s’était super bien passé et j’étais vraiment fière de moi. La période juste après a été vraiment difficile. Je n’étais pas du tout armée pour cette période-là. Donc je dirais qu’il y a une vraie critique à faire sur la professionnalisation à l’école. Je crois que ça s’est un petit peu amélioré depuis, il y a la sixième année et quelqu’un est censé s’occuper de l’insertion professionnelle. Mais c’est vrai que nous, on était vraiment lâché·es dans la nature sans savoir faire un devis, et encore aujourd’hui, je crois que je fais mal ma comptabilité d’artiste-auteur. Quand on voit la situation genrée dans le champ des artistes-auteurs, je pense qu’il y a un boulot à faire là-dessus. D’ailleurs on ne dit pas artiste-autrice, ce qui est quand même plus juste techniquement.
Il y a un enjeu particulier, justement parce que l’on est une école dont sortent 65% de femmes chaque année.
C’est ça. Si je me rappelle bien des chiffres, je crois qu’en tant qu’artiste-auteur, l’écart salarial est de 50%. Il est encore pire que les 23% qu’il y a dans le salariat où au moins il y a des règles. Le free-lance, c’est la guerre.
Oui, et c’est dû au milieu professionnel et aux femmes elles-mêmes qui se dévalorisent.
Je connais tellement de femmes qui se dévalorisent et qui ne se vendent pas au bon prix, qui sont trop contentes d’avoir du travail et qui, du coup, acceptent tout. Je pense qu’il faut que l’on soit sur-armées, plus que jamais. Ce n’est pas simplement avoir les bases et compter ensuite sur l’autonomie de l’élève, mais vraiment prendre en compte de manière active les réalités du milieu et l’aider à fourbir ses armes de manière précise. Quand on pense au Rapport Racine sur l’activité des artistes-auteurs, aux déboires de l’Urssaf Limousin, ce n’est pas un long fleuve tranquille qui nous attend. Si à cela on ajoute le fait d’être une femme, de venir de milieux défavorisés ou d’être racisé·e, il faut mettre les bouchées doubles. Beaucoup de nos professeures pourraient avoir à ce propos l’attitude de la génération de femmes qui se sont battues toutes seules, et peuvent être circonspectes face à ces revendications. Mais si on veut une véritable égalité des chances, il faut être informé·e.
De même, il me vient à l’esprit la question du trouble psychologique. Avoir des troubles psy, à l’école comme à l’extérieur, c’est au mieux dissimulé, au pire extrêmement dévalorisé, et cela rencontre le genre. Notamment en termes d’image de l’artiste, Vincent Van Gogh qui se coupe l’oreille en pleine crise psychotique, c’est un génie fou, Camille Claudel internée de force, c’était quand même un peu une hystérique. Si il y a environ une femme sur trois qui est ou sera victime de violences — et c’est un euphémisme — avec l’impact psychologique que cela implique, sur une population de 65% de femmes aux Arts Déco, on peut aisément imaginer qu’on va avoir pas mal de personnes qui souffrent de dépression, d’anxiété généralisée… Et j’en connais beaucoup, elles ne sont pas forcément détectables parce que c’est encore assez tabou, et relativement mal vu surtout lorsque l’on est une femme. Ces troubles peuvent s’accentuer au moment crucial de la sortie d’école qui est un véritable saut dans le vide. Les actions mises en place pourront aider tout le monde, tous genres confondus.
Dans l’école en général, est-ce que tu as eu la sensation d’être plutôt bien accompagnée et soutenue dans ton travail par les équipes pédagogiques ou les responsables d’ateliers ? Est-ce qu’il y avait une différence dans cet accompagnement entre les femmes et les hommes ?
Je ne saurais pas te répondre vraiment. C’est sûr que les intervenantes extérieures ont été vraiment super importantes. C’est compliqué à dire parce que c’est quelque chose que tu retrouves dans le métier aussi, tu as parfois des femmes qui ont des comportements masculins, parce qu’elles ont appris comme ça. À la sortie, j’ai eu une expérience assez traumatisante. Je ne savais pas vraiment comment faire les choses, je n’étais pas sûre de moi, débutante. Et puis il y avait deux nanas qui avaient un peu de bouteille et qui m’ont traitée à la dure, comme elles-mêmes l’avaient été dans leur formation. Peut-être qu’il y avait des profs femmes qui avaient un tout petit peu intégré ça, et qui n’avaient pas la moindre notion de psychologie. Je me rappelle de moments extrêmement tendus où je m’étais mise à pleurer dans le couloir.
C’est différent quand tu travailles avec des gens conscients politiquement. Par exemple aujourd’hui, je fais pas mal de projets avec des copines qui ont une vraie conscience politique féministe, avec des groupes de lesbiennes et ça n’a rien à voir en termes de soutien, de bienveillance. En tout cas aujourd’hui en tant que prof, je ne fais pas ça. Je pense que les nouvelles pédagogies, il y en a plein qui ont été développées au cours du XXe siècle et ces dernières années, ce n’est pas nouveau, mais pour moi ça va avec une éthique féministe. En particulier pour les élèves filles, parce que je sais qu’elles arrivent avec un background qui n’est pas le même en termes de confiance en soi.
Tu es enseignante où ?
Aux ateliers du Carrousel au sein du Musée des arts décoratifs.
Dans ta pratique d’enseignante, est-ce que tu mets en place des systèmes pour pallier certains manques ? Est-ce que tu mets en place ton engagement au cœur de ta pratique d’enseignante ?
Oui, j’essaye. Après, je ne dirais pas qu’il y a une réelle construction parce que c’est difficile et cela demande des heures de préparation en plus. Donc je ne dirais pas que j’en ai fait un système. Par contre, il y a une vraie conscience. Maureen Béguin [étudiante de 2013 à 2018] est enseignante avec moi. En termes de pédagogie, elle a beaucoup de choses à dire. Ensemble on a fait un workshop où elle leur faisait faire de la méditation à la fin. C’était génial et ils et elles ont adoré. Je pense que tout ça ça va ensemble parce que ce sont toutes des techniques — la méditation ou le yoga — qui sont vraiment considérés comme des trucs de meuf, inutiles. Alors que je suis persuadée que dans l’apprentissage, ça peut être très utile.
Est-ce que cette bienveillance, tu as quand même pu la trouver chez des profs aux Arts Déco ?
Il y en a eu chez certains. Je me rappelle d’un couple de profs, l’une d’AutoCAD et l’autre d’archi théâtrale, qui ont toujours été super bienveillants. Il y avait tout un truc maternel et paternel à égalité. Et puis Marguerite Bordat, l’intervenante, c’est elle qui est venue me chercher dans le couloir quand je pleurais. Je pense qu’on gagnerait à en avoir beaucoup plus, de manière officielle. Il semble que la bienveillance n’est pas quelque chose de valorisé, que ça peut rencontrer beaucoup de résistance et que c’est considéré comme quelque chose d’un peu kitsch, d’un peu niais, d’un peu féminin. En France de manière générale, il y a un vrai problème en termes de pédagogie par rapport à des tas d’autres pays. C’est, structurel, profond. Il faut envoyer tout le monde chez le psy et refondre totalement la pédagogie.
Dans l’école, est-ce que tu as déjà été témoin ou victime d’agressions verbales ou physiques ?
Alors pas que je me souvienne, mais il y a des choses qu’on préfère oublier… Après, il y avait des mecs de la technique avec qui il fallait qu’on y aille en « mode séduction » et c’était le seul moyen d’être légitime pour obtenir ce dont on avait besoin pour travailler. Il y a aussi un responsable d’atelier avec qui j’avais dû parler pour organiser mon diplôme, et lui c’était quelqu’un qui utilisait son pouvoir. C’était lui le chef et il fallait lui dire les bonnes choses pour que ça passe, pour qu’il accepte. Il est certain que les technicien·nes nous apprenaient tout et méritent une revalorisation absolue de leurs compétences et de leur salaire. Mais lui, franchement, c’est quelqu’un qui est vraiment dans un schéma super patriarcal. Ce n’est pas sain de sortir de l’école en ayant appris que pour accéder à des moyens il faut soit user de son charme soit savoir répondre avec un humour de troisième mi-temps. Et tout cela, c’est du temps de cerveau disponible perdu, du temps perdu pour la création.

Joanna Pawelczyk
enseignante
depuis 2018
avec
Lucile Encrevé
le 11.01.21

- Care
- Rapport au corps
- Sexisme
- Accueil
- Histoire des créatrices
Entretien de
Joanna Pawelczyk
enseignante depuis 2018
le 11.01.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es dans l’École ?
Depuis trois ans, je suis enseignante vacatrice – je mets le mot au féminin… J’ai d’abord donné un atelier de « Performance artistique » dans le cadre du projet EnaMoma [École nationale de Mode et matière, liée à l’Ensad]. À l’Ensad, j'enseigne l’expression corporelle et la performance artistique, je suis aussi tutrice pour le programme « Artistes Intervenants en Milieu Scolaire » – je suis formée à la pédagogie alternative. J’ai donné des workshops, avec des étudiant·es de toutes les années, et je donne deux studios, adressés surtout aux étudiant·es de la 3e année : Laboratoire du corps et Laboratoire de la performance artistique. La première couche de mon travail est la sensibilisation corporelle : ouvrir les sens et la perception de l'étudiant·e par rapport aux objets, aux matières et aux forces naturelles qui nous gouvernent, comme la gravitation qui est primordiale pour la danse, pour ensuite concevoir un objet, concevoir un vêtement, voir la matière, le tissu autrement, voir la forme autrement.
Dans le studio Laboratoire du corps [fig.43], j'utilise des techniques somatiques qui ouvrent, qui décortiquent certains nœuds, qui permettent de voir autrement, toucher autrement ou au moins être conscients des voies possibles pour le faire et les intégrer consciemment dans le projet artistique. J’y utilise également mon expérience de théâtre post-grotowskien [Jerzy Grotowski, metteur en scène polonais, théoricien du théâtre]. Je suis polonaise, j’étais performeuse dans un théâtre puis je suis venue en France et je suis devenue enseignante à la Sorbonne, d’art dramatique, de théorie et de pratique. Je travaille aussi avec une technique qui s’appelle le Body-Mind Centering [méthode d’éducation somatique créée par l’américaine Bonnie Bainbridge Cohen]. Cette approche se révèle riche pour les étudiant·es. Une des participant·es de mes studios s’en est inspirée pour la suite de son travail de création d’objets thérapeutiques pour les hôpitaux.
Tu n’interviens pas en 1ereannée ?
J’ai rencontré une enseignante. Je suis intervenue dans son cours de dessin pour la première année, elle souhaite prolonger notre collaboration. Vus les profils des étudiant·es qui viennent à mes cours, mon travail est intersectoriel et entre en synergie avec les autres enseignements. J’ai eu des groupes d’étudiant·es de Design vêtement, de Cinéma d’animation etc.
Avec le virus, c’est compliqué depuis mars dernier ?
L’année dernière, j’ai donné des cours en ligne et ça a très bien fonctionné. Chacun a travaillé corporellement avec l’espace où il était confiné. Les étudiant·es étaient là. La contrainte devient quelque chose qui déclenche la créativité. On a fait quelque chose de plus avec les étudiant·es du cours de performance : on a fait dix minutes de danse à dix heure tous les jours, ça s’appelait 10/10 – d’avril à la fin du semestre.
Parmi les étudiant·es, est-ce que tu as surtout des étudiantes ?
Oui, j'ai beaucoup d'étudiantes, mais aussi des garçons et j’en suis vraiment très contente. En fait, j’ai des petits groupes de dix, entre dix et vingt étudiant·es selon les studios, avec un quart de garçons (25 à 30%). Il y a eu des garçons qui ont suivi mon travail, qui y étaient attachés. Je suis féministe, je souhaite consciemment ouvrir la sensibilité à la question des genres par mon approche. Mais elle a beaucoup évolué, j’étais au départ plus militante « en bloc », « à la hache ». Ma façon de communiquer a changé. Et mon but aussi. Mon objectif est beaucoup plus à l'intégration des genres. Dans mon cours on parle bien évidemment ouvertement du corps, des organes. Notre réalité corporelle est là, on l’expérimente, on se pose au sol, contre le mur, contre le partenaire. Chacun découvre ses territoires, sa manière d’habiter son corps et de le bouger. On travaille le poids, le toucher, comment on entre en interaction, comment on peut toucher quelqu’un, se guider, lâcher le contrôle. Il m’est arrivé de toucher certaines questions assez sensibles comme des violences faites aux femmes et les violences éducatives. Expérimenter son corps de manière sensible peut ouvrir ceux et celles qui l’habitent par la force et de manière rigide. Ce qui est par la socialisation plutôt appris aux garçons. On peut dire que cette approche du corps est une voie pour adoucir la façon d’être machiste…
Tu as ressenti qu’ils ou elles subissaient du sexisme dans l’École ?
J’ai ressenti certains rapports de force entre les étudiant·es et les enseignant·es. C’est ce qu’ils m’ont dit.
Toi, tu n’as rien subi directement ?
Pas à l’École, mais par un enseignant de PSL [Paris Sciences et Lettres]. C’était lié aux cours de l’EnaMoma. Il y avait des problèmes administratifs liés à ma salle, qu’il occupait, j’exprimais mon mécontentement. Il m’a menacée, c’était assez violent. C’est difficile de décortiquer s’il s’est permis ce genre de discours parce que je suis une femme, ce qui peut donner plus de permission pour certains hommes.
Tu enseignes où dans l’École ?
D’abord dans une salle de danse louée par l’École, dans une rue parallèle à la rue d’Ulm. J’ai eu des workshops en amphi Bachelier. Une fois, on a fait une performance qui s’est déversée dans toute l’École. Et ensuite, j'ai travaillé en 413, dans une salle de dessin. J'ai travaillé à la Rotonde [Rosa Bonheur] aussi. C’est plutôt bien comme conditions.
Tu t’es sentie accueillie ?
Par la direction des études, oui, mais je n’ai pas été introduite dans l’équipe des enseignant·es, ce qui m’a manqué. Avec le temps, je me suis rendu compte que la majorité ignore l’existence de mon enseignement donc le potentiel de croiser nos disciplines n’a pas pu être développé. C’est par la discussion avec les étudiant·es et mon imagination que j’ai rapproché mon enseignement de la réalité de leurs études. Et j’ai découvert les locaux par moi-même, en les montrant aux étudiant·es du workshop PSL.
Les étudiant·es, tu leur parles de féminisme, tu leur parles de créatrices ?
Je leur en parle parce que ça fait partie de mon univers – par exemple Rebecca Horn fait partie des références ancrées en moi. Cette année mes cours sont au second semestre, c’est prévu d’appuyer plus consciemment cette problématique.
Tu m’as parlé d’un projet que tu mènes en parallèle et qui croise ces questions.
Oui, ça s’appelle « Mémoire du corps féminin », il est né de mon travail avec le corps et ma réflexion sur nos mémoires individuelles et collectives. Je perçois le corps comme un livre où nos tissus emmagasinent la mémoire de notre vécu. C’est un concept de corps-livre, corps-archive. Le vécu des femmes comme donner la vie ou ne pas donner la vie physiquement m’intéresse. Cet interstice entre le physique et le métaphysique. Dans mon travail cela se manifeste en écriture poétique très étroitement liée à mon vécu du corps, à ma façon de danser, au multidimensionnel de la poésie (par l’installation et la performance). Pour élargir le spectre du vécu corporel/poétique des femmes, je suis en train de réaliser des interviews autour du vécu de règles, de la ménopause, de la grossesse ou du manque de grossesse. Ces discussions ouvrent les autres dimensions.
Tu te penses comme essentialiste [féministe considérant qu’il existe des spécificités/qualités féminines liées à une essence biologique] ?
Non, je ne me définis pas comme ça. Juste, je suis les ressentis des femmes d’abord avant toute catégorisation. La construction sociale, la construction de l’éducation sont primordiales pour moi. Personnellement, je soupçonne qu’on ne nous a pas tellement appris à bien vivre, en les acceptant, les différences, qu’on souhaite les effacer.

Élisabeth Vitou
responsable du département de la communication
et des relations extérieures,
de 1997 à 2000
avec
Lucile Encrevé
le 12.01.21

- Déséquilibres
- Rôles genrés
- Place à conquérir
- Écoute
- Hommage
Entretien de
Élisabeth Vitou
responsable du département de la communication et des relations extérieures, de 1997 à 2000
le 12.01.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Je vais commencer par me présenter. Je connais très bien le milieu des grandes écoles parce que c'est là où j'ai fait toute ma carrière. Je suis historienne de l'art, de l'architecture – j'ai un doctorat. Je suis diplômée de l'École du Louvre et j'ai un diplôme de communication-documentation de Sciences Po. En fait, j'ai toujours été dans la communication, très vite directrice de la communication dans ces écoles. J'ai commencé à travailler dans le milieu des écoles d'architecture, en débutant à la documentation dans le fameux Institut de l'environnement, qui était à l’emplacement de l'École des Arts Déco actuelle. Et quand les écoles d'architecture sont passées du ministère de la Culture au ministère de l'Équipement, je me suis retrouvée à l'école des Beaux-Arts où j'ai travaillé pendant quinze ans et où j'ai été directrice de la communication, m’occupant du service de presse et des relations publiques – école que j'ai quittée au bout de quinze ans puisque j'en avais vraiment fait le tour pour partir au ministère de la Culture au Cabinet pendant deux ans (c'était l’époque de Philippe Douste-Blazy [1995-1997]). J'étais rédactrice en chef du journal du ministère de la Culture, coordonnant à cet effet les services de communication des directions du ministère. Et c'est là qu’Elisabeth Fleury, qui était secrétaire administrative de l'École des Arts Déco, m'a téléphoné un jour en me disant : « Voilà, Elisabeth, on ne se connaît pas. La responsable de la communication des Arts Déco est partie et j'aimerais bien que ce soit vous qui la remplaciez ». On a déjeuné ensemble, et j'ai intégré l'École pendant quatre ans.
C’était à quel moment ?
Je suis arrivée exactement en 97 et j'y suis restée jusqu'à fin décembre 2000, et je travaillais avec elle et Richard Peduzzi [directeur de 1990 à 2002]. J'étais responsable de la communication, donc je m'occupais de tout ce qui était service de presse, du journal d'information interne, du rapport d'activités. Je faisais beaucoup d'écritures « institutionnelles ». Là où j'ai agi également, c’est au niveau des Portes Ouvertes : il y a trois écoles nationales d'art à Paris, et nous avons réussi à nous mettre d'accord pour essayer d'avoir nos Portes Ouvertes en même temps. Et puis j'ai mis l'accent sur les relations internationales – l’École des Arts Déco n’est pas assez connue à l’international, elle était trop repliée sur elle-même : j'ai mis en place un partenariat avec le Mexique, un partenariat avec l'Inde (avec le National Institute of Design, à New Delhi). J'ai travaillé avec l'AFAA [Association Française d'Action Artistique]. Et je leur proposais des choses qui étaient du donnant donnant – échanges d'élèves, échanges de profs, échanges d’expos.
Vous aviez une équipe avec vous ?
Oui, nous étions six dans le service communication. C'était essentiellement des femmes. J’ai embauché un homme, mais cela n’a pas été une réussite. Ensuite on m'a proposé le poste de directrice de la communication de l'École nationale des ponts et chaussées, et, au bout de huit ans, j’en suis partie pour intégrer un réseau appelé ParisTech, regroupant douze des plus grandes écoles françaises, comme Polytechnique, HEC, l'École des ponts et les Mines, où je faisais l'interface entre les services de documentation et les directions de la recherche, de façon à valoriser le travail de leurs laboratoires de recherche et à leur donner une visibilité internationale. Je connais donc très bien les grandes écoles et je peux les comparer entre elles. Parce qu'il y a à la fois des différences historiques et, en même temps, beaucoup de similitudes. C’est la même clientèle, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a affaire à la classe moyenne et supérieure, blanche, parisienne, cultivée. La seule différence entre les écoles d'art et les écoles d'ingénieurs, c'est que, dans les écoles d'art, il y a des dynasties. On les retrouvait aux Arts Déco et aux Beaux-Arts et on les retrouvait surtout dans les écoles d'architecture, car vous avez des familles d'architectes, d’artistes.
Et les différences entre Beaux-Arts et Arts Déco ?
Quand j’étais aux Beaux-Arts, j'ai passé mon temps à entendre : « Oui, c'est insupportable, il n'y en a que pour l'École des Arts Déco – la presse ne parle que des Arts Déco, l'École des Beaux-Arts est considérée comme ringarde, le ministère n'a les yeux fixés que sur les Arts Déco », etc. Quand je suis arrivée aux Arts Déco, le contraire : « C'est insupportable, il n’y en a que pour l'école des Beaux-Arts, c'est la grande école, nous, on a toujours été la petite école, la petite école de dessin », etc. Il y avait surtout un clivage politique très net entre les deux écoles, l'école des Beaux-Arts était l'école traditionnelle, encore traumatisée par 68, et l'École des Arts Déco était beaucoup plus à gauche, longtemps communiste puis soixante-huitarde. A l'école des Beaux-Arts, il y a peu de profs mais un personnel administratif important parce que l'école des Beaux-Arts est une sorte de petite PME. L'École des Arts Déco, c'est exactement l'inverse. Il y a beaucoup d'enseignants. En revanche, l’équipe administrative est assez petite. Mais les activités de l'école sont plus restreintes, il n'y avait pas les expos ou les éditions comme à l'école des Beaux-Arts, qui a aussi des collections patrimoniales depuis toujours. Les deux écoles sont très différentes.
Et les femmes, leur place était similaire dans les deux écoles ?
Les femmes ? Il y avait encore peu de femmes dans les grandes écoles à l’époque et un peu plus de garçons que de filles chez les étudiants. Et quand j’ai quitté le milieu des grandes écoles, il commençait à y avoir plus de filles que de garçons. Aux Arts Déco, on devait être à 60% de filles, je pense. Et très peu d’enseignantes. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas, sauf erreur de ma part, d'enseignantes comme chefs de département. Ce n’était que des hommes. Il y avait des profs femmes, bien sûr, mais pas en tant que responsables de département. C’était surtout des assistantes.
Vous ressentiez ce manque de femmes ou c'était une question qu'on ne se posait pas ?
Venant des écoles d’archi, venant des Beaux-Arts, ça ne m'a pas surprise. C'était normal, si vous voulez. A l'école des Beaux-Arts, il y avait très peu de professeurs femmes, c’était pareil. Je me souviens, dans les années 90, le directeur de l'époque était Yves Michaud, on avait passé une annonce dans la presse spécialisée pour un recrutement d'enseignants. On avait mis : « candidature féminine encouragée ». On a failli avoir un procès. En tout cas, il y a eu un procès d'intention de la part d’un artiste qui a trouvé que c’était insupportable. Donc au niveau de la place des femmes et du rôle des femmes, je dirais vraiment que c’était pareil. Mais j'ai trouvé que les enseignants des Arts Déco étaient quand même plus machistes même si, paradoxalement, les Arts Déco formait un milieu sympathique, chaleureux – pendant des années, après mon départ, j’y suis retournée. C'était convivial, plus vrai qu’aux Beaux-Arts.
Ce machisme, vous l’avez ressenti personnellement ?
Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours travaillé directement avec le directeur. C'était mon poste qui voulait ça. J'ai toujours été perçue comme proche de la direction, mais c'est normal, la direction de la communication est rattachée au directeur. Ça a des avantages. Ce qui a été dur, ça a été avec le journal. J'avais l'habitude de faire des publications. J'ai fait de la recherche, j'ai publié en tant qu’historienne. Je n’avais rien à prouver, je savais écrire des articles. Aux Arts Déco, j’ai vu un potentiel inexploité : il y avait un journal. Ce n’était presque que des hommes. Ils ont eu l'impression que je marchais sur leurs plates-bandes, ils ne voulaient pas de moi aux réunions. Il a fallu que je m'impose par rapport à des personnes qui, au début, considéraient que, franchement, c'était leur boulot. Ça m'a pris du temps de changer ça et de me faire respecter d’eux. Ils ont compris que je pouvais apporter un contenu, de la matière, et qu'on pouvait travailler différemment. Au début, ça a été vraiment difficile. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans les écoles d'ingénieurs, y compris au niveau du personnel, c'est que là-bas, vous étiez reconnu pour vos capacités, que vous soyez homme ou femme.
Dans les réunions, vous assistiez à des scènes difficiles ?
C’était souvent très violent, je faisais partie du conseil d'administration de l'école, j'ai assisté à des réunions. Mais ce n'était pas tant un conflit homme/femme qu’un conflit droite/gauche. Ce que j'ai ressenti aux Arts Déco, c’est ce rapport idéologique, et puis ce curieux complexe d'infériorité par rapport à l'école des Beaux-Arts.
C’était violent contre la direction ?
Aujourd'hui, les directeurs d'école sont des administratifs. Les Arts Déco avaient une tradition : on prend un artiste, on veut être dirigé par quelqu'un comme nous. Avant Richard, c'était Tourlière [Michel ; de 1971 à 1990], qui était licier – mais ce n'était pas vraiment un artiste. Richard était un artiste, il était en activité et, en plus, il était bon. Et, bizarrement, les enseignants, qui avaient réclamé quelqu'un avec ce profil, l'ont rejeté, ils n'ont pas supporté. Ça a été très, très dur pour lui. Probablement, il y avait de la jalousie. Richard est un homme de théâtre, assez épidermique. Il y a des choses qui l'ont heurté.
Le directeur, il me semble qu’il a fait venir beaucoup de femmes autour de lui, non ?
L'administration s'est étoffée sous son règne. Je pense qu'il préférait travailler avec des femmes. Il était plus rassuré. Je veux dire, dans son milieu professionnel, il préférait travailler avec des hommes. Mais là, dans l'école, je crois qu'il était heureux d'être entouré de femmes, il était plus à l’aise avec elles.
Et vous, vous sentiez une forme de complicité féminine au premier étage entre les différentes cheffes de service ?
Non, ça ne fonctionnait pas vraiment. Il y avait une femme qui était une collaboratrice de Richard, qui venait du milieu du théâtre et qui était assez autoritaire. J'ai essayé de travailler avec elle en lui expliquant que je savais faire des expos, que lorsque j'étais aux Beaux-Arts j'avais les expositions dans mon service. Mais c'était son fief. Elle voyait l'expo en tant que décor, mise en scène. C'est pour ça que je me suis investie dans les relations internationales parce que personne ne venait m'embêter, et ça marchait très bien. Par contre, j’ai eu de bonnes relations avec Elisabeth Fleury, et avec Dominique Lesterlin [adjointe du directeur des études de 1998 à 2007], que j’ai fait entrer à l’École, où elle a fait du bon boulot.
Comme femme, vous aviez l'impression d’apporter quelque chose de genré, de féminin dans la manière d'encadrer les personnes, de gérer le groupe ?
J'avais fait en sorte que mon bureau soit toujours ouvert, j'ai toujours été très réactive. J'ai toujours écouté les profs, je leur ai toujours proposé de valoriser ce qu’ils faisaient. Dans mon équipe aussi. Quand je suis arrivée aux Arts Déco, je suis tombée sur une personne que j'avais bien connue à l'école des Beaux-Arts, qui était devenue responsable syndicale. Elle était terrorisée à la pensée de me voir parce que je représentais l'ennemi. Elle avait une barrière de bouquins devant son bureau et, derrière, elle faisait de la broderie, du tricot. J’ai eu une idée. On avait régulièrement des propositions de boulots pour les étudiants et j'ai confié ce travail à cette collaboratrice qui s'est investie là-dedans, qui a fait un boulot super. Quand les élèves d’animation ou de vidéo venaient la voir, elle faisait des copies de leurs films, elle les envoyait aux festivals. Elle dispatchait très bien les offres d’emploi auprès des élèves. Elle avait un bon contact avec les élèves et il y a eu une vraie cellule qui s'est créée au profit des élèves dans le service. Elle a été très heureuse de ça, et, quand je suis partie de l'école, je vais vous dire : elle m'a même fait un cadeau, c’était émouvant.
J’aimerais finir sur vos souvenirs de créatrices de l’École : il y a des femmes qui vous ont marquée ?
Il y avait une chose qu'on a faite qui a été très intéressante. On avait organisé une manifestation sur deux-trois jours pendant laquelle on avait invité des grands témoins, des anciens de chaque département, venus témoigner de leur pratique pour que les élèves voient les débouchés. Je me souviens d'une femme, très bien, qui venait du département Textile, elle avait ouvert un cabinet et c'est elle qui faisait les gammes textiles pour les intérieurs des automobiles. C'était passionnant. J’ai vraiment découvert cette femme, la décideur des gammes textiles des automobiles. Elle m'avait frappée.
À l’École, il y avait notamment Florence Miailhe, qui a été étudiante et enseignante [de 2001 à 2016] – elle fait des films d’animation de très grande qualité, elle a son atelier aux Frigos [espace de création dans le 13earrondissement de Paris], que j’ai beaucoup fréquentés. Et il y avait Béatrice Saalburg [enseignante de 1969 à 1998], professeur de dessin dans le département textile qui a ouvert par la suite un atelier d'illustrations botaniques. Je l’ai rencontrée à l’École, nous sommes devenues amies. Je suis devenue une de ses élèves et maintenant je fais de l'illustration botanique à mon tour, j’enseigne, j’ai un atelier.

Anonyme F
ancienne étudiante
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 18.12.20

- Hommage
- Sororité
- Féminisme
- Sexisme
- Épanouissement
- Entraide
- Carrière
Entretien de
Anonyme F
ancienne étudiante
le 18.12.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription collective
Aux Arts Déco, j’ai fait la section graphisme d’auteur. J’y suis entrée à dix-neuf ans, après une prépa, et j’ai été diplômée dans les années 90. J’ai fait mon mémoire un an après le Grand Projet (qui était alors la quatrième année). Ensuite, j’ai travaillé pendant un an chez un packager — une société qui réalise des livres clé en main pour des maisons d’édition — puis pendant deux ans chez Nathan Jeunesse, et, à partir de 2000, je me suis mise en indépendant pour faire mes livres. Depuis, je suis autrice indépendante. J’écris et je dessine des albums jeunesse et de la bande dessinée tous publics.
Comment était l’ambiance dans ton secteur ? Tu n’avais que des profs hommes ?
Quand j’étais à l’École, l’année du Grand Projet, il y avait deux sections possibles en graphisme : graphisme d’auteur ou édition presse. Mon caractère aurait dû me mener en édition presse, mais comme je n’aime pas la facilité, j’ai choisi d’aller en graphisme d’auteur, en me disant que j’apprendrai plus de choses. Je suis donc arrivée avec une certaine contradiction intérieure. J’avais deux profs principaux qui étaient des hommes, mais ce n’était pas les seuls enseignants puisqu’il y avait les profs des options et des autres matières, dont certains étaient des femmes. Par exemple, Margo Rouard [enseignante de 1978 à 2008], ainsi qu’une prof de gravure, Françoise Roy [enseignante depuis 1989], ont été des personnes très importantes pour moi. Ce sont les deux femmes profs dont je me souviens le mieux et qui ont vraiment compté dans mon parcours. Je ne trouvais pas ça spécialement bizarre, ce manque d’enseignantes. À l’époque, on n’analysait pas les choses de la même manière. Je me rappelle simplement qu’on se disait tout le temps que nos enseignants étaient misogynes. Ce qui me choquait davantage, dans l’ambiance générale de cet enseignement de quatrième année, c’était le côté très dogmatique politiquement, ça, c’était très difficile d’en sortir. Les profs étaient des gens de Grapus, des anciens de l’atelier d’affiches de mai 68. Certains avaient une aura incroyable, et on était dans une logique de pouvoir. J’ai passé mon diplôme l’année des grèves [de 1995], ils attendaient de nous qu’on fasse comme eux en mai 68. Ils nous faisaient faire des AG dans notre salle de cours et fumaient comme des pompiers en parlant de militantisme. Sauf qu’on n’était pas à la même époque, et que nous, on vivait les choses différemment. Je ne prenais pas ça vraiment au sérieux, ce qui devait beaucoup les énerver. J’avais l’impression qu’ils avaient une vision politique très fermée et que si on ne partageait pas cette vision, on n’avait rien à faire dans leur cours. En réalité, je m’entendais mieux avec le groupe d’édition presse et, quand j’ai fini mes études, j’ai même fait une carte de vœux pour l’École à la demande de Jean Lagarrigue qui, lui, était prof en édition presse. J’aurais dû aller dans ce groupe d’édition presse, avec Jean Lagarrigue et Jean Widmer, qui n’étaient pas dans ce schéma dogmatique. Le suivi concret de mon Grand Projet, qui consistait en un site Internet pour l’École, je l’ai fait en partie ailleurs qu’à l’École, car mes profs n’avaient pas envie de s’intéresser à internet. En plus, en cours il y avait une ambiance horrible, tous les jours quelqu’un pleurait.
Dans ton cours, c’était équilibré chez les élèves entre filles et garçons ?
On était plein de filles, on était très largement majoritaires. Et manifestement, nos profs n’étaient pas à l’aise avec ça. Au milieu de l’année, une élève qui en avait assez de cette ambiance est partie en section illustration, puis elle est allée avec une copine faire un voyage en Inde. Pour son Grand Projet, elle a présenté des dessins magnifiques de son voyage en Inde. Je suis admirative, elle a très bien réagi à mes yeux. Elle a mis de la distance. Moi, j’ai persisté, et j’ai été suivie en partie par Margo qui, elle, a été vraiment super. C’est la personne qui a été la plus présente pour moi. Elle était assez indépendante. Elle donnait l’impression d’être libre.
C’était un modèle ?
Oui, un modèle d’indépendance, quelqu’un qui prend sa vie en main ; modèle de réussite et de bonne ambition. J’ai gardé contact avec elle. Je l’ai revue il n’y a pas si longtemps et c’était un vrai plaisir. Donc, pour mon Grand Projet, j’allais chercher de l’aide ailleurs. J’ai par exemple consulté les graphistes M/M [anciens étudiants de l’Ensad] qui étaient venus à l’École faire une présentation et dont j’avais gardé le contact. J’aimais bien ce qu’ils faisaient, alors je suis allée leur montrer de temps en temps mon boulot. Ils ont été presque plus impliqués que mes profs qui ne faisaient que critiquer… Quand, par exemple, on apportait des livres en cours pour en discuter, je choisissais parfois un livre jeunesse. J’adorais les dessins de Quentin Blake. Mais ce que j’aimais n’était pas ce qui était valorisé, ça ne les intéressait pas du tout, ils trouvaient que c’était « trop ouvertement humoristique ». Le dessin, je l’ai poursuivi chez moi en parallèle. Et comme j’aimais bien ça, j’ai contacté l’auteur et éditeur Grégoire Solotareff. C’est un peu aussi lui qui m’a formée.
Il y avait le soutien d’une prof femme comme Margo Rouard. Est-ce qu’il y en avait entre les étudiantes ?
Oui, on était liées, ce sont des personnes que je vois toujours. On était toutes confrontées aux mêmes problématiques, même si, pour celles qui travaillaient sur des sujets politiques ou sociaux, ça se passait beaucoup mieux. Donc oui, on se soutenait les unes les autres.
Est-ce qu’il y avait des élèves qui avaient des projets engagés plutôt sur les questions féministes ?
Une de mes amies avait fait un projet sur les femmes. Elle était allée rencontrer des femmes issues de l’immigration et avait fait des images qui racontaient leurs parcours, comme des portraits graphiques de ces femmes.
Tu disais tout à l’heure que vous étiez un peu conscientes qu’il y avait des attitudes misogynes, mais que vous n’étiez pas tout à fait conscientes de tout ce qui se rapporte au sexisme…
Le monde a tellement changé. Même il y a cinq ans, on ne pensait pas de la même façon. Si je pouvais revoir aujourd’hui le film de ce que j’ai vécu à l’époque, je comprendrais probablement les choses différemment. Ce dont je suis sûre, c’est que je trouvais l’ambiance très autoritaire et paternaliste. Ça, c’est clair et ça va avec le côté politique. C’est pour ça que tout le monde craquait.
Les élèves masculins étaient plus écoutés ?
Il faudrait que je revoie les scènes. Franchement, je ne sais pas si c’est lié à ça. Je pense qu’il y a les deux, mais le facteur politique est aussi important et n’est pas lié au sexe. Mais c’est sûr que mes profs n’étaient pas à l’aise avec une classe à majorité de filles. On n’était pas prises au sérieux. Malgré les souvenirs qui s’effacent un peu, je me souviens qu’on en avait conscience.
Ils vous regardaient comme des amatrices, ce qui est un vieux cliché sexiste ?
En effet, pour eux, on n’était pas pro. C’est un truc qui me fait toujours réagir aujourd’hui. Je pense d’ailleurs que, en partie à cause de ça, je n’ai pas exprimé tout mon potentiel à l’École, ce qui est dommage car cette école est un outil génial. Et pourtant, on n’était pas un groupe spécialement timide. Il y avait des caractères différents, mais on n’était pas des petites choses effacées.
Et vous n’avez pu prévenir personne ?
Ça ne nous serait pas venu à l’idée d’aller nous plaindre.
Est-ce que ces profs, malgré tout, parlaient parfois d’artistes femmes, de graphistes femmes ? Dans tes cours de secteur, ou dans d’autres cours à l’extérieur ?
En graphisme, je ne crois pas. En histoire de la mode, je me souviens très bien d’un cours marquant à propos de Madeleine Vionnet [grande couturière française], entre autres.
Dans quels cours est-ce que tu t’épanouissais ?
À l’atelier gravure. C’était un cours qui pesait peu dans mon cursus, mais qui était vraiment bien. Le lieu était super : comme un havre, où on était dans la pratique sans être soumis à une autorité théorique écrasante. Et il y a une option qui a été à mon avis ce que j’ai fait de mieux à l’École, l’option scénario avec Bernard Skira, que j’ai suivie pendant trois mois. C’était génial et je me suis éclatée là-dedans. D’ailleurs, maintenant, j’écris. C’était vraiment un très bon cours. On rédigeait des petits textes à partir de contraintes, assez rapidement, et on lisait ensuite notre production au groupe, qui analysait et commentait. Je me souviens aussi qu’il y avait un prof qui était assistant banc repro : un homme très intéressant, toujours là pour nous aider. C’est quelqu’un pour qui j’ai une grande reconnaissance parce qu’il m’a apporté beaucoup. Je regrette d’avoir oublié son nom. Dans ce qui a été épanouissant, il y a aussi eu la venue des graphistes M/M, que j’évoquais tout à l’heure : ils ont exposé leur production et, après, les élèves intéressés ont travaillé avec eux sur un projet qu’on avait appelé le British Day. J’ai fait partie de ce groupe d’étudiants. Le travail était concret et amusant. À mon avis, ça a été la meilleure exploration graphique de toutes mes études. En fait, avant la quatrième année, qui a été un enfer, il y avait une bonne ambiance à l’école. Par exemple, on a eu un prof, en avance sur son temps, Dieter Lassmann qui voulait nous faire dessiner un boîtier de télécommande pour de l’électroménager intelligent. En 94, c’était assez pointu. On trouvait ça fou de téléphoner à notre machine à café quand on est à la campagne pour lui demander de nous faire du café, alors qu’aujourd’hui, c’est devenu la norme. On a fait une campagne pour ne pas faire ce sujet, qu’on trouvait absurde. Lassmann s’est montré très souple, il a remplacé l’exercice par un autre, et tout s’est bien passé. Je suis reconnaissante envers ce prof qui a été à l’écoute de ses élèves.
Et avec les profs de Sciences-Humaines ?
En sciences humaines, je ne sais plus. En histoire de l’art, je me souviens de certains que j’appréciais beaucoup. Il y avait la prof qui faisait le cours sur la mode dont j’ai parlé, un cours passionnant. Un cours sur l’art chinois que j’avais beaucoup aimé, aussi, ainsi qu’un cours d’histoire de l’art tenu par un prof avec une vision très personnelle des œuvres. Il nous avait par exemple expliqué qu’à son avis, la Joconde était faite d’albâtre, et que c’était ça qui lui donnait cette mystérieuse lueur intérieure. Malheureusement je ne me souviens pas non plus du nom de ces professeurs.
Et ton mémoire, c’était sur quoi ?
Ça s’appelait Les papiers graset ça parlait du graphisme vernaculaire, des papiers d’emballage de boucherie, boulangerie, tous ces trucs-là. Je l’ai fait avec Margo. Je voulais que ça se passe bien, et elle me donnait confiance. En France, je trouve qu’on a la chance d’avoir toujours ce type de papiers, qu’on ne trouve pas par exemple en Angleterre, où tout est designé. On a une espèce de tradition de papiers qui n’ont été dessinés par personne et qui sont importants dans notre culture visuelle. Alors là, un enseignant a été infect avec moi, dans le jury. Vous savez, à l’époque, quand on avait quinze à son mémoire, l’École le gardait à la bibliothèque, ce dont je me fichais complètement, bien sûr. Sauf qu’ils m’ont mis quatorze trois quart et que ce prof a dit : « C’est bête, hein, on n’est pas allé jusqu’à quinze… ». Mais je suis contente d’avoir fait ce mémoire, ça reste une bonne expérience. J’en ai donné un exemplaire à la bibliothèque Forney, ainsi que toute ma collection de papiers.
C’est un peu violent de te dire ça…
Carrément violent, oui. Mais bon, je suis passée à autre chose, je ne vais pas rester là-dessus toute ma vie. Mon diplôme s’est très mal passé aussi. La moitié de ma classe a échoué, cette année-là. Moi, j’avais proposé comme Grand Projet le site internet de l’École. La présentation s’est plutôt bien déroulée, mais au moment des résultats, je n’ai pas eu mon diplôme. Le jury m’a juste dit « Quand c’est écrit gros, on lit moins bien ». J’ai présenté en septembre une nouvelle version de mon travail, à mon avis plus banale, et j’ai eu mon diplôme… D’ailleurs deux-trois idées qui étaient dans mon Grand Projet ont été reprises plus tard par le site de l’École. C’était vraiment nouveau, il fallait défricher. Il y avait certainement plein de maladresses dans mon travail, je n’étais pas tout à fait à ma place dans cette section, mais j’avais des idées. Je regrette que l’échange avec mes profs ne m’ait pas permis de les mettre davantage en valeur.
Hors du secteur, dans la vie étudiante, est-ce qu’il y avait une sorte d’esprit de communauté, de collectif, et spécifiquement peut-être entre femmes ?
L’esprit de communauté de la vie étudiante, c’est quelque chose qui m’a manqué. La fanfare n’existait pas encore. J’aurais adoré faire ça. On aurait pu se prendre en mains pour monter quelque chose, on ne l’a pas fait. Moi, j’allais avec des copains de l’école d’archi à des fêtes de leur école, avec leur fanfare… Il y a eu quelques projets, quand même, notamment des projets en collaboration avec Normale Sup, auxquels j’ai participé. Ça, c’était vraiment bien, mais il n’y en avait pas suffisamment. On a organisé un défilé de mode de chapeaux avec le styliste Elvis Pompilio. Il y a eu une soirée aussi, toujours à Normale Sup, sur le thème de l’Arche de Noé. On avait fait toute la déco. Mais il n’y avait pas tellement de cohésion de promo.
Et vous êtes entrée en première année ? Vous vous souvenez du concours, comment ça se passait ?
Oui, je suis entrée en première année. J’ai super bien réussi le concours, c’est un bon souvenir. D’ailleurs j’ai une petite anecdote. Comme mon arrière-grand-père est assez connu, quand je suis arrivée devant le jury, pour l’entretien final, ils ont commencé par me parler de lui. Ça m’a énervée, je les ai un peu engueulés, et après, ça s’est très bien passé, on a parlé de mon travail.
À la sortie, est-ce que vous avez eu l’impression d’être défendue par l’École ?
Par l’École ? Non, j’ai juste continué à voir Margo. Par les anciens élèves, oui, parce que j’ai fait un stage grâce à une amie qui était en graphisme et qui m’a fait entrer là où elle bossait. Ensuite, la copine qui était partie en Inde m’a fait venir chez Nathan. Il y avait de l’entraide entre nous.
En tant que femme dans le milieu professionnel, comment se sont passées les premières années ?
C’est un peu particulier parce que je suis une femme et qu’en plus, je travaille beaucoup pour la jeunesse. Je pense que la majorité des problèmes auxquels je suis confrontée aujourd’hui sont liés à ça. Lorsqu’on fait des livres pour enfants, on est avant tout considérée comme une « maman ». Pourtant, je fais mes livres avec mon cerveau, je les revendique comme un travail intellectuel, comme des œuvres. C’est un truc que je ne percevais pas quand j’ai commencé. Parce que j’étais débutante et que je pensais qu’il y aurait une progression naturelle. Maintenant, je me rends compte que c’est très difficile de dépasser ça. Ce n’est pas une question de succès ou de talent. Je gagne très bien ma vie, mes livres marchent bien, mais ce point-là progresse peu. C’est vraiment un problème structurel lié à la littérature jeunesse, de n’être pas prise pleinement au sérieux.
Est-ce que, durant des études, tu as été témoin ou victime de propos ouvertement sexistes ou de violence sexuelle, physique ?
Non, je n’ai pas ce genre de souvenir. Ou alors c’était suffisamment léger pour que je passe outre. C’est possible qu’il y en ait eu et que je ne les ai pas notés. Peut-être que j’ai zappé des choses en pensant que c’était normal, que la vie était comme ça.

Anne-Solange Siret
responsable des périodiques et
gestionnaire de l'informatique documentaire
depuis 2015
avec
Lucile Encrevé
le 12.03.21

- Épanouissement
- Déséquilibres
- Care
- Silence et parole
- Hommage
Entretien de
Anne-Solange Siret
responsable des périodiques et gestionnaire de l'informatique documentaire depuis 2015
le 12.03.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Peux-tu nous présenter ton parcours ?
Mon premier grand rêve était d'être enseignante. Ce qui m'intéressait, c’était le rapport aux autres, à partir de ma formation littéraire – j'ai fait des études de Littérature et civilisation anglaises, jusqu’au niveau de la maîtrise, après une prépa de Lettres modernes : je me souviens avoir eu un cours en Licence sur les mouvements féministes en Angleterre au début du XX
Et quand es-tu arrivée aux Arts Déco ?
Il y a six ans. Je suis arrivée aux Arts Déco dans l'idée d'être dans un service en phase avec la pédagogie, avec le corps enseignant, en contact direct à travers la salle de lecture avec les étudiants. Et puis, j'avais visité les Arts Déco pendant les Portes Ouvertes : j'avais trouvé cet endroit absolument foisonnant, génial, très ouvert, peut-être plus créatif finalement que les Beaux-Arts.
Et là, tu as retrouvé un côté exclusivement féminin propre aux bibliothèques ?
Oui, c’est complètement déséquilibré, on est cinq femmes avec Isabelle [Humbert; responsable de la Matériauthèque] et un homme. Aux Beaux-Arts, il y avait deux hommes sur dix personnes – même si ça a un peu bougé, parce que, comme ici, les équipes ont fondu.
Comment expliques-tu cette forte présence féminine dans ce milieu ?
C'est très ancien. C’est mal payé par rapport au niveau d’étude, pour dire les choses très simplement, mais c'est une réalité. Je fais partie des personnes qui ont un niveau d'études à peu près en adéquation avec le concours. Il y a beaucoup de documentalistes ou de bibliothécaires qui ont un niveau d'études bien supérieur au mien. Ensuite, il y a la sécurité de l’emploi, c’est un cadre très protecteur. Et il y a des connotations culturelles : c'est un travail dans le calme ; les gens qui ne connaissent pas le travail de bibliothécaire pensent qu’on lit des livres, qu’ils nous plaisent et qu’on les met en rayon puis qu’on les propose aux lecteurs… alors que ce n'est pas ça du tout, c’est beaucoup plus technique – il y a des aspects du métier qui sont liés au système de classification de la pensée, de construction de thésaurus, à la gestion de l’information localement et en réseaux.
Et le rapport au public, dans l’écoute, peut être considéré comme genré féminin ?
Je pense, oui, que le travail de bibliothécaire est du côté du care. Ce qui est vraiment intéressant dans notre travail, c'est quand la transmission se fait en proposant des formations, en expliquant une démarche de recherche plus qu’en donnant des ressources bibliographiques toutes prêtes, des informations déjà toutes machées – ce qui est féminin, macher, donner un aliment… même si, souvent, on n'a pas le temps et on donne quand même beaucoup de réponses toutes prêtes. Comme on fait des ateliers d'expression pour les mémoires, pour la rédaction de CV, pour la rédaction de notes d'intention, pour des projets liés à des concours, cela crée des relations humaines très intéressantes avec certains étudiants, je pense par exemple à une étudiante qui venait de Corée et qui avait un rapport au genre assez libre, avec une parole très franche, avec une vision sociale de son pays qui était super intéressante – c'était des conversations très très riches.
Chez les étudiant·es, tu sens un intérêt pour les sujets féministes ou sur le genre ?
Oui, on voit bien ce qu'ils empruntent comme ouvrages. On vient de cataloguer les mémoires de 2020, il y a au moins trois mémoires qui se positionnent vraiment sur l'intersectionnalité. Le fond féministe s’est beaucoup renforcé depuis deux-trois ans et on a créé des outils de tri pour le rendre repérable, des bibliographies ont été faites, disponibles en PDF, suite au groupe de travail pour la charte égalité [fig.44] auquel j’ai participé.
Toi, tu n’as pas vécu de situations délicates dans la bibliothèque ?
Il y a plusieurs degrés de situations. Des mots directement insultants, des gestes directement déplacés : cela m’est arrivé en plein centre de Paris, oui, mais pas à l’École. En deçà, il y a beaucoup de zones floues, car il y a surtout des ressentis et c’est le contexte qui va qualifier les choses, ce que les femmes comprennent plus il me semble (beaucoup d’hommes ne comprennent pas). La plupart des personnes qu’on voit ont des attitudes correctes et ouvertes. Il y a eu un conflit à la bibliothèque, lié à un homme qui a eu un comportement que nous avions perçu comme agressif. Est-ce que c’était sexiste ? C’est possible. Je crois que c'était à la fois ça et autre chose, mais cela a fini par s’apaiser. Je pense qu'il y a des choses à poursuivre sur l'écoute au sein de l'école, en cas de harcèlement, etc… Je ne suis pas sûre que la façon dont c'est mis en place soit assez efficace. On tombe sur le même problème qu'on avait aux Beaux-Arts où une cellule avait été mise en place, mais tenue par des personnes que personne n'osait aller voir. C’est compliqué de savoir qui est la bonne personne pour cette fonction-là. La direction reste quand même dans une communication relativement limitée, ce n'est pas encore assez incitatif.
C’est en train de changer (je l’espère, et que ce projet y participera). Dans les réunions, hors bibliothèque, tu as le sentiment que la parole t’est donnée ?
Au CT [Comité Technique], on pourrait davantage distribuer la parole. C’est le rôle du président – non pas de compartimenter la discussion mais d’ouvrir et de faciliter la parole. Je pense que peut-être, pour une femme, c'est plus difficile de s'imposer là-dedans. Aux Beaux-arts, j’étais dans trois instances et c’était très lourd – j'étais parfois obligée d'être agressive pour m'imposer, par exemple face à un homme qui nous appelait « les souris de la bibliothèque », « les frileuses » ; l'ambiance y était difficile.
Ici, aux Arts Déco, tu sens la structure plutôt comme protectrice ?
Oui, la bibliothèque est une bulle très préservée. On forme une petite équipe et on fonctionne vraiment très bien, on est très solidaire. C'est un territoire aussi à l'intérieur de l'école. Ce qui est positif bien sûr, mais cela pourrait être un piège aussi – on se sent parfois un peu incompris. On a un ancrage dans l’École et dans les réseaux mais on est fragilisé par le sous-effectif…
Y a-t-il des figures importantes de femmes que tu as rencontrées dans l’École ?
Oui, il y en a pas mal ! Il y a Catherine [Geoffroy; ancienne cheffe du Pôle documentaire], très féministe, volontariste, une femme forte, qui défendait la bibliothèque, où elle a développé des espaces différents (le coin travail en groupe, les canapés…). Elle défendait beaucoup l'équipe. Elle nous faisait sortir de nos habitudes. Je garde une admiration pour elle, professionnellement et comme figure, même si on a eu des désaccords. Il y a une prof, Katy Couprie [enseignante depuis 1997], qui a un travail graphique intéressant et qu’on a défendue, quand elle a été mise en cause par la Ville de Paris, pour son Dictionnaire fou du corps [fig.45], banni dans un premier temps des bibliothèques de la Ville – un dictionnaire super bien, qui met les pieds dans le plat, qui appelle un sexe un sexe, un dictionnaire à destination notamment des enfants, sans rien de scabreux : mon collègue s’est empressé de le mettre en évidence ; ça a fait tellement scandale dans le milieu des bibliothécaires, ils ont été obligés de le remettre dans le circuit. Et puis toi ! Tu as enfoncé un « coin » intéressant dans l’École, ça ne plaît pas à tout le monde !
Toi, tes engagements de vie, tes engagements féministes mais aussi le fait que tu chantes, tu en parles aux étudiant·es, avec tes collègues ?
On a beaucoup d'échanges avec mes collègues directs là-dessus. C’est ce que j'apprécie dans l'équipe, on se connaît assez bien. On a beaucoup de différences, et à la fois beaucoup d'atomes crochus, dans nos parcours personnels comme nos activités culturelles en dehors du travail. Ce sont des choses qui nourrissent nos relations aux étudiants. Notre propre expérience amène un plus. Par exemple, le fait de bien connaître la montagne donne une alerte sur le sujet écologique et permet parfois de donner des infos supplémentaires aux étudiants.
Le chant, tu en fais depuis toujours ?
De façon vraiment très travaillée depuis dix ans : en chœur, et aussi en chant lyrique, avec des cours particuliers. Dans les chœurs français, traditionnellement, il y a toujours une majorité de femmes. On a d’ailleurs un chœur féminin qui s'appelle Neska (ce qui veut dire « fille » en basque), on travaille sur un programme de compositrices pour un concert en plein air, début juillet : il y a un chant d’amour de Clara Schumann, très belle compositrice injustement éclipsée par son mari, qui aurait mérité de tenir le haut du pavé; un autre, Peter Pan, d’une compositrice du début du XXe siècle, Amy Beach, qui fait très « comédie musicale »; et des compositrices actuelles. Ce qui est intéressant dans ce chœur, c’est qu’on se réapproprie le programme pour le transmettre, on chante avec notre voix, avec notre tête mais avec notre corps aussi. Le chant, c'est très corporel, très, très corporel, ça demande beaucoup d'engagement physique. C’est à la fois très intime et très puissant. Tu t’exposes. On a l'habitude de parler, on n'a pas forcément l'habitude de chanter. Et quand tu chantes, les autres t’écoutent différemment.

Vonnik Hertig
ancienne étudiante,
enseignante
de 1980 à 1985 et
de 2001 à 2016
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 24.11.20

- Épanouissement
- Déséquilibres
- Mandarinat
- Carrière
- Agissements sexistes
- Directrice
- Écoute
- Écologie
Entretien de
Vonnik Hertig
ancienne étudiante, enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016
le 24.11.20 avec
Lucile Encrevé et
Alexandra Piat
transcription Lucile Encrevé
Cet entretien a été amplifié et fortement modifié suite à sa retranscription, pour être au plus près des souvenirs et ressentis de l’interviewée.
Pour moi, participer à ce projet, c’est un partage, c’est la transmission d’une expérience, c’est donner quelques clefs de compréhension de la vie à l’École. Le sexisme… je ne l’ai pas subi à l’École. Mais j’en ai été témoin et j’ai recueilli de plusieurs femmes des récits qui m’ont outrée et m’ont décidée à agir. J’ai personnellement eu la chance d’enseigner dans un secteur, Design textile et matière [DTM], exemplaire au niveau du respect des genres, à la fois vis-à-vis des enseignants et des élèves. Je dois dire que c’est un coin de paradis à l’École. J’ai aussi enseigné en Design objet [DO] où je n’ai personnellement pas éprouvé de situation d’inégalité des genres. Auprès de vous, j’interviens en tant qu’enseignante et, également, en tant qu’élue du CER [Conseil des Études et de la Recherche] dans les années 2011 à 2014.
Peux-tu nous dire un peu qui tu es ?
Je suis designer couleur, j’ai travaillé dans différents secteurs du design, avec des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des responsables de produits, sur des programmes d’architecture, de design de produits industriels, des domaines de la téléphonie, de l’automobile, sur des programmes de transports urbains, etc… En 1980, je suis arrivée à l’École. Par ailleurs, j’étais salariée dans un bureau de Design Couleur éminent, j’ai candidaté à l’École et j’ai été engagée. J’avais 30 ans. Je suis arrivée pour enseigner la couleur en 1ereannée et en Design textile, un enseignement où il n’y avait quasiment que des enseignants hommes. À l’issue de ce recrutement, nous étions deux femmes, Martine Duris [enseignante de 1980 à 2006] et moi, arrivées en même temps pour intégrer une équipe constituée de cinq à six hommes. Par la suite, le collège des enseignants de la couleur s’est de plus en plus féminisé. J’ai adoré enseigner à l’École que ce soit dans l’enseignement de la couleur en première année, et plus tard en Design textile et matière, et en DO qui pour moi étaient des espaces collégiaux et d’enseignement heureux.
Au départ, tu étais vacataire ?
En 1980, j’étais vacataire. Après, en 1985, je suis partie parce je débutais ma propre activité libérale et je voulais avoir une vie équilibrée entre mon projet professionnel et mon projet de famille, j’ai eu trois enfants, entre 1974 et 1985. J’aimais cette école, les formidables rencontres que l’on faisait avec les élèves et les collègues, la créativité si vivante qui résultait d’une pédagogie très originale. Mais… je voulais voir d’autres mondes, me confronter à d’autres situations, je ne voulais pas rester « ad vitam » à l’École. Je suis partie. On m’a rappelée en 2001 ou 2002. J’ai hésité, car je sais que, au-delà du plaisir que l’on prend à enseigner, on laisse aussi « des plumes » à l’École. C’est une activité, quand on veut bien la mener, qui prend énormément de temps, bien au-delà du contrat. J’ai fini par accepter, et je suis restée de 2001-2002 jusqu’à 2016, année de mon départ en retraite. Je suis devenue contractuelle au bout de deux, trois ans, sur proposition du directeur des études d’alors. À partir de 2007 environ, j’ai exercé la fonction de coordonnatrice des fondamentaux (Couleur, Lumière, Matière, Morphostructure, Perspective). J’ai vu alors comment fonctionnaient les autres secteurs. Ensuite, en 2011, je me suis présentée aux élections, au CER. C’était une période de trois ans, durée du mandat, que j’ai vécue intensément, conjointement avec nos colistiers…
Tu as ressenti la féminisation des équipes par rapport aux années 1980 ?
Pas vraiment. Quand je suis devenue coordinatrice, j’ai constaté que le Collège des coordonnateurs était constitué par une écrasante majorité d’hommes. C’est bien simple… parmi les quelques femmes de ce collège, il y avait la directrice de l’École, la directrice-adjointe et quelques enseignantes [Au premier collège des coordinateurs où est présente V. Hertig, le 8 mars 2011, participaient : Isabelle Guédon, Vonnik Hertig, Kristine Hoyt Jouanne, Sophie Larger, Iris Levasseur et Catherine Strasser]. Tout le reste des membres du Collège des coordonnateurs était des hommes : les coordonnateurs de huit secteurs sur dix (dont un bon nombre d’entre eux installés depuis longtemps dans leur secteur), plus le directeur des études et le directeur de la Recherche. Dans ces postes de responsabilité, il y avait très peu de femmes.
C’est pour cette raison que tu as élaboré ce document que nous a transmis Roxane [Jubert ; enseignante depuis 1997] sur les répartitions hommes/femmes dans les secteurs ?
C’est une des premières choses qu’on avait décidé de faire, à titre d’élu·es car on voyait bien à quel point la conduite de la majorité des secteurs relevait de la domination masculine. Il fallait que nous nous saisissions du sujet de la parité F/H chez les enseignants pour le porter en CER, et en Collège des coordonnateurs puisque j’étais également coordinatrice des enseignements fondamentaux.
Ce document[fig.46] , tu peux nous dire dans quel contexte tu l’as réalisé ?
On voyait que les enseignants qui étaient dans des postes pérennes étaient principalement des hommes. Il sautait aux yeux que la condition de vacataire était réservée majoritairement aux femmes. On trouvait cette situation absolument insupportable. Nous avons demandé à la direction des études et à la direction adjointe s’ils avaient des statistiques sur les statuts des enseignants. C’était en 2013. La directrice a donné son feu vert pour que des données nous soient remises. Je les ai mises en graphiques – emplois pérennes et emplois vacataires – en fonction des différents secteurs. Le visuel du tableau était construit suivant une première ligne constituée de colonnes bleues pour les emplois pérennes (des hommes en très grande majorité) et une seconde ligne constituée de colonnes roses pour les emplois vacataires (une très grande majorité de femmes). Le résultat visuel était instantané, sans appel : la pérennité des postes était réservée à une dominante d’hommes, la précarité des postes était attribuée à une dominante de femmes. La lecture se faisait aussi verticalement par colonnes représentant chacune un secteur, avec, pour chacun d’entre eux, les chiffres totaux des effectifs et le détail hommes/femmes. Les pourcentages obtenus permettaient d’identifier très nettement, au niveau de la parité F/H, les secteurs vertueux et ceux qui posaient de très graves problèmes de traitements inégalitaires.
Dans l’École, tu as assisté à des comportements sexistes ?
Oui, j’ai été témoin de comportements sexistes. J’ai dû intervenir auprès d’un enseignant très influent au sein de son secteur pour qu’il m’explique les raisons de la mise à l’écart des enseignements du secteur, pendant de très nombreuses années, d’une enseignante de la spécialité. Elle enseignait dans d’autres secteurs. Elle était professeure-chercheure, titulaire d’un doctorat et éminente auteure d’un livre pour lequel elle avait reçu prix et distinctions. Malgré ses titres et son très haut niveau de compétence, elle était restée vacataire de longues années, elle n’était pas admise à enseigner dans son secteur de spécialité alors qu’elle avait un parcours d’expertise exemplaire. Elle était « ignorée » par certains de ses collègues masculins les plus dominants du secteur qui ne la saluaient jamais, comme si elle n’existait pas. Comme si elle était transparente. Cet enseignant que j’interrogeais a vaguement répondu ne pas être au courant de cette situation, alors que le caractère arbitraire de cette mise à l’écart était incontestable, vérifiable, et professionnellement préjudiciable à cette enseignante bloquée dans un statut vacataire et empêchée de progression dans son secteur d’expertise. Il m’a dit, toujours vaguement, qu’il allait voir ce qu’il pouvait faire. Je lui ai dit : « Je compte sur toi pour réparer cette injustice ». Et puis en fait, il n’a rien fait du tout. RIEN de RIEN. Alors qu’il était très bien placé dans son secteur pour pouvoir inverser la situation s’il avait voulu le faire… Il n’est pas revenu vers moi. Après mon intervention auprès de cet enseignant, j’ai constaté que rien n’avait changé. Cette situation que plusieurs qualifiaient de « blocage » ou de verrouillage, y compris hors de l’École, par les « hommes forts » du secteur perdurait. J’estime que lorsque l’on rencontre des personnes fragilisées par le sort injuste qui leur est fait à l’École par des collègues, abandonnées dans une solitude psychologique et morale terrible, ne pas dénoncer les graves dysfonctionnements dont on a connaissance, c’est ne pas assister une personne en danger. Que l’on soit enseignant soi-même, ou membre de l’administration. L’excellence des femmes dans un domaine de création traditionnellement maintenu dans une domination masculine est un vrai problème pour des hommes accrochés à leur pouvoir, à leur image et/ou à leur position. Autre situation de comportements sexistes à laquelle j’ai personnellement assisté : en 2013, à la fin du mandat de direction générale de la directrice [Geneviève Gallot, qui a démissionné], lors de la nomination d’un candidat au mandat suivant, j’ai participé à une réunion des élus qui devaient désigner deux des leurs, un homme et une femme, pour assister à l’audition des candidats au ministère de tutelle. Cette réunion était pilotée par la directrice-adjointe. Le nom proposé pour l’élue-déléguée femme a suscité de la part d’élus-hommes des commentaires très méprisants. Des propos si méprisants que la directrice-adjointe qui menait la réunion, très choquée par le sexisme qu’ils exprimaient, a dû intervenir fermement pour les condamner et les faire cesser sur-le-champ. J’ai aussi entendu, de nombreuses fois, de la part d’enseignants hommes des critiques choquantes sur les couleurs des tenues de la directrice, qui s’ajoutaient à celles qui consistaient à lui dénigrer toute compétence à son poste du fait qu’elle n’était « même pas créatrice ». Les différentes sessions de concours d’entrée à l’École étaient d’autres d’occasions dans lesquelles j’ai entendu des remarques sexistes, des remarques méprisantes liées au genre, de la part d’enseignants-hommes, membres de jury, sur le physique des candidates femmes, sur leurs tenues, et sur le niveau de leurs dossiers personnels et/ou de leurs épreuves pratiques. Une collègue enseignante m’a également rapporté avoir participé à plusieurs jurys de pré-sélection de candidats sur dossier. Elle m’a dit avoir été très choquée de remarques sexistes de certains hommes membres du jury à propos des photos des candidates : en gros, certaines avaient un physique avantageux qui les incitait à les convoquer aux épreuves suivantes, d’autres candidates non. Cette enseignante a instantanément dit à ces collègues jurés être très choquée par leurs propos et leur a demandé s’ils seraient contents d’entendre parler ainsi de leurs propres filles si elles étaient à la place de ces candidates.
Ces dérapages, ils n’arrivaient pas au CER ?
Au CER, l’expression de la parole étant publique, elle suivait la règle des échanges « politiquement corrects » officiels qui limite les excès de langage. Selon mes souvenirs, je n’y ai pas entendu de propos sexistes manifestes. Mais, je suis intervenue personnellement en CER sur le sujet du sexisme au moment où un enseignant de l’École s’est vu confier par la directrice la mission de restructurer son secteur pour faire évoluer sa pédagogie. Il est venu présenter son avant-projet. J’ai reparlé de mon tableau rose et bleu, en m’adressant à ce nouveau coordonnateur : « Votre secteur est le secteur le moins égalitaire de l’École sur le plan de la parité H/F. Il est complètement dominé par la testostérone. Faites entrer plus de femmes dans votre corps enseignant ». « Je vais m’attacher à faire diminuer le taux de testostérone », a-il-répondu. La promesse ne fut pas tenue. Le premier recrutement que ce secteur a fait par la suite a abouti à l’engagement… d’un homme.
À quel point vous avez eu une influence ?
En tant qu’élu·es, on a dû aller au contact, nous engager vraiment dans l’action. On a imaginé différents projets, appuyés sur des propositions concrètes. Sur le plan du médiocre résultat final à court terme, on pouvait se dire… « À quoi bon ?». Par contre, sur le plan éthique, la question ne se posait même pas. C’est seulement maintenant, environ six/sept ans plus tard, que nous voyons très progressivement les choses changer en mieux, certaines d’entre elles, sur la parité, convergeant avec nos propositions d’alors.
Tu avais le sentiment d’être écoutée ?
Écouté·es en tant qu’élu·es, oui. Poliment, officiellement. Notre atout, c’était la qualité de notre travail d’élu·es. Et une règle de fonctionnement d’intérêt général. Mais nous étions très peu suivi·es tant les freins, les inerties se sont révélés puissants. Nous dérangions les statu quo.
Tu as senti un soutien des femmes entre elles à cette époque ?
Non. Très peu de femmes sont venues nous voir. Nous encourager. Nous soutenir. Nos appuis étaient très limités.
Tu étais une témoin très active, mais toi, dans ton expérience de femme enseignante, les Arts Déco ont-ils été un lieu d’épanouissement ?
Oui, parce que j’enseignais principalement en Design textile et matière. Les profs de ce secteur, très féminisé, étaient heureux. On traçait ensemble la route de façon solidaire, égalitaire. Et puis, parallèlement, j’avais une activité professionnelle prenante qui me permettait de m’équilibrer entre mes deux activités.
Design textile et matière, c’était un secteur dévalorisé (ou dévalorisant) ?
Il y avait une condescendance ambiante : on était le secteur « chiffon », le secteur « féminin »… Le secteur Design textile et matière faisait des présentation des travaux d’élèves d’une très grande qualité pendant les Portes Ouvertes et attirait chaque année beaucoup de visiteurs et de jeunes candidats. Pour certains observateurs hors du secteur, nous étions un peu les « pom pom girls » de l’École.
Et tu as de bons souvenirs de l’époque où tu étais étudiante ?
Personnellement, pour moi, en tant qu’élève, j’ai de bons souvenirs de l’École. Les études étaient passionnantes. L’École dégageait une énergie contagieuse, une aspiration forte à innover pour changer le monde.
Tu étais dans quel secteur ? Tu avais des profs femmes ?
J’étais en Architecture intérieure. Des femmes profs ? Silence… Dans les enseignements pratiques, et de spécialité, qui étaient les enseignements dominants, mes professeurs étaient principalement des hommes. En Théorie, il y avait une sociologue. C’est la seule enseignante dont je me souviens [Michèle Guenoun, enseignante de 1969 à 2009].
Est-ce qu’il y a quelque chose que tu veux ajouter ?
J’aimerais parler de la transition écologique et des femmes, à l’École, parce que jusqu’à récemment, c’était un sujet qui, apparemment, ne mobilisait pas. Alors, avec Roxane Jubert, et Annabel Vergne [enseignante depuis 2006], nous nous sommes mises à la rédaction d’un manifeste : « Pour une pratique soutenable de la création. Manifeste pour un monde durable. Ensad – Paris ». On s’est dit qu’il y avait urgence, qu’il fallait passer à l’acte sur ce sujet et « amorcer la pompe ». On se voyait à la bibliothèque pour rédiger ce manifeste toutes les trois ensemble. Annabel et Roxane ont rassemblé un groupe autour de ce manifeste et, très vite, nous avons été rejointes par quelques dizaines de personnes à travers l’École. Avec l’aide du personnel, dont j’ai trouvé l’engagement courageux, nous avons diffusé le manifeste en interne à tous les membres de l’École. Un groupe d’étudiantes en a assuré la présentation graphique en assez peu de temps. Le manifeste a recueilli 160 signatures parmi les personnes de l’École. J’ajoute que dans le domaine de la Recherche à l’École, quand j’y intervenais encore, de nombreux groupes étaient placés sous responsabilité masculine et nombre d’entre eux étaient axés sur des questions de technologies, de numérique. Sur les questions de transition écologique, en particulier sur le thème de l’écoconception que portait courageusement Roxane, enseignante-chercheuse de l’École, il lui a été difficile de convaincre l’institution de la pertinence, de l’urgence et de l’enjeu que ces sujets représentaient pour l’École, et précisément pour la Recherche. Elle dût mener un parcours de combattante. Les difficultés, les réticences étaient, de plus, accentuées par le fait qu’alors les sujets de doctorat sur l’écologie, sujets et enjeux hautement sensibles, n’attiraient pas suffisamment de financements de recherche extérieurs. Pour conclure, je dois également clarifier un aspect très important de notre mission d’élu·es du CER : entre autres fonctions, il faut savoir que nous avions une position d’écoute des enseignants qui nous contactaient, et de rapporteurs en instance des difficultés qu’ils rencontraient dans l’exercice de leur enseignement ou dans leur vie à l’École. Difficultés ou impasses qui n’étaient pas réglées/ou ne pouvaient pas être réglées au sein de leur collège ou du Collège des coordonnateurs. Notre mandat d’élu·es nous/me plaçait donc en position privilégiée, de recueillir les témoignages des enseignants en situation problématique dans l’École. L’exercice de ce mandat nous/m’exposait, plus que toutes autres personnes non élues, à avoir connaissance de faits et de situations critiques. Si nos informations convergeaient, nous les communiquions à la direction et, quand c’était possible, nous lui remettions des documents (courriers, pièces). Ce que j’ai personnellement fait auprès de la direction adjointe. Selon mon souvenir, je n’étais pas la seule élue à l’avoir fait. Dans la plupart des cas, notre démarche restait « lettre morte » côté direction (sauf quelques exceptions sur les trois ans de mandat). Notre rôle d’élu était purement consultatif : ce statut était un véritable frein – systémique – à notre action, à l’aboutissement de nos démarches auprès de l’exécutif : nous souhaitions de la part de la direction un traitement juste des situations critiques que nous rapportions. Mais, la plupart des cas n’étaient pas vraiment pris en compte. Du coup, les dysfonctionnements perduraient, même établis et documentés par les élus. Les responsables de ces dysfonctionnements étaient une minorité. L’absence de recadrage des agents à l’origine des problèmes et le silence d’un grand nombre de personnes ne permettaient pas de résoudre ces situations critiques. C’est dire… la difficulté, parfois extrême, à rendre visibles certaines mises à l’écart, certains déséquilibres graves, parfois très graves, froidement installés. Se voir confronté·es à une absence d’écoute alors qu’on est investi·es d’un rôle de porte-parole rendait notre travail d’élu·es parfois difficile. Le chemin à parcourir est probablement encore long, mais des évolutions positives sont en cours depuis cinq/sept ans.

Anonyme G
ancienne étudiante
avec
Alexandra Piat
le 11.12.20

- Milieux sociaux
- Racisme
- Sexisme
- Pouvoir
- Soutien
- Intégration
- Représentation
Entretien de
Anonyme G
ancienne étudiante
le 11.12.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
Tu peux dire « elle », je suis une femme cis [cisgenre, dont l’identité de genre correspond au genre qu’on lui a assigné à la naissance]. Je suis rentrée aux Arts Déco en équivalence en deuxième année de Cinéma d'animation.
Est-ce que tu as des choses à dire spontanément au sujet de comment tu as vécu ton parcours aux Arts Décoratifs en tant que femme, et en tant que femme noire ?
Ça a été très particulier parce que je sortais d'une autre école d’art. Je suis rentrée à un moment où j'étais en période de conscientisation, de déconstruction, sur les questions raciales, je lisais énormément d'articles. Ce n'était pas encore vraiment la période d'Instagram, où toutes les informations étaient hyper accessibles, je pense que les gens étaient moins conscients qu'aujourd'hui. Le premier truc qui m'a marquée aux Arts Déco, ça a été la différence de milieux, c'est-à-dire que les gens de mon école précédente étaient plutôt de milieux moyens. Même si j'étais la seule fille noire de cette classe, il y avait aussi d'autres minorités, les gens qui étaient dans ma classe étaient assez habitués eux-mêmes (en ayant grandi en banlieue, ou dans Paris Est) à voir de la mixité. Donc je n'ai jamais eu trop de problèmes avec ça.
En arrivant aux Arts Déco ça a été encore un autre changement de milieu où, d'un coup je me suis retrouvée avec beaucoup de parisiens, mais pas vraiment des mêmes quartiers de Paris. Aussi, des gens qui venaient d'autres régions où probablement ils n'avaient pas beaucoup fréquenté de personnes noires. Et c'est là que les problèmes ont commencé.
Dans ma classe il y a des gens qui ont commencé à me faire des blagues sur ma couleur de peau et assez régulièrement. Moi je l'explique par le fait qu’ils ont peu fréquenté de noirs. Ils me disaient « Si on fait des blagues c'est qu'on n’a pas de problèmes avec ça ! ». Je répondais que moi, je ne l'acceptais pas et que je ne voulais pas qu'on fasse ces blagues, mais on me disait « J’ai un ami noir, lui ça le fait rire ! ». Et ça a continué pendant longtemps. Les premières années, ça a été assez dur. Avec d'autres potes on pense que la difficulté de s’intégrer venait peut-être de la différence de milieux sociaux, des origines sociales. J'étais encore plus isolée puisque je n'étais pas forcément hyper à l'aise dans ce contexte. Les seules personnes qui me parlaient, faisaient ce genre de blagues. J’avais la chance d’avoir des amies proches dans la classe du dessus.
Ça s'est amélioré au fil des années, je pense qu'il y a eu une grosse rupture quand je suis partie en Erasmus. Les gens ont découvert la vie, l'ouverture et quand je suis revenue, ça s'est amélioré. J'ai aussi noué des liens dans toutes les promos dans ma section. La fin des Arts Déco s'est vachement mieux passé.
Ce rapport un peu complexe, tu l'avais aussi avec les profs ou ça allait ?
Je n’ai pas eu directement de heurts par rapport aux questions de minorité ethnique. Ce que j'ai pu voir, toutes les filles de ma classe pourraient le dire, c'est qu'on avait un prof qui avait fait des blagues sexistes à plusieurs reprises. On était quand même toutes assez remontées contre lui, mais on n’en a pas fait part à l’École. D’ailleurs c'est un truc qui m'avait marquée, que les gens de ma classe puissent reconnaître les trucs qui n'allaient pas dans les attitudes sexistes de ce prof, et qu’ils ne le comprennent pas dans des attitudes racistes chez leurs propres camarades (ou du moins qu’ils n’aient pas envie d’intervenir). Pourtant c'était la même chose, des blagues basées sur des clichés, mettant mal à l’aise la personne visée.
Est-ce qu'on a apposé des clichés ou des attentes particulières sur ton travail, à cause de ton genre ou de tes origines ethniques ?
Pas vraiment. Pour mon film de fin d'études, je ne voulais pas faire un projet sur moi, je savais très bien que si je faisais une famille noire dans mon film par exemple, le public y verrait forcément ma famille même si ce n’était pas le cas. Donc j'avais fait un déplacement ethnique. Je me souviens d'un moodboard que j'avais fait, mes personnages ne l'étaient pas mais un des profs voulait les voir noirs. C'était pas grave mais c'était un petit biais.
Est-ce que dans l'école, tu t'es sentie toujours à l'aise de travailler et d'aller partout, en tant que femme ?
Non. Certains ateliers étaient tenus par des personnes assez malaisantes. J'ai beaucoup évité certains lieux. En fait, souvent les lieux assez techniques. Et à chaque fois, ce n'était pas exactement les mêmes problématiques, mais j'avais l'impression que ça croisait différents trucs. Il y avait un des techniciens qui avait fait des espèces d'avances gênantes à une autre élève.
Je me souviens d'un truc qui m'avait énormément énervée, c'était sur la fin de mon film de fin d'étude. Je m’y suis prise certes une ou deux semaines à l'avance, mais je demande s'il y a des disponibilités dans ce studio. Le technicien m'a dit non d'emblée. Il disait qu'il avait trop de choses à faire, que c'était mort. À ce moment-là, il y a une fille qui passe et qui lui demande la même chose. Et là, ça passe. Je me suis dit : peut-être qu'il la connaît bien. Je l'ai pris comme ça sur le moment : la fille est jolie, donc ça passe. Je ne sais pas…
Je lui ai fait remarquer alors il a fini par accepter, mais après il m'a mis énormément de bâtons dans les roues. Vraiment certains lieux de technique, j'avais l'impression que c'était des lieux toujours détenus par des mecs qui avaient l'impression de pouvoir exercer leur pouvoir au lieu de nous aider.
Alors je sais qu'aux Arts Déco il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas très respectueux avec les techniciens, ça m'avait marquée, mais, beaucoup n'étaient pas avenants.
Tu as eu l'impression de devoir faire des pieds et des mains et argumenter à chaque fois pour pouvoir faire quelque chose de finalement normal ?
Exactement. Vraiment, à chaque fois, je le voyais comme un moyen d'exercer un pouvoir sur les gens. Donc t'es obligée d'être hyper coulant, plus que poli. Je trouve ça très bien la courtoisie et la politesse, mais quand tu dois en être à supplier, non.
Tu as ressenti que tu devais être dans la séduction pour obtenir ce que tu voulais ?
Exactement. Je n’aime pas du tout ce rapport-là donc j’ai complètement évité certains ateliers techniques.
Tous, ou il y en a quand même où tu t'es sentie à l'aise, où tu as été contente d'aller ?
Je suis beaucoup dans une pratique de dessin, donc une table et un crayon ça me suffit. Les salles de la section Animation, c'est un peu mon cocon. J'y ai passé mes quatre ans aux Arts Déco et j'en sortais très rarement. Pour le coup, je trouvais que les techniciens de la section était très sécurisants. J'étais vraiment bien dans ces salles-là.
Dans ta section justement, est-ce que tu as généralement été bien accompagnée, par les profs ou les techniciens, est-ce qu'ils et elles étaient présent·es et t'ont encouragée ?
Alors, clairement, les techniciens de la section oui. Les profs, oui, il y en a. Il y a un prof avec qui j'ai eu des débats et des clashs, mais on parlait vraiment d'animation. On avait des vraies discussions et il m'a beaucoup soutenue même si on n'était pas d'accord. Donc, oui il y avait quand même des éléments de soutien. Il y en a, même après l'école ce sont des gens à qui tu peux parler.
Est-ce qu'il y avait des profs femmes dans ta section ?
Il n'y en avait que deux. Enfin je ne parle que des profs strictement de la section. Sans parler des ateliers ou studios qu'on pouvait avoir. Il y avait Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015], et Florence Miailhe [enseignante de 2001 à 2016]. Florence était là souvent. Je dirais qu'aux Arts Déco les profs étaient assez accessibles et on pouvait nouer des liens avec.
Est-ce que tu as été témoin ou victime, dans le cadre de l'école en général, de propos sexistes ou même de gestes déplacés, etc. ?
Oui témoin, victime pas tellement. Mis à part ce que je te disais sur ce pouvoir des techniciens dans les ateliers. Je ne sais pas comment l'ont vécu les mecs de ma classe, ils n’étaient pas très nombreux, mais en tout cas, ce truc de pouvoir je l'apparente un peu à du sexisme. Ça ce sont les choses plus insidieuses, après des choses frontales je n'en vois pas.
Est-ce que tu dirais que dans l'école, dans ton secteur ou dans ta classe, tu ressentais de la sororité ?
Il y avait de la sororité pour le côté « femmes », en plus c'était l'époque où un fanzine se créait, Les Vulvettes Underground [fanzine féministe né aux Arts Déco en 2016, fondé par Bérénice Motais de Narbonne] [fig.47]. Donc il y a eu quand même des choses qui se sont faites et des gens qui ont commencé à lire de la documentation, à s'informer, des gens qui étaient à différents stades de conscientisation. Ce petit élan a créé quelque chose. En plus, je me souviens le jour où ce fanzine s'est créé, la page Facebook a été lancée, et dans l'instant, le premier commentaire posté c’était, « Les petites pétasses trop bonnes des Arts Déco, se lancent » ou « Les bourgeoises » enfin je ne sais plus, un truc horrible. Après on nous a dit que c'était de l'humour… C'était affreux je trouvais. Le mec s'est dit que c'était un message approprié, de faire de l'humour avec des gens qu'il ne connaît pas, enfin c'était vraiment pire que tout.
Donc il y avait ça. Par contre, sur la question du racisme, rien du tout. Comme j'étais beaucoup sur les questions de racisme, peut-être que j'étais plus attentive à ça qu'à ce qui aurait pu relever du sexisme. Donc en ce qui concerne la sororité, en tant que femme, peut-être. Mais sur le racisme, pas du tout.
Est-ce que tu a cherché ça, un peu de communauté parmi des gens racisés [qui appartiennent à l’un ou plusieurs des groupes sociaux subissant le racisme] ?
Pas du tout, parce qu'on n'était pas nombreux. J’étais la seule fille noire en section animation. Non, je crois qu'on n'était même pas assez nombreux pour faire unité. Là je bosse dans l’animation et il existe des groupes allant dans ce sens dont je fais partie.
Je ne sais pas si il y a cinq ans, on avait les mêmes connaissances qui nous auraient permis de créer des groupes de soutien comme ceux dans lesquels je peux être aujourd'hui. Les gens sont beaucoup plus conscients et plus tôt. Il n’y avait peut-être pas autant d'outils quand j'étais à l'école, on n'avait pas les moyens de se regrouper.
En terme de soutien, il y avait une fille qui était coréenne et ne parlait pas très bien français. Elle est arrivée en équivalence en quatrième année, je suis tout de suite devenue amie avec elle. Au bout de quelques semaines, elle me dit « Merci de me parler. Ça fait six mois que je suis à Paris et tu es la première personne à qui je parle, personne ne m'a adressé la parole avant ». J'ai demandé aux gens pourquoi ils ne lui parlaient pas et ils m'ont dit « Elle ne fait aucun effort, c'est dur de lui parler, elle parle pas très bien français. » Tu parles pas français, on t'ignore…
Toi tu y arrivais, pourquoi les autres n'auraient pas pu…
Moi j'ai pas l'impression que la langue c'est une limite pour communiquer avec quelqu'un. Surtout qu'elle parlait français un minimum, faut pas déconner ! Elle avait des difficultés, il y a des moments où elle avait du mal à dire ce qu'elle voulait, mais il suffisait d'être un peu patient. Même si elle n'avait pas du tout parlé français, je pense qu'on aurait pu trouver un moyen de communiquer. Je trouve ça bizarre d'avoir la flemme de faire l’effort. C'est le même truc qui revenait, quand je suis rentrée à l'école, et que pendant six mois je n'ai parlé à personne, c'était pareil. Je parlais français, donc c'est vraiment la flemme de faire l'effort. C'est un truc d'ouverture qui n'était pas forcément très inné chez eux.
Ça pourrait paraître surprenant, pour une école d'art, où on suppose que la différence devrait être célébrée…
C'est pour ça que je reviens à l'aspect classe sociale, je pense qu'il faut toujours le garder à l'esprit quand on va parler de diversité, particulièrement dans un cadre comme celui des Arts Déco. C'est quand même très blanc, très parisien, très aisé. Ce ne sont pas des gens qui sont habitués à la différence, qu'elle soit sociale, ethnique.
Les gens aux Arts Déco sont peut-être plus originaux, moins classiques, mais ils restent moins classiques, dans une certaine catégorie de personne finalement.
Exactement, c'est ça. En fait, les gens paraissent tous très différents quand tu vas apprendre à les connaître ! J'ai eu un parcours où j'ai fait plein d'écoles différentes. Et à chaque fois, il y avait des types de profils assez différents. Les gens en DMA ne sont pas les mêmes qu'aux Arts Déco.
Est-ce que tu dirais que dans ton expérience aux Arts Déco, tu as plus souvent ressenti le fait d'être une femme noire que d'être une femme tout court ?
Oui, mais je dirais même juste le fait d'être noire, même pas « femme noire ». Il y avait des gens qui voyaient ma couleur avant moi. Une fois, une histoire très bête mais on était avec les gens de ma classe, et chacun se montrait des photos de son frère ou sa sœur. Tout le monde est là « Ah, c'est marrant, il te ressemble, il ne te ressemble pas du tout. Ah ouais, il a tes yeux. » Alors moi, je montre ma photo et là, c'est « Ah tiens ! Ta sœur c'est marrant elle a beaucoup plus l'image qu'on se fait d'une fille des îles que toi. Elle a des caractéristiques moins négroïdes »… Et moi je me demandais pourquoi on parlait de ça déjà, mais en plus de ça tout le propos était problématique. Je lui ai répondu « C'est quoi une fille des îles ? » Parce qu'entre la Réunion, les Antilles, la Polynésie, etc. ce sont des îles très différentes. Donc qu'est ce que c'est que cette image qu’il se faisait ? On est aux quatre coins du globe, quel serait ce portrait uniforme d’une « fille des îles » ? Ce qui était marrant en plus, c'est que le mec avait son filtre, puisqu'il m'a fait toute une théorie, alors qu’en fait ma sœur me ressemble comme deux gouttes d'eau. Seulement sur cette photo, il y avait un flash donc elle paraissait plus claire.
Il n'y a vraiment rien qui va c'est l’horreur… Est-ce que tu as la sensation d'avoir vécu des croisements entre le sexisme et le racisme, par exemple une forme d'exotisation ou des clichés particulièrement attachés aux femmes noires ?
Je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'avais eu un caractère plus explosif. Le truc avec ces clichés, c'est que tu peux te développer en opposition, si tu veux faire le portrait cliché tu peux, mais moi, je n'y répondais pas forcément.
En dehors de tout ça, est-ce que tu as eu globalement une bonne expérience des Arts Déco ? Et est-ce que tu dirais que les Arts Déco t'ont donné confiance en toi et en tes capacités ?
Ça ne m'a pas donné confiance. Je me suis épanouie professionnellement bien après. Le milieu professionnel est très différent. Pendant deux ans j’ai suivi des cours du soir à la mairie de Paris, des cours d'illustration, de bandes dessinées et j'ai une autre expérience encore de l’enseignement. Il y avait des graphistes, designers textile, motion designers à côté de professeurs des écoles, retraités, d’étudiants à la recherche de leur voie ou d’historiens, et de tous âges, tous pays. Là j’appelle ça de la diversité. Ce sont des expériences beaucoup plus valorisantes, et j'y ai gagné énormément en confiance. Aux Arts Déco, si tu ne ressemblais pas à tes profs, c'était très difficile de se comprendre et ils n'étaient pas capables de te soutenir, de te donner confiance et de te pousser au maximum dans ta direction.
Est-ce que dans ta vie professionnelle ensuite, ça s'est mieux passé ? Est-ce que tu as vécu des difficultés particulières du fait d'être une femme ?
J'ai eu une première expérience super. Et puis après, ça a été la catastrophe et effectivement, c'est probablement du fait d'être une femme. Quand j'étais encore étudiante, j'ai essayé le cinéma en prises de vues réelles, j'ai abandonné. Ma pire expérience c'est un plateau de tournage, je ne connaissais pas les codes du cinéma et j'étais complètement naïve là-dessus. Je suis arrivée sur le plateau de tournage habillée comme d'habitude c'est-à-dire t-shirt, jupe. On me présente en faisant le tour de l'équipe, on arrive à un technicien, je lui dis bonjour, il me regarde de haut en bas et il me répond « Très jolie ». Ensuite, on me présente dans l'équipe de déco comme assistante déco et là, un autre technicien a dit « Ça, c'est pour moi ! ». Je lui ai répondu qu'on ne pouvait pas faire ce genre de blagues avec moi, ça l'a calmé, donc il ne m'a pas ré-embêtée contrairement à une autre stagiaire. Je crois que j'ai eu deux expériences comme ça et j'ai arrêté. Je n’y tenais pas plus que ça, mais pour des filles qui veulent vraiment travailler là-dedans c'est une catastrophe.
Est-ce qu'aux Arts Déco tu faisais parfois des travaux engagés, empreints d'une lutte ou de préoccupations politiques quelles qu'elles soient ?
Je lisais beaucoup d'articles, etc., mais je n'étais pas dans la pratique, je voulais plutôt éduquer les gens, mais avec des mots. C'est marrant parce que c'est exactement l'opposé d'aujourd'hui. Dans le discours, je n'essaye plus du tout d'éduquer les gens, par contre, je pense que ce sont les représentations qui sont efficaces. Aujourd'hui, je suis moins dans le discours et plus dans l’action, les représentations.

Anonyme H
ancienne étudiante
avec
Alexandra Piat
le 25.11.20

- Rôles genrés
- Masculinité
- Design for care
- Conscientisation
- Déséquilibres
- Bienveillance
- Manque de collectif
- Silence et parole
- Harcèlements
Entretien de
Anonyme H
ancienne étudiante
le 25.11.20 avec
Alexandra Piat
transcription Alexandra Piat
J’ai vingt-cinq ans. J’ai été diplômée des Arts Décoratifs en Design d’objet. Je suis une femme cisgenre [dont l’identité de genre correspond au genre qu’on lui a assigné à la naissance]. En ce moment je suis en stage. Je m’intéresse de plus en plus au « design for care » c’est à dire un design sensé et sensible qui prône la notion du prendre soin.
Est-ce que par rapport au sujet de notre étude, il y a des choses qui te viennent à l’esprit spontanément ?
Dans le questionnaire [envoyé dans le cadre du projet Chères toutes] j’avais raconté une petite anecdote qui m’avait un petit peu choquée. Au cours d’un projet en troisième année, on m’avait dit que comme j’étais une fille, j’allais faire un projet qui était un peu niais, un peu gentil, pour aider les autres. Je n’en voulais pas du tout à la personne qui me l’a dit mais je ne pensais pas qu’en design et surtout aux Arts Déco, on pouvait encore recevoir ce genre de réflexions. Que l’on fasse du design de fille. Je trouvais que c’était dommage de genrer notre travail. C’est quelque chose que j’ai ressenti un peu après, pas directement dans des mots clairement dits, mais plutôt dans l’écriture des projets. J’ai fait un passage en Textile d’un semestre entre ma quatrième et ma cinquième année, durant une année de césure que j’ai demandée pour pouvoir participer aux cours de deuxième année Textile. L’ambiance n’était pas la même, aussi parce qu’en Textile il y a beaucoup plus de femmes et peu d’hommes. Je trouvais ça plus agréable personnellement, c’était bien plus bienveillant.
La différence que tu as constatée entre le secteur Design textile et le secteur Design objet, à quoi tu l’attribuerais ?
C’est quand même majoritairement féminin en Textile, mais déjà en première année, je me souviens, dans ma promo il y avait plus de femmes que d’hommes. Et on disait en plus que c’était une promo un peu plus équilibrée par rapport aux autres. Je ne trouvais pas nécessaire d’en parler, d’aborder la situation, en fait on ne devrait pas forcément y penser. Et je trouvais qu’il y avait un besoin de surcompenser avec beaucoup de masculinité. Il y avait le « club des hétéros ». Des mecs qui traînaient ensemble et qui s’appelaient comme ça parce qu’ils n’étaient pas gays et qu’ils n’étaient pas des femmes. C’était une blague, mais c’était comme s’ils avaient besoin de se prouver qu’ils étaient des hommes cisgenre. Je trouvais ça un peu nul et pas très moderne. Je n’avais rien dit parce que j’étais assez timide. Ça n’a pas duré très longtemps mais dès le début ça annonçait un peu la couleur. Dans une école qui était quand même assez féminine au niveau des élèves, il y avait déjà ce besoin d’affirmer son genre en tant qu’hommes et qu’il n’y ait pas de doute là-dessus. Dès la première année on te met dans une ambiance d’opposition avec les femmes ou avec les autres identités. En plus en première année, on n’est pas forcément sûrs de son identité, j’imagine. Moi je n’ai pas été blessée, mais je me dis que ça aurait pu blesser des gens.
En Design d’objet je l’ai un peu vu parfois. Comme je disais, des étudiants avec qui je travaillais m’avaient fait des petites réflexions sur un projet, en rapport au design pour les filles et un peu niais. C’était un projet pour des personnes aveugles autour de l’accessibilité et du partage sensoriel. Je voulais proposer de faire une boite de partage dans des musées où ce ne serait pas forcément des personnes spécialisées qui décriraient des œuvres ou des installations, mais le commun des mortels. Ce serait plutôt une boite de partage de sensations où on peut s’enregistrer pendant une minute avec son portable puis déposer son témoignage pour qu’une personne aveugle puisse le récupérer à un endroit. Alors, je dis dans un musée mais ça pourrait être un point de vue, un panorama, etc. Moi je trouve que mon idée n’était pas du tout niaise. Oui, ça parle de sensibilité, ça parle de prendre le temps, ça parle du partage, mais ce n’est pas pour autant féminin et niais.
Au final, ça s’était transformé en un autre projet qui était aussi très intéressant. Complètement à l’opposé du projet que j’avais proposé, mais j’avais joué le jeu et je m’étais adaptée, car j’étais en minorité. On avait fait un vrai truc de bonhomme… Ça avait été super bien reçu par les profs. Mais ça m’a marquée parce que je m’en souviens encore plus de trois ans après.
Tu as la sensation que tu t’es censurée sur ce sujet ?
Non, mais je ressentais un peu que nous, les filles, on devait restreindre nos idées. Les mecs — et c’est des gens que j’apprécie donc je ne dis pas ça pour leur jeter la pierre — mais il y avait un besoin de faire des trucs de mecs, des trucs grands qui vont vers le haut ou des trucs qui prennent de la place avec des matériaux bruts, avec du bois, du béton… Après je me suis plus retrouvée dans des groupes majoritairement féminins. En stage j’avais parlé avec une designer assez célèbre qui commence à gagner beaucoup de prix qui m’avait dit « Les filles designer, il faut se battre ! C’est encore vachement sexiste comme milieu ». Et elle m’avait raconté des histoires qui lui étaient arrivées.
C’est pour ça que quand j’ai vu que vous faisiez ça, je trouvais ça important parce que je pense qu’on a toutes eu des petits moments comme ça où on s’est dit qu’il y avait des choses bizarres. Et le pire, c’est que j’ai mis un temps fou à me rendre compte que ce n’était pas normal. Je n’en ai pas particulièrement souffert, mais ce n’est pas normal que ces mots-là existent et ce n’est pas moderne, pas constructif. Et cela peut nous stigmatiser aussi dans notre travail. Ça me chagrine d’avoir presque commencé à penser que le brut et l’imposant étaient réservés aux hommes et les femmes, nous, on devait faire des petits trucs mignons.
Qu’est-ce qui t’a fait t’en rendre compte plus clairement ?
En parlant et réfléchissant avec des amis, extérieur ou non à l’école. Mais surtout pendant mon échange à l’étranger. Je suis partie en Amérique du Sud, j’ai rencontré des gens géniaux avec qui on a beaucoup parlé de féminité et d’égalité. Avec des hommes notamment, qui m’ont beaucoup appris de choses sur ce sujet. C’est plutôt eux qui m’ont poussée à me poser beaucoup de questions. C’est positif que ça vienne des hommes. Après, en rentrant de mon voyage, je ne me laissais plus faire et les petites réflexions, j’y répondais. Pas méchamment mais je me laissais moins faire. Je suis féministe, mais je suis assez discrète, pour l’instant.
En Design objet quelle est la proportion de profs hommes et femmes et quelle influence ça pouvait avoir sur tes relations avec les profs ?
Comme ça, quand j’y repense, j’aurais tendance à dire qu’il a pas mal d’hommes, peut-être que je me trompe. Mais il y a beaucoup plus d’hommes qui sont là depuis longtemps. Et les femmes sont là depuis moins longtemps, je crois. Dans les ateliers, c’est plus des hommes mais ça me choque moins et au final j’ai un très bon rapport avec les techniciens des ateliers, donc je ne m’en plains pas. Je n’ai pas remarqué beaucoup de différences dans les profs. Les profs femmes allaient peut-être prendre plus de temps, essayaient plus de rentrer dans les sujets, de comprendre. Mais ce n’est pas une généralité. Les deux profs qui m’ont le plus marquée/aidée étaient tous les deux des hommes.
Au sein de groupes masculins tu avais moins d’espace de parole, tu étais moins entendue ?
Peut-être que c’était mon caractère et pas forcément parce que j’étais une femme, mais le fait est que cette petite réflexion m’a marquée, donc peut-être pas.
Pour ton diplôme, tu t’es inscrite dans ce design du care, est-ce que tu dirais que c’est une pratique engagée ?
De plus en plus, c’est assez nouveau pour moi parce que j’ai écrit mon mémoire sur la sensorialité et le handicap et j’ai fait mon diplôme sur le même sujet. J’étais en partenariat avec un hôpital pour enfant à Paris. J’ai rencontré beaucoup de médecins notamment neuro-pédiatres. J’ai commencé à lire Fabienne Brugère L’éthique du care et à écouter des conférences d’écrivains féministes et philosophes qui se questionnent à ce sujet. Il y a toute une dimension assez féministe. Historiquement, le care est attribué à la femme, d’ailleurs parmi beaucoup de designers qui travaillent sur ce sujet, j’ai surtout rencontré des femmes. Après je ne peux pas faire des généralités de mes expériences personnelles. Mais je ne pense pas avoir tort de dire que dans le monde aujourd’hui encore c’est souvent des hommes qui sont en haut de la pyramide, peu importe le domaine. En cuisine d’ailleurs, dans l’imaginaire, on se dit que c’est un truc de femme mais les MOF, les Meilleurs ouvriers de France, c’est souvent des hommes.
Tu parles du fait que toi tu as rencontré principalement des femmes et que tu as travaillé avec un hôpital. Il y a peut-être aussi un lien avec le fait que c’est un hôpital pour enfants, non ? La pédiatrie est souvent vue comme un domaine plus féminin…
Je n’aime pas faire des constats comme ça parce que je me dis que c’est triste, mais le fait est que tous les gens que j’ai rencontrés étaient des femmes. La neuro-pédiatre, l’assistante, l’ergothérapeute d’un institut, la psychomotricienne, que des femmes. Bon, mon directeur de projet dans mon secteur était super intéressé par mon projet, le carefait partie de ses réflexions ; le président de mon jury de diplôme est lui-même un acteur important de la réflexion autour du care en France, donc ce n’est pas un milieu réservé aux femmes. Mais je me souviens qu’au séminaire que je suis allée voir sur le design médical avant mon diplôme — qui a confirmé mon envie de travailler là-dessus — c’était assez féminin au niveau des intervenantes. Mais pourquoi ce serait réservé aux femmes ?
Est-ce que tu trouves qu’à l’école, les profs de ton secteur ou de l’école en général, poussent vers un design plus social, un design du care ?
Oui, je trouve qu’il y a un vrai positionnement qui essaie de se mettre en place. J’ai l’impression que le design d’objet n’est plus là que pour faire des jolis sièges et des jolies tables, si l’on vulgarise grossièrement le design. On nous demande d’avoir une dimension plus profonde, des recherches de matières, des recherches de moyens de production. Ou alors, ce positionnement social avec une volonté d’éduquer, d’aider et d’informer. Ça rentre plus en compte. Et c’est vrai que, même si je ne veux pas faire de généralités, c’était souvent des filles sur ces sujets-là. Je dis filles et garçons parce que globalement dans ma classe, on n’était que des personnes cisgenre, mais je sais que c’est plus complexe que ça.
Cette année, s’il y avait plusieurs projets très ancrés socialement et environnementalement, je crois que je suis une des seules de mon secteur qui ai vraiment fait un projet de diplôme en lien avec le médical. Mais dans les deux dernières années il y avait eu un projet sur l’éducation à l’alimentation pour les enfants, c’était un jeu de société. Mais la promotion de cette année compte beaucoup de projets très ancrés dans cette idée de prendre soin. Après ce n’est pas une généralité, il y a des projets qui ont été faits par des hommes qui sont beaucoup plus axés social et médical. Mais comme ça, ça ne me vient pas en tête.
Est-ce que dans les cours de secteur tu as l’impression qu’on t’a parlé d’artistes, de designers et de penseur·ses de manière assez partagée entre les genres ?
Pas forcément, je dirais que malheureusement, quand on remonte dans l’histoire de l’art, les femmes ont été beaucoup omises. Ce n’est pas forcément la faute d’un enseignement actuel, mais plutôt ce qui découle d’un sexisme plus ancien. Après, je trouve que dans les intervenant·es que faisaient venir les profs en cours, ou dans les rendez-vous du design c’était plutôt partagé, même si je ne les ai pas tous vus. En objet pour les cours de 3D, les cours de dessin technique, les cours de matériaux, je n’ai eu que des enseignants hommes. Mais après, est-ce que c’est le fait que ce soit des hommes qu’on devrait pointer du doigt, ou se demander si leur enseignement on le trouve masculin. En l’occurence non pas particulièrement, je ne trouvais pas qu’il y avait de problèmes là-dessus.
Tu te sentais bien dans les cours d’expression plastique ?
J’avais fait art mural, peinture, céramique… Je me sentais vachement bien. Sébastien en céramique c’est un amour. Giuseppe, en art mural, je trouvais qu’il était assez accessible et qu’il n’y avait pas de problème au niveau de la question du genre.
Par contre dans les ateliers pendant mon diplôme, à un moment j’utilisais des outils lourds dans des positions pas forcément confortables à hauteur de poitrine et avec ma petite taille et mes petits bras, le technicien un peu agacé me faisait remarquer que je galérais. On ne peut pas faire autrement que d’aller plus lentement même si on voit qu’on l’agace. On a des limites physiques et on ne peut pas vraiment y faire grand-chose. J’avais été un peu énervée contre moi parce que j’étais trop lente et je ressentais une pression de voir le technicien qui me surveillait. Je me suis sentie un peu débile et après je me suis dit « Mais en fait c’est pas grave, je connais plein de mecs qui ne sauraient pas faire ce que je suis en train de faire ! »
Est-ce que tu as fait partie de groupes à l’école, comme le BDE ou autre ?
J’ai un peu aidé le BDE pour les soirées. J’ai fait des petites apparitions dans des groupes, genre théâtre, fanfare… mais ça n’a pas duré très longtemps. J’ai vite compris que je ne trouverai pas ce que je cherchais. Je crois que j’étais en recherche de groupe.
Est-ce que tu dirais que l’école t’a apporté de la confiance en toi, en tes compétences ? Est-ce qu’elle t’a enrichie de cette manière ?
Non, pas vraiment. Je dirais plutôt qu’à mon arrivée elle m’en a plutôt démunie. Maintenant ça va très bien. Mais j’étais un peu tombée des nues quand je suis arrivée en première année, je suis tombée sur des profs qui m’ont dit des choses pas très sympathiques, que je n’avais pas ma place ici notamment. C’était un peu plus subtil que ça, mais c’est vrai qu’on m’a dit que j’étais une petite bourgeoise, que mes parents m’avaient payé une prépa hors de prix et que j’étais rentrée là parce que mes parents étaient riches. Je viens d’une banlieue bourgeoise, donc j’étais un peu stigmatisée. Et c’est vrai, je suis une petite bourgeoise ! Je ne vais pas renier mes parents et mon éducation juste parce qu’on me fait des réflexions. Je suis privilégiée comme beaucoup en France, mais ce n’est pas toute mon histoire. J’ai pas mal perdu confiance en moi. Je suis rentrée en voulant aller en Design graphique, finalement, je suis allée en Design d’objet parce que j’avais vraiment envie de profiter des ateliers en volumes. Avant mon échange je ne me sentais vraiment pas à l’aise dans mon secteur. J’ai hésité à changer de secteur, puis finalement, j’ai eu mon échange en Amérique du Sud donc j’ai choisi de partir parce que j’en avais besoin.
Mais ça a été assez difficile parce que pendant très longtemps, j’ai cru que j’étais nulle et que je ne savais rien faire. Je n’avais pas forcément une culture, ce n’était pas mon choix depuis toujours d’être en Design d’objet. J’avais peut-être une culture plus graphique et moins objet, donc j’étais un peu en retard au niveau des connaissances. Les profs nous disaient : « C’est votre responsabilité de dessiner le monde de demain. Il ne faut pas produire pour rien. Il faut penser aux matériaux. Il faut penser à l’utilité, tout ça. Vous devez sauver la planète ». Et par mon histoire personnelle, j’avais besoin de ne pas faire des choses qui sont inutiles et je n’arrivais pas à me positionner, à savoir comment faire. Je ne pense pas que ce soit une question de genre, mais je ne me suis pas sentie trop à ma place pendant longtemps. Ça s’est amélioré avec mon échange et mon mémoire, parce que c’était une très belle expérience pour moi. Je me suis replongée dans mon histoire et je me suis intéressée à quelque chose qui est très, très personnel.
J’ai fait même mon projet de diplôme dessus. Depuis que j’ai commencé à assumer ce qui m’intéressait, ça va beaucoup mieux. Mais comme j’ai une personnalité assez arrangeante, qui ne veut pas déranger, par mon éducation, j’ai un peu du mal avec toutes ces personnes qu’il peut y avoir dans une promo : très présentes ou des profs qui ont de fortes personnalités, très assumées, qui savent vraiment qui ils sont et qui le montrent. En cinquième année, ça a été une année de rencontre puisque j’ai changé de promo et je me suis mieux retrouvée dans celle-ci que dans l’ancienne. J’ai trouvé ma confiance en moi pendant mon échange, avec mes rencontres extérieures, mes projets à côté, au fur et à mesure. J’ai l’impression que c’est une expérience partagée, qu’il y a pas mal de gens qui disent que leurs premières années aux Arts Déco sont difficiles.
Est-ce qu’il y a des personnes à l’école, toutes catégories confondues, par qui tu t’es sentie accompagnée dans ta pratique et dans ton parcours aux Arts Déco ?
Là en cinquième année, il y avait des élèves avec qui j’ai vraiment connecté et on a pu travailler ensemble sur des projets, on s’est accompagnés et aidés pour le projet de diplôme, ça fait du bien. C’est vrai qu’avant je trouvais ça très individualiste donc je suis contente qu’en cinquième année j’ai rencontré des gens qui avaient envie de partager.
En fin de quatrième année j’ai essayé de parler un peu de ce mal-être que je n’arrivais pas trop à expliquer. Je suis très émotive, donc il y a des moments où j’ai craqué devant des profs. Et c’est vrai qu’on voyait ça un peu comme « Ah elle est sensible la petite, elle pleure facilement ! ». Mais c’était plus que ça. Je pense que je n’allais vraiment pas bien, que j’avais besoin d’avoir une discussion sérieuse et qu’on me prenne au sérieux. Qu’on ne voit pas ça juste comme de la sensibilité, mais plutôt comme un mal-être et qu’on m’accompagne un peu. Car ce mal-être provenait surtout de mon doute, de ma place en tant que designer. Mais je me souviens d’un prof, ça m’avait un peu touchée. Il m’avait dit que depuis qu’il me connaissait j’avais un peu perdu mon énergie et que je semblais m’essouffler. Il était inquiet et il m’avait demandé comment on pouvait m’aider. Les autres profs étaient super surpris quand je leur ai dit que je voulais faire une année de césure, que je voulais aller en textile pour les cours techniques et faire des choses différentes. Ils ont dit qu’ils ne savaient pas que je n’étais pas bien en Objet alors que ça faisait deux ans que j’essayais d’une façon ou d’une autre de leur montrer. Je pense qu’on n’avait pas vu ce mal-être dû à ma section, dû à l’enseignement, dû à l’école, dû aussi aux relations sociales de ma promo. C’était des gens que j’aimais bien et avec qui j’étais contente de passer des moments, mais pas avec qui j’ai pu me sentir totalement à l’aise et qui m’ont aidée dans ma construction.
Je me souviens d’un prof de couleur aussi, qui était très gentil, je lui avais dit que j’avais des doutes et il m’a rassurée et m’a dit de ne pas être complexée par mon doute. Il m’a aussi dit que ce n’était pas parce qu’on était sensible qu’on était mauvais designer. Après, comme je voyais que c’était quelqu’un avec qui je me sentais à l’aise et pas jugée, je lui ai demandé si je pouvais faire un stage avec lui.
Parce que pendant ma première expérience de stage, je suis tombée sur un mec qui me faisait des réflexions sexistes. Il bossait chez lui donc je voyais comment il se comportait avec sa femme et je trouvais souvent qu’il n’était pas très correct. C’était un peu triste. Je me suis faite toute une image de lui. Alors que ça faisait une heure que j’avais commencé mon stage, il me dit « t’arrêtes avec tes questions ? ». C’était mon premier stage, j’étais en deuxième année. Grâce à ce stage avec mon prof, ça m’a remis un peu en confiance et après je n’ai eu aucun problème pour trouver des stages. Ils sont supers sympas dans ce studio, il y avait tout un enseignement théorique qui m’a beaucoup rassurée. J’ai lu les bouquins de Johannes Itten. C’était un bon enseignement, j’ai beaucoup aimé.
Il y a certains profs qui étaient très bien, hommes comme femmes, qui ont été assez sensibles et doux. J’ai beaucoup aimé être en textile parce que je trouvais que les profs avaient quelque chose d’agréable. J’avais une amie qui m’avait dit « Tu verras en Textile, c’est des bisounours ». Et c’est vrai. En plus j’ai senti qu’il y avait un vrai suivi des profs, c’était exigeant, il y avait des rendez-vous toutes les semaines avec des professionnels qui venaient juger leur travail.
Est-ce que tu dirais qu’il n’y a pas assez d’esprit de communauté dans l’école, notamment pour les femmes ? Est-ce que tu penses que c’est important ?
Je trouve que ça manque un peu d’assos, de clubs, de choses qu’on peut partager. J’avais fait le club théâtre mais je ne me sentais pas très à l’aise donc j’avais arrêté. J’étais un peu triste de constater que les gens n’avaient pas envie de partager des choses ensemble. Je ne sais pas si c’est parce qu’il y a pas mal de parisiens dans l’école et donc qu’ils ont tous leurs trucs à côté. En tout cas c’est ce que j’ai fait parce que je n’ai pas trouvé de groupe de gens qui avaient envie de partager les mêmes choses que moi. Si, il y a un moment, avec mon groupe de copines de première année, on s’était créé un petit collectif. On avait fait un peu de scéno et puis on a laissé tomber parce qu’on était un peu jeunes et qu’on ne savait pas forcément comment gérer. Ça s’appelait L’édit téton, comme un décret et mais oralement aussi comme une lady et parce qu’on était cinq… donc dix tétons ! Peut-être qu’on était féministes engagées sans s’en rendre compte !
Est-ce que tu as déjà été témoin ou victime de propos sexistes ou d’agressions sexistes ou sexuelles ? Ou de choses qui t’ont mises mal à l’aise ?
Oui. J’ai eu plusieurs expériences négatives, mais récemment une en particulier qui m’a beaucoup blessée. J’ai eu tout le confinement pour y penser. J’avais un ami de l’école, un garçon que je pensais être mon ami et qui a abusé d’une certaine position de faiblesse de ma part. J’étais stressée par mon diplôme et triste suite à une rupture d’une longue relation. Et cet ami, que j’aimais beaucoup, avec qui c’était déjà plus qu’ambigu, a profité du fait que j’étais seule. Moi je lui ai dit que j’avais pas envie de ça et que j’avais juste besoin et envie qu’il soit mon ami. Il ne m’a pas écoutée. Moi dans cette position où je n’étais pas très en forme, je n’ai pas eu la force de le recaler méchamment. Je l’ai recalé plusieurs fois et à la fin je me suis laissée faire parce que j’avais trop peur d’une réaction violente pas physiquement mais plutôt verbalement. Comme j’étais assez fragile à ce moment-là, c’était plus dur. J’en veux beaucoup à cette personne parce que j’ai été honnête avec lui. Je lui ai dit les mots « Je suis en position de faiblesse, n’en abuse pas ». Je pense qu’il ne se rend pas vraiment compte de ce qu’il a fait.
J’ai mis un temps fou à réaliser ce qui s’était passé, quand j’en parle j’ai l’impression que c’est pas grand-chose, mais ça me retourne un peu à chaque fois. Je sais qu’il y a des femmes qui vivent des choses beaucoup plus graves. Mais on m’a blessée. Et le pire c’est que c’était pour son propre amusement et son propre plaisir et que c’était purement égoïste de sa part. C’est vraiment pas bien de faire ça.
En effet, il n’avait pas le droit de faire ça.
Non il n’avait pas le droit de faire ça. Surtout que j’ai été claire à un moment. Et le pire c’est qu’il a justifié ça par des sentiments.
Je me suis dit que c’était fou parce que lui il ne se rend même pas compte. Je l’ai vraiment évité après, je n’ai plus voulu le voir, plus lui parler. Quand je me retrouvais à côté de lui j’essayais d’avoir une copine qui connaissait l’histoire à côté. Et à côté d’une copine justement, j’avais réussi à lui dire qu’il m’avait blessée et qu’il fallait que je lui parle et que je lui explique ce qu’il avait fait. Mais il n’a pas capté qu’il était allé super loin, que ça avait été un énorme forceur et que c’était du harcèlement sexuel.
Quand j’ai réalisé ça, ça a été violent, je ne suis pas traumatisée mais c’est ouf parce que j’en ai parlé à des amis après qui m’ont raconté des histoires elles aussi. Et elles, elles racontaient des trucs parfois encore plus violents, comme si ce n’était rien. Je me suis rendu compte qu’il y a tellement de femmes qui subissent des choses, des petites ou des grandes, et on ne se rend pas compte de la violence que c’est. Les personnes qui sont à l’origine de cette violence, pour certains, ils n’ont pas conscience de ce qu’ils font.
Ce qui est pas mal, c’est que je n’ai pas trop retenu ma parole, j’en ai parlé à mes amies. Parce que j’avais besoin de réaliser ce qui s’était passé. Et je pense que c’est aussi avec les histoires des autres qu’on se rend compte de nos histoires. C’est en parlant qu’on réalise. Moi c’est une amie qui m’a fait réaliser. Et j’ai encore du mal parfois à croire que je ne suis pas la fautive. Et moi je parle facilement des choses qui me touchent, donc ça va. Mais il y a des gens qui n’ont pas développé des capacités pour communiquer facilement et ça doit être difficile. Parce qu’il faut trouver un groupe, une place, pour pouvoir s’exprimer en toute bienveillance.

Catherine Strasser
enseignante
depuis 2003
avec
Lucile Encrevé
le 26.03.21

- Déséquilibres
- Minorité
- Agissements sexistes
- Mandarinat
- Harcèlements
- Homophobie
- Violences
- Directrice
- Sororité
- Silence et parole
- Concours
- Résister
- Relation aux étudiant·es
- Histoire des créatrices
- Intersectionnalité
- Hommage
Entretien de
Catherine Strasser
enseignante depuis 2003
le 26.03.21 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Depuis quand es-tu à l’École ?
J’ai été nommée en 2003, en même temps qu’Elisabeth Ballet [enseignante depuis 2003] et Marc Thébault. Patrick Raynaud, alors directeur [de 2002 à 2008], nous avait donné la mission de repenser le secteur Art/Espace, devenu une quasi-annexe d’Architecture intérieure (les cours formaient principalement à la décoration murale, pour intervenir avec des architectes dans des programmes de type 1%). Patrick Raynaud, le directeur des études et le Conseil des Études et de la Recherche [CER] avaient décidé de réformer le secteur Art/Espace (qui était déjà nommé ainsi) autour de la sculpture et de l’installation, pour rééquilibrer la partie espace/objet dans l’École. Jusqu’à ce moment-là, l’École avait surtout développé des départements très forts dans le domaine de l’image notamment en Design graphique et en vidéo. Nous n’avons pas choisi l’orientation du secteur, nous avons été appelés pour le redéfinir. Et je trouvais ça passionnant.
Avant d’être à l’Ensad, tu étais dans une autre école ?
J’étais, avec Elisabeth Ballet, à l’école des Beaux-Arts de Cergy, où nous avions décidé de travailler ensemble. Et quand on a eu, séparément, la possibilité de venir à l’Ensad, on s’est dit qu’on allait continuer. J’avais commencé à enseigner en école d’art à 26 ans. J’ai été d’abord professeure à Nantes, ensuite je suis partie deux ans à la Villa Médicis. À mon retour, je n’avais pas envie de retourner au même endroit. Le ministère de la Culture m’a alors proposé de travailler à l’inspection des enseignements, ce que j’ai fait pendant plusieurs années, avant de retourner dans l’enseignement, à Cergy.
À partir de ces expériences, comment as-tu trouvé l’École, en arrivant, en tant que femme ?
À Nantes, j’étais la seule femme professeur, mais j’ai eu la chance d’avoir des collègues qui étaient très ouverts et pas machistes, donc ça s’est bien passé, et, ensuite, il y a eu des recrutements féminins. À Cergy, il y avait beaucoup de professeures femmes et, franchement, on n’a jamais senti une discrimination, il y avait une très bonne circulation des échanges, de très bons rapports entre les profs.
Quand je suis arrivée à l’Ensad, j’ai eu l’impression de faire un pas en arrière concernant la place des femmes. J’ai senti une chape de plomb masculine : pratiquement aucune femme à des postes de décision, ni parmi les élus (dans les instances) ni parmi les coordonnateurs. À l’époque, il y avait un seul coordonnateur par secteur et le Collège des coordonnateurs tenait un rôle important dans l’organisation de la pédagogie. Au début, je n’étais pas coordonnatrice. On a travaillé avec une équipe qui était en place auparavant. Au bout d’un an, à part Patrick Jeannes qui partageait nos idées et qui nous a vraiment soutenus en restant, cette équipe n’a pas souhaité continuer à travailler avec nous sur les bases que nous avions soumises au CER et qui avait été acceptées. J’ai été élue coordonnatrice d’Art/Espace fin 2004.
Et là, tu étais l’une des seules femmes enseignantes dans cette position [ainsi lors du premier Collège où elle est présente, le 16 déc. 2004]. On t’écoutait ?
J’étais la seule coordonnatrice. Je me suis fait écouter, mais c’était rude. Arriver comme professeure était déjà difficile, parce qu’il y avait très peu de professeures femmes, l’enseignement était principalement masculin. Et j’ai tout de suite eu des réflexions sur le fait d’être une fille, quelqu’un qui avait une place importante dans l’École m’a dit un jour : « ça fait quand même plaisir de voir des tronches de gonzesses parmi nous. ». Je ne l’ai pas vraiment pris comme un compliment, même si ça partait d’une bonne intention.
Ensuite, j’ai dû beaucoup me battre pour faire accepter nos contenus, pas seulement en tant que femme, mais parce que c’était compliqué de faire accepter la conception de l’art que je défendais. Une sorte de caïdat masculin était en place dans l’École et il n’était pas évident de faire passer à la fois les contenus du projet que j’avais formé avec mes collègues et d’exister comme personne. J’ai donc cumulé deux difficultés, le fait que j’étais une femme et le projet que nous défendions. J’ai connu la double peine, une double bataille à mener. Mais l’expérience la plus pénible, c’étaient les attaques sur ma soi-disant vie privée, tout ce que j’ai pu faire a régulièrement été attribué à des relations, particulièrement intimes, que j’aurais eues avec l’un ou l’autre, et notamment le directeur d’alors, alors même qu’il était un homosexuel revendiqué. J’ai très souvent été suspectée de me servir de ma féminité pour réussir. C’est ce qui m’a le plus pesé, en fait, plus que des remarques ouvertement machistes. J’ai beaucoup souffert de constater que, pour mes interlocuteurs, le mérite ne pourrait venir que de mes supposées intrigues amoureuses. Cela m’a été rapporté fréquemment. Je trouve ce type d’attaques particulièrement sexistes et odieuses.
C’est dingue, tu étais visée dans ta vie privée. C’est épouvantable. Tu parles d’un système de caïdat : qu’entends-tu par-là ?
La réforme de l’École avait été mise en place par quelques très fortes personnalités masculines qui étaient d’ailleurs des personnes tout à fait intéressantes et compétentes professionnellement, mais qui tenaient leurs troupes de façon assez clanique, des bandes s’opposaient en se reconnaissant entre elles mais ne voulaient pas d’autre interlocuteur et encore moins d’une interlocutrice. Le fonctionnement était très masculin, au sens de la répartition des pouvoirs, la reconnaissance des territoires, sans qu’il y ait de porosités ou de possibilités d’allers retours. Et quand tu arrives, tu n’as pas envie d’être recrutée par un club ou par un autre. Il y avait des figures fortes derrière lesquelles se rangeaient des colonnes de professeurs.
J’ai eu la chance d’arriver avec un directeur qui, lui, avait la volonté de féminiser l’équipe et aussi de la rajeunir – il y avait très peu de jeunes profs, il existait de jeunes assistants, généralement des anciens élèves qui travaillaient avec leurs ex-professeurs dans l’espoir de devenir professeurs un jour, dans un système très endogène, aux règles très viriles.
Je le sentais au Collège des coordonnateurs, par exemple, où je suis longtemps restée la seule femme jusqu’à l’arrivée d’une autre coordonnatrice, Isabelle Guédon [enseignante de 2001 à 2013] quelques années plus tard.
Heureusement j’ai été comprise et soutenue par quelques-uns de mes collègues coordonnateurs !
Est-ce que tu as eu l’impression d’une amélioration progressive ?
Oui totalement. Aujourd’hui, j’ai l’impression de ne plus travailler dans la même école ! Elle reste tout de même toujours dure, mais beaucoup moins qu’elle ne l’a été. Les rapports se sont considérablement détendus, fluidifiés, beaucoup de femmes sont arrivées, des femmes avec de fortes personnalités, qui comptent professionnellement, en dehors de l’École. Petit à petit, les choses se sont dénouées, mais ça a été très long. Une autre chose m’a beaucoup choquée : il existait une grande homophobie, qui persiste encore à certains endroits. Cela m’a vraiment, personnellement, beaucoup dérangée car dans ce domaine, tout passe par des remarques, des moqueries, des allusions. J’espère de tout mon cœur que ça n’existe pas au niveau des étudiants et des étudiantes.
Tu faisais partie aussi dès le départ du groupe des Sciences-Humaines. Est-ce que c’était différent ?
C’était pareil. J’étais la seule femme. Très vite après est arrivée Anna Bernagozzi [enseignante depuis 2004] mais on était minoritaires et les rapports étaient extrêmement durs. Il y a eu des moments terriblement difficiles, dont je n’ai pas été la seule à souffrir. Les rapports étaient très violents.
Mais en Art/Espace, c’était équilibré ?
C’était équilibré, chez les étudiants et les enseignants. Et, comme nous étions peu nombreux, nous avons obtenu de pouvoir inviter chaque année un ou une artiste, pour travailler avec les 3e année, dont beaucoup de femmes – Marylène Negro, Marie Denis, Virginie Yassef. Et puis on a fait aussi beaucoup de workshops d’écriture, avec des écrivaines importantes et reconnues comme Chloé Delaume, Gaëlle Obiegly ou Valérie Mréjen. Et il n’y a jamais eu de machisme ou de sexisme à l’intérieur de l’équipe, ce qui m’a beaucoup soutenue. Jean-Luc Blanc est venu nous aider pour la 5e année. Puis on a été rejoint par Alain Declercq. Et ensuite par Kristina Solomoukha [enseignante depuis 2018] et Sarah Tritz [enseignante depuis 2019]. Maintenant, Gérald Petit travaille aussi avec nous. Tout ça s’est fait très fluidement. Il y a une vraie cohésion. Aujourd’hui le département existe, il est reconnu, mais il a fallu attendre longtemps : 18 ans de bataille. C’est le travail qui a payé ; puis notre entente. On m’avait confié une mission et je voulais la mener, quel que soit le temps que ça prendrait, quels que soient les coups que je pourrais recevoir.
Tu as subi des violences (je pense à un groupe qui pouvait menacer physiquement des enseignantes) ?
Il y a eu des menaces voilées, des menaces sont passées par la bande.
Pas de menaces directes ?
Si, mais ce sont des moments qu’il vaut mieux ne pas faire ressurgir. Maintenant, l’École est en paix.
C’était une tension énorme, quand même. Et tes relations avec les responsables d’atelier ?
Étant théoricienne, je n’étais pas la meilleure interlocutrice. Cet aspect-là, je l’ai délégué auprès des profs artistes, parce qu’au départ, les négociations étaient assez délicates.
Avec l’administration et les directions successives, ça a été plus facile ?
Avec l’administration, au début, c’était difficile notamment avec les directions des différents services. Ensuite, je me suis fait respecter, j’ai aussi énormément travaillé et je crois que ce travail a été reconnu. Les directions successives ont peu à peu compté sur nous et avec nous. Aujourd’hui nous construisons un rapport fructueux et confiant avec la direction.
Avec la directrice, tu as senti que c’était différent ?
Non, Geneviève Gallot a dirigé l’École comme un homme l’aurait fait, et ce n’est pas une critique. Mais le fait d’être une femme ne lui a sûrement pas simplifié la vie.
De la solidarité entre femmes, tu en as sentie dans l’École ? Avec Elisabeth Ballet ?
Bien sûr qu’il y a une très grande solidarité avec Elisabeth, une amitié aussi, c’est donc particulier. Cette solidarité, je l’ai sentie, au sein du collège des Sciences-Humaines, qu’on appelle maintenant HTC [Histoire Théorie Critique], où s’est produite une vraie révolution. Ce que l’on vit aujourd’hui par rapport à ce que j’ai connu, c’est le jour et la nuit. L’arrivée de nouvelles enseignantes, de nouveaux enseignants a considérablement changé la donne.
C’était dur de s’exprimer dans ce groupe, avant ?
Chaque fois que j’ouvrais la bouche, j’avais l’impression de recevoir une poubelle sur la tête.
C’est vrai, quand je suis arrivée, je me rappelle de mails très violents, horribles. Des coups de poignard (même s’ils ne me visaient pas). J’en avais le souffle coupé, seule, devant mon ordinateur.
C’était très brutal. Chaque séance se terminait par des injures (et rien n’était décidé). Quand des comportements comme ceux-là se développent, ils ont un effet d’entraînement. Les tensions étaient permanentes. Au départ la personne qui m’a le plus aidée dans ce collège, c’est l’historien de l’art Thierry Chabanne, un grand appui.
Les étudiantes, tu as senti qu’elles ont souffert de ce contexte tendu ?
Elles n’en n’ont pas souffert au sein du secteur Art/Espace. Elles en ont souffert ailleurs, de sexisme, de comportements parfois même brutaux. Oui, certaines sont venues travailler avec nous parce qu’elles n’arrivaient plus à le faire sereinement dans d’autres formations.
Mais aussi des collègues m’ont fait part de brutalités, de menaces qu’elles avaient reçues. Des collègues femmes m’ont dit qu’elles avaient été menacées, notamment au moment des élections, qui fonctionnaient avec des listes dirigées par des hommes ; il y a eu clairement des pressions qui ont été faites sur elles, parfois pire ; quelques femmes m’ont dit avoir été plaquées contre un mur en étant menacées par un homme. Ça me parait hallucinant que ça ait pu avoir lieu. Aujourd’hui c’est inimaginable.
Ce sont des agressions. Tu as déjà assisté directement à des dérapages ?
Ce n’est pas possible, avec moi, de déraper. En étant rapporteure de concours [d’entrée en 1ereannée], il y a une dizaine d’années, j’ai dû séparer un jury physiquement parce que je voyais qu’ils allaient en venir aux mains. La professeure reprochait à son collègue de favoriser une candidate parce qu’elle était mignonne. Et lui, j’ai cru qu’il allait lui taper dessus.
Tu as été la première rapporteure (femme) ?
Oui, je crois, et d’ailleurs tout le monde me disait : « Alors, tu vas être madame la rapporteuse ? ». Margo Rouard [enseignante de 1978 à 2008] avait été présidente aussi, quelques années auparavant.
Dans ce contexte, tu as dû te durcir pour résister ?
J’ai senti que je devais me fabriquer une armure. Mais j’étais motivée par le projet d’Art/Espace d’une part, et d’autre part ça m’intéressait d’être dans une école où il n’y avait pas que des artistes mais également des designers de toutes formes. C’est ce qui m’a fait tenir, aussi : je suis toujours émerveillée par ce qui est produit par les secteurs, par ce que vous faites par exemple en Design textile ou dans d’autres formations.
Avec les étudiantes, est-ce que, étant une femme, tu as l’impression d’apporter quelque chose de spécifique ?
Oui, mais en tant qu’homme on apporte aussi quelque chose de spécifique ! Je pense que dans certaines situations délicates, quand il y a des violences, des maltraitances, les étudiantes parlent plus facilement à une femme. Je l’ai vérifié avec mes collègues femmes, on a toutes ce sentiment. Mais nous avons aussi beaucoup d’étudiants garçons. Et puis ça dépend aussi des interlocuteurs masculins.
Dans tes cours d’histoire de l’art, est-ce que tu es attentive aux femmes artistes ?
J’essaie effectivement d’attirer l’attention sur des artistes femmes qui sont moins connues. Je pense aux générations précédentes, parce que, maintenant, il n’y a plus autant de problèmes de hiérarchie ; une artiste comme Pierrette Bloch, très intéressante, n’a pas la place qu’elle mérite. Et Nil Yalter a été redécouverte à 80 ans !
Si j’organise une publication ou une exposition, je fais très attention à la place des femmes. Très tôt j’ai compris qu’être une femme donnait un handicap, donc j’ai toujours essayé d’être solidaire. J’ai beaucoup travaillé sur des artistes femmes, mais pas exclusivement non plus. J’aime par exemple le travail de Lygia Clark dont j’ai publié les écrits, que j’ai fait traduire. À l’École, j’ai dirigé des mémoires consacrés à des artistes femmes, des mémoires féministes. Une de mes étudiantes, Sophie Pugnet [diplômée 2016], il y a six ans, avait travaillé sur la manière dont une génération de femmes artistes avait réussi à concilier leur vie et leur travail. J’avais moi-même fait un chapitre de mon livre [Du travail de l’art : observation des œuvres et analyse du processus qui les conduit, Paris, Ed. du Regard, 2006] sur ce sujet-là. Elle avait notamment repéré une action à laquelle avait participé Annabel Vergne [enseignante depuis 2006], qui avait performé pour une autre artiste. L’an dernier, j’étais jurée d’un mémoire en Art/Espace qui s’intitule : Aucune excuse ne vous sera présentée [fig.48], un mémoire très, très engagé [de Léonore Camus-Govoroff, dirigé par Kristina Solomoukha, 2020].
Ton cours du jeudi [cours théorique en amphithéâtre que peuvent choisir de suivre tou·tes les étudian·tes de l’École, de la 1ereà la 4e année] a pour sujet l’altérité dans l’art, est-ce que tu relies ce sujet au genre féminin parce qu’ils sont très portés par les femmes, à l’École, ces sujets (ouverts à l’Autre) ? Est-ce que tu la revendiques, cette dimension genrée ?
Mon dernier cours était consacré à Toni Morrison, mais plus que sur la question du genre, sur le racisme et la cause noire aux États-Unis. Pour moi, ce qui compte, c’est ce que je fais plus que ce que je revendique. Je tiens beaucoup à ce que mes actions en tant que personne et que professeure portent mes convictions. Je suis féministe, j’essaie de faire ce à quoi je crois. J’ai travaillé sur l’hospitalité pendant plusieurs années et le cours « Identités/altérités » [« Identités/Altérités, de la représentation de l’Autre à la non-différence »] en est la suite. Je suis en train d’écrire un livre sur l’hospitalité, justement.
À l’École, est-ce qu’il y a des figures de femmes qui ont compté pour toi ?
À mon arrivée, j’ai admiré Margo Rouard qui avait su se faire respecter et reconnaître aussi hors de l’École. Et j’ai une grande affection pour plusieurs personnes qui travaillent dans l’administration. Il y a des femmes formidables dans les équipes non-enseignantes. Pour les profs, c’est ce qui s’est passé avec ta génération et l’arrivée d’un certain nombre de femmes qui ont vraiment beaucoup transformé les relations dans l’École – vous avez apporté plus de dialogue, plus de simplicité, plus d’actions concrètes, mises en place et décidées toujours d’une façon collégiale. Et bien sûr la gouvernance y a aussi contribué.
Mes grandes figures féminines, ce sont les femmes qui ont marqué mon entrée dans l’art. Quand j’étais étudiante (à la fac et à l’école du Louvre), j’ai rencontré des artistes femmes qui ont été déterminantes pour moi, par exemple Lea Lublin, Meret Oppenheim et Gina Pane. Elles m’ont très bien accueillie alors que je n’étais personne, avec le temps ça a créé des liens forts. Léa surtout a beaucoup compté pour moi, elle me manque. C’était une très grande artiste, engagée dans l’art comme dans la vie.

Véronique Massenet
enseignante
depuis 2015
avec
Lucile Encrevé
le 22.12.20

- Accueil
- Double peine
- Sororité
- Silence et parole
- Déséquilibres
- Relation aux étudiant·es
- Histoire des créatrices
- Parler de son travail
- Rôles genrés
Entretien de
Véronique Massenet
enseignante depuis 2015
le 22.12.20 avec
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Cela fait cinq ans que je suis à l’École. À travers mon travail de scénographe d’exposition, je traverse des institutions, mais je n’y reste jamais, donc je croise des milieux de travail avec des problèmes mais comme je n’y reste pas, ça ne me touche que très peu et, même si tu peux être blessée par des remarques, finalement, c’est très fugace. Alors que pour la première fois, effectivement, en arrivant à l’École, je me retrouve dans une institution sur la durée où je suis vraiment au milieu de problèmes ou de bonheurs relationnels. C’est relativement neuf pour moi, et c’est vrai que je me suis retrouvée parfois dans des situations qui me paraissaient complètement abracadabrantes, que je n’avais pas anticipées.
Lesquelles par exemple ?
Par exemple juste après mon recrutement. Un jour, un stagiaire, qui venait des Arts Déco, voulait me montrer un diplôme de l’École. Donc on était sur le site, et je vois une annonce de recrutement, et je clique dessus. Ça s’est fait comme ça : je vois que l’Ensad recrute un enseignant à mi-temps dans le secteur Architecture intérieure (AI), un enseignant qui fasse le lien entre scénographie et design. Moi, jusque-là, je faisais des workshops dans des écoles, donc de façon assez ponctuelle, à Amiens par exemple. Je connaissais quelqu’un qui travaillait à l’École que j’appelle et qui me dit : « Envoie un dossier parce qu’en ce moment, il y a un problème de parité à l’École et c’est bien qu’il y ait des dossiers de femmes qui arrivent » . Il m’a donné une espèce de fenêtre de tir qui était très maigre, mais j’y suis allée, et c’est comme ça que j’ai déposé mon dossier. Donc, je passe l’oral, et je suis retenue, j’étais vraiment super contente. Mais ensuite, ça a été un peu comme une douche froide, je n’ai pas été accueillie dans le secteur, on m’a fait comprendre que je n’étais pas attendue, et cet accueil, ce n’était pas seulement parce que je suis une femme, c’était probablement aussi parce que je ne suis pas architecte. Je suis la seule prof de projets dans ce secteur à ne pas être architecte.
Les femmes ont toujours l’impression qu’elles n’ont pas exactement le bon profil… Mais pourtant, là, c’était le profil demandé, le lien avec la scénographie ?
Oui, et je suis convaincue que les élèves des Arts Déco ne sont pas architectes non plus, et ils ont leur place et leur rôle dans ce métier. On n’est pas censés être tous des enseignants architectes DPLG [diplômés par le gouvernement].
Qui t’a accueillie finalement ?
Pascale [Lion ; enseignante depuis 2006], très bien, et beaucoup Laurent [Godart, enseignant alors responsable de la 1ereannée], parce que j’ai enseigné en première année dès que j’ai démarré. C’est lui qui m’a fait visiter l’École, tout début septembre, mais je pense que je ne connais pas encore tout le monde. J’ai mis du temps à aller au premier étage, parce que je ne savais pas très bien qui était qui, comment articuler les relations administration-enseignement. J’ai mis du temps à passer les portes.
Tu as senti une solidarité féminine dans ton secteur et dans l’École ?
Beaucoup. Je pense que c’est de l’ordre du féminin, effectivement, une solidarité silencieuse, qui n’est pas toujours verbalisée.
Et en 1ereannée, c’était équilibré ?
En première année, c’était très chaleureux. Laurent était à l’écoute, dans le dialogue tout de suite. J’étais dans le groupe de Sophie Larger [enseignante depuis 2002], il y avait une assez belle entente, j’ai le sentiment que c’était équilibré. Ce que j’ai trouvé d’un peu brutal dans le fonctionnement de l’École, c’est que quand tu arrives, tout frais, on te donne des tas de choses à faire et notamment en première année. Tout d’un coup, je me suis retrouvée à piloter les projets de fin d’année. Et c’est vrai que je ne savais pas comment ça marchait. Mais j’ai trouvé chez les uns et les autres de quoi alimenter les projets.
Dans le secteur aussi, tu t’es retrouvée avec des tâches importantes ?
Oui, sans que ce soit discuté. Par exemple, j’ai fait les Portes Ouvertes pendant quatre ans, toute seule. Et j’ai fait beaucoup plus d’heures…
Tu as été dans les instances, aussi ?
Au CER [Conseil des Études et de la Recherche], comme déléguée remplaçante. Je débarquais et j’ai trouvé que c’était difficile de prendre la parole. Il faut vraiment la prendre, il faut arriver à attraper le moment où tu peux la prendre. Toi, tu avais une façon de prendre la parole qui était très claire. Et Roxane [Jubert, enseignante depuis 1997] aussi. Vous avez ouvert des sujets. Il y a certaines situations que pointent les femmes.
Et les jurys de concours ?
Je n’ai jamais fait de jury d’entrée en 1ereannée, je n’ai pas été prise ; je fais le concours de 2eannée. Mais une année j’ai été vice-présidente, c’était Alain Declercq qui était rapporteur, ça s’était très bien passé, même si il y avait vraiment plus d’hommes que de femmes, il y avait Marc Partouche [directeur ; 2014 à 2018] et Julien Bohdanowicz [directeur des études depuis 2017], et, dans le choix des sujets, Bernard Skira, Laurent Godart et François Darrasse [enseignants]. J’ai trouvé que la parole était bien distribuée et bien partagée. Pour le choix du sujet, j’ai été écoutée.
Comme femme, dans l’équipe et auprès des étudiants, tu as l’impression que tu apportes quelque chose de particulier ?
C’est difficile à dire. C’est en grosse majorité des filles. Elles ont plusieurs femmes en face, elles n’ont pas que moi. Moi j’apporte quelque chose qui n’est pas complètement archi, je travaille à une échelle différente. Je fais de la scéno, ça les séduit, cette idée de métier-là. L’année dernière, une étudiante, Armelle Antier, m’a demandé de leur parler des difficultés éventuelles que je pouvais rencontrer, moi, comme femme, dans le travail. Elle avait vraiment envie d’en discuter. Elle a fait son diplôme sur l’intérieur, l’appartement, la chambre, la façon d’habiter la maison, qui s’intitule : « Je voudrais d’un monde où les architectes ne construisent plus. ». C’est quelqu’un d’engagé mais qui voulait avancer de façon douce. C’est dit très subtilement dans son projet, qui s’est fait en concertation : elle a fait tout un boulot de rencontres avec les gens de la résidence dans laquelle elle vit, en partant d’une analyse dessinée de son intérieur pour essayer de comprendre comment les gens habitaient tout le reste de la résidence, une résidence des années 1960.
La concertation, on peut voir ça comme genré, comme féminin…
Oui. Il y a aussi Lucile Cornet-Richard, qui a fait un très beau diplôme sur la question de l’éducation, de l’école, avec une approche très humaniste, centrée sur l’accompagnement des enfants.
Tu leur parles de femmes ? Je pense à Margarete Schütte-Lihotzky…
Oui, bien sûr, j’essaye de faire attention, de plus en plus je dirais – c’est une préoccupation peut-être à laquelle je n’avais pas songé en démarrant. Je leur parle d’Eileen Gray, de Perriand [Charlotte], évidemment, qui avait une liberté d’expression formidable… En scénographie d’exposition, il y a Nathalie Crinière qui est une ancienne de l’Ensad [étudiante de 1988 à 1990], elle a une agence qui tourne bien. Dans les archis, il y a aussi pas mal de femmes qui sont en couple, il y a l’agence Lacaton & Vassal.
Et toi tu leur dis que ton agence, Du & Ma, c’est aussi un couple ?
Oui, je leur dis qu’on s’est connu à l’Ensci [École nationale supérieure de création industrielle], qu’on a fait l’expo « Elles » [elles@centrepompidou. Artistes femmes dans les collections du Musée national d’art moderne, Paris, Centre Pompidou, 27 mai 2009-21 févr. 2011] [fig.49]
Je savais que tu avais fait récemment la très belle exposition « Berthe Morisot » à Orsay [18 juin-22 septembre 2019, Paris, musée d’Orsay], mais « Elles » au Centre, je l’ignorais ! C’est fou ! Tu leur en parles ?
Au début, je n’ai pas tellement parlé de mes projets, je me demandais s’il fallait le faire. Et puis, je pense que, maintenant, ça fait trois ans que je leur présente aussi mon boulot et que je leur explique ce que c’est que ce travail-là. En fait, aujourd’hui, oui, je pense que c’est important d’en parler. « Elles », c’était énorme, 6000 m2 sur les deux étages des collections permanentes, il y avait beaucoup de commissaires, presque que des femmes. L’essentiel de la proposition (scénographique) résidait dans le fait d’avoir déformé les cimaises, les murs du musée en les courbant légèrement, en les découpant pour donner l’idée qu’à l’intérieur des murs se trouvait une richesse qui jusque-là n’avait pas été sortie des réserves. C’est l’idée qu’on soulevait les murs du musée pour faire sortir les œuvres. La couleur était à l’intérieur de ces soulèvements ou alors dans les interstices, les passages. On a découpé aussi les cimaises pour faire sortir la lumière colorée. On a mis du fluo derrière, ça a mis du temps à être accepté. Là-dessus, Camille Morineau [principale commissaire de l’accrochage] nous a vraiment défendus. On a fait à la même époque « Irène Némirovsky » au Mémorial de la Shoah [13 oct. 2010- mars 2011], sur le travail de l’écrivaine, sur son histoire. C’est une belle œuvre.
Au travail, ça te renforce d’être deux ?
Incontestablement. On ne travaille pas forcément sur les mêmes projets en même temps, même si on passe beaucoup de temps à parler des projets autour de cette table [la grande table de la cuisine de l’agence où l’entretien a lieu]. Et il y a des moments où on peut se passer la balle quand par exemple il y a un problème de relation, un changement d’interlocuteur, une interlocutrice, parfois, ça change tout. Sur les chantiers, tu n’as presque que des hommes. Sur les chantiers de scéno, les femmes, elles arrivent au moment du soclage d’objets. Tu as des régisseuses d’œuvres. Toute la partie construction, ça reste très masculin. C’est hallucinant, tu es quand même « la petite dame ». Tu fais moins autorité, ça peut mettre plus de temps pour te faire entendre. Quand on est à deux, souvent ils s’adressent plus facilement à l’homme, pour la partie technique notamment. Après, ça dépend des chantiers, des équipes, ça dépend des relations que tu mets en place avec les entreprises, avec les gens avec qui tu bosses.
À l’Ensci, ton diplôme c’était déjà de la scéno ?
Comme projet de diplôme, je voulais faire un projet pour la Cinémathèque française. J’avais fait déjà une mallette pédagogique pour le Musée d’art moderne. Et je m’étais dit que ce serait super de faire quelque chose pour la Cinémathèque, qui fermait à l’époque. J’avais proposé de faire des dispositifs qui puissent véhiculer l’histoire de la Cinémathèque et présenter les lanternes magiques, tous les objets pré-cinéma, etc. Et là, le directeur de diplôme de l’époque m’avait dit : « Écoute, ce n’est pas de la création industrielle, tu ne peux pas faire ça. Je ne te donne pas le feu vert ». Vexée et énervée, j’étais revenue le voir et je lui avais dit « ok, je vais faire une voiture. Tu me demandes de faire du design industriel, je fais du design industriel ». Il me dit « Non, Véronique, ce n’est pas sérieux, je ne suis pas sûr que tu puisses faire une voiture ». Pourquoi ? Parce que je suis une nana ? Et j’ai fait une caravane, une remorque de vacances, très modulable. L’Ensci, c’était une école de garçons, on était, je pense, 30% de filles à l’époque, le rapprochement avec l’industrie induisait du masculin. Je n’en ai pas souffert, il y avait une très, très grande ouverture, une très, très forte envie de dialoguer. Et puis, à la tête de ce milieu d’hommes, c’était une directrice, Anne-Marie Boutin, qui est restée quand même longtemps, et une équipe de direction qui était très féminine à l’époque, tout était transparent, démocratique, les élèves savaient comment l’école était structurée, c’était dans le projet de l’école, que la directrice a tenu.
Il n’y avait pas de sexisme à l’Ensci ?
Non. Je ne me suis vraiment sentie agressée qu’une fois, au moment où j’ai passé le concours d’entrée. J’étais toute jeune. C’était au moment des oraux. Il y a un entretien où on te fait parler d’un objet et là, tu avais trois personnes dans le jury. Et il y avait un homme, je ne sais pas qui c’est, qui était en lunettes noires, qui était assis les jambes écartées et qui m’enserrait les jambes avec les siennes sous la table. Une situation physique : là, je me suis senti extrêmement agressée. Je me suis reculée. Je l’ai senti vraiment comme une agression. C’était sans doute quelqu’un de l’extérieur, je ne l’ai jamais revu à l’école.

Aurélie Mossé
enseignante
depuis 2012
avec
Lucile Encrevé
en 03.21

- Épanouisssement
- Écologie
- Dévalorisation
- Technologie
- Actions féministes
- Modèle
- Déséquilibres
- Minorité
- Sororité
- Directrice
- Silence et parole
- Âge
Questionnaire de
Aurélie Mossé
enseignante depuis 2012
envoyé en 03.21 à
Lucile Encrevé
Quelle est votre expérience de l’Ensad ? Est-elle à vos yeux liée à votre genre ?
Mon expérience de l’Ensad est de fait en partie liée à mon genre, au moins dans la mesure où j’ai été initialement formée dans une discipline souvent associée et principalement représentée aujourd’hui par des femmes. Un des départements dans lequel j’évolue reste donc largement associé au féminin dans l’inconscient collectif et cela joue dans la perception de ce dernier. Par ailleurs, au sein de l’Ensadlab, j’ai parfois l’impression d’être confortée/soutenue dans ma position parce que je suis une femme jeune avec des compétences spécifiques, encore rares en France.
Avez-vous constaté que des secteurs étaient à l’École moins accueillants que d’autres pour vous en tant que femme ou pour les femmes ?
Les deux principaux départements dans lesquels j’ai pu évoluer en tant qu’enseignante sont bienveillants à l’égard des femmes, non seulement parce que ce sont des femmes qui en constituent la majorité mais aussi parce que les hommes qui en font partie ont un rapport fluide à la féminité, qu’il s’agisse de la leur ou de celles de leurs collègues femmes. En revanche j’ai eu des échos de collègues femmes ou d’étudiantes me faisant part de situations délicates et problématiques à l’égard des femmes dans des départements majoritairement représentés par des hommes, souvent d’âge mûr.
Avez-vous le sentiment qu’on attend de vous à l’École un investissement spécifique liés à votre genre ?
Non pas spécialement.
L’École est-elle un espace qui vous semble différent par rapport au monde extérieur ?
Elle l’est de fait pour moi, au moins dans l’aspect enseignement, puisque mes interactions les plus quotidiennes sont majoritairement féminines. Ce qui ne change guère en revanche c’est le fait que les postes décisionnaires, de pouvoir, sont essentiellement incarnés par des hommes et qu’on y rencontre à l’échelle globale de l’établissement les mêmes enjeux/ disparités de genre que dans la société.
Connaissez-vous des parcours d’anciennes étudiantes, enseignantes, membres du personnel qui vous inspirent ? Investissez-vous les territoires du féminisme/féminin/genre dans vos recherches et vos cours, êtes-vous attentive à la présence des femmes dans les champs de l’art et du design ?
Il n’y a pas spécialement de parcours de femmes à l’Ensad qui m’ont directement inspirée, en partie parce que je n’ai pas été formée à l’Ensad et que cela ne fait pas si longtemps que je suis présente dans l’établissement. Mes modèles féminins sont ailleurs… même si certaines des qualités de mes collègues femmes restent inspirantes.
Je suis sensible au féminisme, aux enjeux de genre mais je ne les ai peu ou pas investis dans mes cours, faute de temps, ayant privilégié d’autres défis comme ceux de l’écologie, du changement climatique. Dans le champ de la recherche néanmoins, si cette question ne fait pas l’objet de mes thématiques de recherche en tant que telle, elle reste très présente. En premier lieu car la recherche par le Design textile souffre d’un déficit de reconnaissance en partie lié au fait que c’est une discipline jeune essentiellement portée par des femmes. Par ailleurs, le champ des textiles intelligents dans lequel j’ai été largement impliquée a permis de mettre en avant le rôle clé des femmes en terme d’innovation/développement technologiques, souvent associées au masculin. Enfin, j’ai été formée à l’étranger par une des premières générations de femmes chercheures en design qui ont à cœur de soutenir/promouvoir des modèles de femmes chercheures. Je porte une attention particulière par exemple en terme de mixité de genre dans les recrutements, le choix des intervenants lors de conférences etc. Et j’ai conscience que par mon propre cheminement assez singulier je peux inspirer d’autres femmes à persévérer dans des domaines où elles sont encore trop peu présentes. On m’a d’ailleurs récemment proposée de rejoindre le comité consultatif de Shemakes.eu, un projet de recherche européen sur deux ans porté par TCBL-CEDECS et qui a pour but de faire émerger, de valoriser des profils de femmes innovatrices dans le champ de la mode durable.
Vous êtes-vous sentie en minorité dans votre secteur/espace de travail ou lors de réunions/commissions/jurys ? Y a-t-il eu une évolution au cours de votre carrière ?
Enseignant dans un département principalement féminin, le problème se pose de manière inverse, la présence masculine tant au niveau des enseignants que des étudiants est rare voire absente dans un certain nombre de promotions étudiantes. Cette situation est contrebalancée par ma position de chercheure au sein de l’Ensadlab, où les femmes sont minoritaires dans les positions d’encadrant·es. Cela me frappe particulièrement lors des jurys de recrutement, où je suis parfois la seule femme. Aussi parce que les femmes y occupent les postes les moins hiérarchiques.
Pensez-vous que travailler dans vos équipes avec d’autres femmes est un atout ? Pourquoi ?
Travailler avec d’autres femmes rend souvent plus facile le fait d’épanouir sa propre féminité, d’en faire une force au travail mais c’est aussi vrai de certains hommes qui comprennent bien les enjeux de genre. Les femmes sont aussi souvent plus à l’écoute des aspects sensibles/émotionnels qui sont parfois mis de côté dans ce contexte. Ceci étant dit, ce qui est véritablement un atout pour moi c’est de privilégier des équipes mixtes où sensibilités féminine et masculine se trouvent à l’équilibre, qu’elles soient respectivement incarnées par des hommes ou par des femmes car dans certaines situations n’être entourée que de femmes peut aussi être un inconvénient (au même titre que de n’être entourée que d’hommes).
Une direction masculine entraîne-t-elle des relations spécifiques ? L’arrivée de femmes à des postes de direction a-t-elle entraîné des changements pour vous ?
Je dois mon recrutement à une femme, une des rares ou seules directrice femme de l’Ensad je crois à ce jour, même si je pense que cela n’avait pas de rapport avec mon genre et que son approche de la direction ne m’a pas paru induire de changements particuliers, celle-ci s’inscrivant, du peu que j’ai pu en percevoir, dans un modèle de direction assis sur des valeurs dites plutôt masculines. Depuis, les postes clés de direction qui me concernent le plus directement (direction des études, de la recherche, direction de l’école) restent dans les mains des hommes. Pour avoir évolué dans d’autres contextes à l’étranger où des femmes étaient en position de direction, il me semble que cela induit des différences notables, en premier lieu une considération plus grande et plus empathique des individus, qui sont davantage appréhendés dans leur singularité, sensibilité, que comme rouages d’un système ; une prise en compte plus notable aussi de l’importance de l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle et dans les deux contextes précis qui m’ont concernée, un sens aigu de soutenir/promouvoir des modèles féminins à des postes stratégiques. Néanmoins, il faut souligner que la direction actuelle est beaucoup plus consciente que par le passé des enjeux de genre (une question de génération, de conjecture temporelle sans doute) et plus à l’écoute que les précédentes, même s’il reste encore une marge d’évolution certaine.
Lors des réunions ou de discussions à l’École, votre parole est-elle entendue à l’égal de celle d’un homme ?
Je constate que la prise de parole des femmes et le respect de celle-ci restent encore bien souvent compliqués. Dans certaines situations hiérarchiques ou lors de discussions collégiales notamment, je n’ai pas toujours l’impression d’être entendue, ni même d’arriver à pouvoir m’exprimer pleinement parce que certains hommes s’accaparent l’espace de discussion, ne sont pas sensibles à l’équilibre/partage de la parole.
Avez-vous déjà eu la sensation que l’on répondait positivement à vos demandes, parce que vous étiez une femme ?
Non, à une exception près peut-être (dans un service précis).
Les étudiant·es vous considèrent-ils/elles à l’égal d’un homme ?
Je pense que oui mais je n’ai pas vraiment d’éléments de comparaison et nous n’en avons pas discuté.
Avez-vous été victime à l’École d’un sexisme bienveillant ?
Oui, plus par le passé qu’aujourd’hui. Une forme de sexisme assez paternaliste, en particulier liée à mon âge, au fait que j’ai commencé à enseigner jeune et où la différence d’âge était beaucoup plus importante avec mes collègues qu’avec mes étudiants. Certains m’assimilaient de fait à une étudiante, d’autres me saluaient en me disant mademoiselle plutôt que madame, d’autres développaient une forme de galanterie systématique pour sortir de l’ascenseur, tenir une porte alors que j’avais émis le souhait de pouvoir procéder à la réciproque de temps à autre. Des sourires condescendants aussi.
Avez-vous été l’objet de remarques sexistes ou de traits d’humour déplacés liés à votre genre ?
Peut-être par le passé en terme de traits d’humour déplacé. La mémoire me fait défaut. Pas dans un passé proche en tous les cas.
Avez-vous été victime au sein de l’École d’agressions liées à votre genre ?
Non, pas au sein de l’Ensad. En revanche, comme beaucoup trop de femmes en France (mon expérience au Danemark et en Angleterre est très contrastée à cet égard), j’ai subi des formes d’harcèlement ou d’agression liés au genre, dans la rue, les transports en commun, notamment dans ma jeunesse et encore relativement récemment dans un contexte professionnel autre dominé par le masculin.[fig.50]

Françoise Roy
enseignante
depuis 1989
avec
Lucile Encrevé
le 29.03.21

- Épanouissement
- Mandarinat
Texte de
Françoise Roy
enseignante depuis 1989
envoyé le 29.03.21 à
Lucile Encrevé
transcription Lucile Encrevé
Ce texte a été envoyé suite à une conversation téléphonique et à l’envoi du questionnaire.
Je suis rentrée à l’Ensad en 1989 en tant qu’enseignante vacataire. Il y avait déjà des femmes enseignantes, certes en minorité, mais qui avaient de l’autorité en réunion et de l’ampleur au regard de leur expérience professionnelle. Geneviève Dupeux [enseignante de 1975 à 1985], Kristina Ballaban [enseignante de 1970 à 1998], Françoise Darne [enseignante de 1991 à 2008], Mireille Miailhe [enseignante de 1980 à 1986], Vonnik Hertig [enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016], Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015].
Lors des réunions, certes les hommes étaient en majorité mais une certaine bienveillance existait, les relations entre les enseignants étaient cordiales. Les réunions de rentrée en octobre ressemblaient à une fête pour toutes et tous. Des alliances pour des projets pédagogiques naissaient entre deux conversations avec de joyeux enthousiasmes.
Mais il y a eu un changement qui s’est mis en place, peut-être lié à l’évolution de la société et donc aussi à celle de l’Ensad.
L’administration de l’École s’est développée, on entrait dans le monde du résultat, de l’exposition de projet et du bon de commande contresigné par xx agent… Le tableau XL validait nos demandes. L’École devenait propre, les élèves devaient respecter les lieux qui ne ressemblaient plus à ceux d’une école d’art que nous, enseignants, avions connue.
À ce moment-là, ceux qui ont pris les manettes des secteurs avaient compris comment manœuvrer, c’étaient effectivement des hommes avec qui la discussion est devenue difficile voire impossible. Ces prises de pouvoir étaient masculines, sans ampleur professionnelle bien établie pour certains d’entre eux.
De mon expérience professionnelle en tant que femme à l’Ensad, je peux avouer qu’autant d’hommes que de femmes m’ont égratignée, certaines d’entre elles avec une virulence inégalée que je n’ai rencontrée nulle part ailleurs. À une certaine époque, la peur de venir travailler à l’Ensad était bien réelle, elle était liée à la direction.

Françoise Darne
enseignante
de 1991 à 2008
avec
Lucile Encrevé
Alexandra Piat
le 23.11.20

- Rôles genrés
- Double peine
- Résister
- Sororité
- Minorité
- Concours
Texte de
Françoise Darne
enseignante de 1991 à 2008
envoyé le 23.11.21 à
Lucile Encrevé
En 1966, lorsque j’ai signé mon premier « décor et costume » (le terme scénographie n’était pas encore habituel en France) les « décorateurs », donc, étaient masculins à quelques rares exceptions près. Tout comme les metteurs en scènes, directeurs, administrateurs, constructeurs, techniciens ; n’étaient féminines que les costumières, habilleuses et… secrétaires. Autre temps !
En 1991, lorsque Richard Peduzzi, directeur des Arts Déco [de 1990 à 2002], m’a imposée dans la section « scénographie » dirigée par Jacques Le Marquet, si je n’étais vraiment pas la bienvenue, ce n’était pas principalement une question de genre. C’est que j’étais, et professionnelle, et du théâtre. On m’a bien fait sentir que c’était en opposition radicale avec la politique de leur section. Sauf que, professionnellement justement, j’avais acquis l’expérience d’une femme en milieu masculin, avec, régulièrement, l’obligation de prouver capacités et compétences et de « résister » !
Puis Guy-Claude François (grand scénographe reconnu) a pris la direction de la section. Il a réussi à mettre en place un cursus professionnalisant, en multipliant les ateliers expérimentaux, pour couvrir le champ d’une scénographie élargie, ce, en connaissance de cause. Chacun, chacune y avait sa place, sa responsabilité.
Dans l’atelier dont j’étais responsable, j’ai fait intervenir des professeurs de l’école, et, surtout, des femmes professionnelles en activité : éclairagiste, dramaturge, costumière, extérieures à l’école, plus stimulantes dans une section d’étudiants en majorité féminines !
Seule femme en scénographie, et souvent aussi, seule femme dans les divers jurys auxquels j’étais nommée, j’ai été plutôt étonnée de « l’indulgence » masculine envers certaines candidates, un avis contraire de ma part était alors difficilement reçu.
À l’époque, la direction technique et la brigade d’hommes des services d’entretien étaient dirigées par des femmes.

Témoignages
recoltés par
Lucile Encrevé

- Enfants
- Déséquilibres
- Féminisme
- Numérique
- Âge
- Carrière
- Agissements sexistes
- Technologie
- Écoute
- Vêtements
- Double peine
- Contournements
- Aura masculine
- Concours
- Racisme
- Silence et parole
Témoignages
anonymisés à leur demande, d’enseignantes, anciennes étudiantes et membres du personnel, qui souhaitent ne pas être reconnues
Nota bene
Ces extraits sont issus d’entretiens retranscrits (présents sur le site ou non publiés) et de réponses à un questionnaire transmises par écrit, récoltés par Lucile Encrevé. Ces paroles, confiées, nous les croyons toutes — elles n’établissent cependant pas des faits et doivent être reçues comme des ressentis et points de vue subjectifs. Les thématiques pour organiser l’ensemble ont été choisies parmi les sujets récurrents dans l’ensemble des entretiens.
Épanouissement dans l’École (égalité, confort et empowerment)
Le secteur Design objet a toujours eu une attitude respectueuse et égalitaire à l’égard des femmes enseignantes ou élèves. Mes collègues ont une attitude agréable à l’égard des femmes.
Il me semble que le fait d’être une femme a été un atout : alors que le groupe dans lequel j’intervenais ne fonctionnait pas bien, ma présence a été ressentie de façon douce et a permis de réunir l’équipe. C’est comme s’il manquait juste un petit liant et que mon sens de l’organisation était bienvenue ! Je sens que le fait d’être une femme apporte une sensibilité et un accompagnement différent et complémentaire.
J’ai (très bien) vécu une grossesse en enseignant à l’école, Emmanuel Fessy notamment avait régulièrement un mot gentil à cet endroit.
Les cours de perspective, et de morphostructure en particulier, m’ont particulièrement construite, contre les stéréotypes de genre. C’était pour moi une chance énorme, inouïe, que de nous (femmes) donner accès à cette réflexion sur le volume et la matière, de nous former sur les outils, les machines, notamment dans ce petit atelier bois et morpho qui existait alors à Ivry-sur-Seine. Les enseignants et techniciens d’alors nous ont beaucoup apporté, sans distinction de genre. Ces savoir-faire m’ont été très utiles professionnellement mais surtout personnellement. Savoir construire un meuble, concevoir un mécanisme, s’autoriser à le penser, à passer à grande échelle. Je crois que je dois à ces enseignements une grande liberté d’action (dans le bricolage, pour simplifier), et que je tire une forme de pouvoir, de puissance émancipatrice même, à ces capacités (traditionnellement attribuées aux hommes) en tant que femme. Je peux m’adresser à un vendeur de Leroy Merlin sans m’excuser de ne rien y connaitre. Je sais le caractère rare de ces compétences chez les femmes de notre génération, aussi je suis extrêmement reconnaissante à l’École pour cette initiation, cette mise en confiance, cette forme d’autorisation, en particulier.
Relations aux étudiant·es – une attention spécifique ?
Je pense que ma présence rassure les étudiantes, lors de rendus par exemple ou lors de présentations en début d’année, dans ces moments c’est assez frappant de voir une équipe constituée majoritairement par des hommes, certains agissant de manière absolument cavalière (ce qui ressort de manière frappante lors des réunions de secteur).
En tant que référente (et mère) je sens bien que j’aborde différemment l’accompagnement des élèves. Je suis très à l’écoute de leur état moral. J’y accorde beaucoup d’importance.
Comme enseignante, je tente de donner la parole aux plus silencieux·se·s. J’observe que cette discrétion est souvent corrélée à une envie d’apprendre, que l’on continue de taire par pudeur, ou peur d’un jugement. Je ressens que mon genre, et peut-être une apparence de fait plutôt juvénile aident certaines étudiantes à poser des questions, à échanger, que cela soit sur le contenu du cours ou sur l’École, ou en général. Assez naturellement et positivement, je me sens en charge d’une présence affective qui dépasse le simple cadre des enseignements qui seraient « à dispenser ». Le côté maternant par exemple n’est jamais formulé (demandé), mais il est vrai que je m’impose un certain suivi des élèves, le fait de m’enquérir de leurs conditions de vie par exemple. Je me questionne parfois, est-ce que cette posture bienveillante, le fait d’être à distance sans être au-dessus, ne m’empêche pas.
J’essaie de promouvoir aujourd’hui auprès des étudiant·es une culture et pensée féministes, cela me semble important. Je ne force pas ces échanges, mais j’aime bien laisser cette porte ouverte, en glissant par ici une allusion, ou en laissant trainer par là un livre, cela permet à qui le souhaite de revenir, et poursuivre les échanges.
Dans les anciennes étudiantes j’estime beaucoup Sarah Garcin [designeuse graphique travaillant au sein de l’Atelier des Chercheurs], qui a des grandes compétences dans le domaine du design numérique et a largement contribué à démonter les clichés sur le rapport entre femmes et nouvelles technologies.
Je me laisse inspirer par d’anciennes élèves, dont j’apprécie la pensée, la façon d’être au monde, la grande ouverture, et le respect, la curiosité mutuels. Je pense en particulier à Félicie Parent [diplômée 2019], qui est – il me semble – une vraie figure féministe et fédératrice de l’École ces dernières années.
Sororité – mise en avant aujourd’hui par les étudiantes, elle n’a pas toujours été ressentie par les autres actrices de l’École ; un groupe « égalité », constitué suite à la rédaction de la Charte de l’Ensad pour l’égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle, travaille pour améliorer la place et le bien-être des femmes dans l’École [fig.51].
Je regarde avec admiration ces femmes qui sont dans l’École depuis longtemps et pour lesquelles les choses n’ont pas dû être faciles (exemple : Catherine Strasser [enseignante depuis 2003])
Les femmes font bien plus souvent preuve de solidarité, écoute, et générosité que les collègues hommes. Dans ma carrière j’ai la plupart du temps formé des binômes avec des femmes ou j’ai été dirigée par des femmes, ce qui m’a permis de bénéficier de véritables relations de respect et écoute (alors que les hommes sont souvent dans des jeux de séduction ou de mépris).
Nous sommes dans le secteur plusieurs femmes avec des tempéraments assez différents. Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues masculins alors que je n’ai pas eu la possibilité de travailler avec mes collègues femmes. J’avais pourtant proposé à l’une d’entre elles !
J’apprécie aussi de pouvoir travailler auprès de personnes très humbles, qui sont dans l’idée d’une communauté de partage (l’École comme un creuset), et qui peuvent offrir aussi beaucoup, je pense à Nicolas Nemitz notamment, qui partage volontiers ses connaissances, son temps, sachant que cela sera réinvesti auprès des élèves. Cette générosité me touche et fait vivre ce concept d’« École ».
Je trouve dans l’équipe de mon secteur des hommes sensibles à ces enjeux d’équilibres hommes/femmes qui se montrent fortement à l’écoute des questions d’égalité. Mais cela se vérifie plus dans les « discours » que dans les actions.
Espaces – considérés souvent comme peu genrés, ils restent pour certains liés à des secteurs ou des ateliers confrontés à des problèmes de sexisme ; alors que deux amphithéâtres portent des noms d’hommes, la Rotonde, espace d’exposition, a été en 2019 nommée « Rotonde Rosa Bonheur », du nom d’une des directrices de l’École (et artiste célèbre).
Pendant toutes les années où je me suis trouvée entièrement hors de mon secteur, je ne suis jamais allée dans les espaces de ce secteur en dehors des Portes Ouvertes, où j’allais toujours accompagnée. J’ai appris a posteriori que je n’avais pas été la seule en ce cas : on était plusieurs à ne plus mettre les pieds dans ces espaces. Quand j’ai réintégré mon secteur, j’ai commencé à enseigner dans des salles que je ne connaissais pas du tout.
Les toilettes ont bien évolué depuis Ivry-sur-Seine. À quelques exceptions près, liées à des erreurs de conception des locaux (pas d’éviers par exemple en salle de 1ereannée donc souvent bouchées par du plâtre, ou autre), je trouve les toilettes de l’Ensad particulièrement propres et bien entretenues, et qui permettent l’intimité nécessaire. Sans du tout avoir suivi les débats ou discussions qui y ont nécessairement été associés, je me souviens d’une grande joie lorsque j’y ai découvert un distributeur gratuit de protections périodiques [plusieurs distributeurs ont été installés dans l’École depuis 2019, à la demande du groupe « égalité », sur une idée de Pauline Dragon, scénographe, diplômée 2019, avec l’appui des syndicats et du CHSCT]. Et, dans un deuxième temps, de la déception associée puisque je ne l’ai connu que vide depuis sa découverte. Par opposition, je ne suis pas revenue des conditions d’hygiène déplorables auxquelles les étudiant·es doivent faire face à la fac. Je souligne ce point positif aux Arts Déco car il fait partie de nos vies de femmes, il fait partie du contexte de ce lieu. J’ai notamment vécu une fausse couche très douloureuse qui est survenue dans les locaux, et n’ose pas imaginer ce moment si je n’avais pas pu m’allonger aux toilettes.
Du côté des étudiants, je me souviens en particulier d’un élève qui taguait sa signature absolument partout, à tous les étages, et aux toilettes en particulier. Cette omniprésence, ce marquage de territoire m’oppressait. Ce garçon était chez lui partout, et en quelques sorte on ne pouvait être seule/sans lui/chez soi nulle part.
Carrière – plusieurs femmes ont témoigné de leurs difficultés à progresser professionnellement, et ont notamment jusqu’à récemment été nombreuses à demeurer vacataires durant des années, ce qui fait aujourd’hui l’objet d’une vigilance particulière de la part des syndicats.
Ce qui est évident est qu’on a l’impression d’avoir moins de possibilités d’évolution de carrière et que dans notre parcours ne sont pas pris en compte à la hauteur de nos attentes des arrêts ou obligations liés à une grossesse ou la garde d’enfants ou encore des problèmes de santé particuliers (conséquences d’un avortement, fausse couche, cancer du sein…). Comme si c’était tabou de parler de ce qui fait la vie d’une femme dans ce milieu professionnel et pourtant on est tout autant des enseignantes que des mères et des amantes… c’est ce qui fait notre personnalité et sensibilité.
Je me souviens avoir été arrêtée une semaine durant ma grossesse, et que le cours correspondant avait été déduit de mon salaire. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est dommageable, et je pense lié à mon statut de vacataire.
Je ne sais pas si beaucoup d’hommes sont vacataires. L’École nous demande beaucoup de temps, d’attention aux élèves, d’investissement, de présence à des réunions, tout en nous envoyant le signal que nous sommes extérieur·es à l’École, les dernier·es servi·es dans les emplois du temps pour positionner les cours, les premiers cours à sauter… Sans pouvoir le justifier, je n’arrive pas à décorréler ce statut du fait que je suis une femme. Pour bien connaitre les deux, et parce qu’à l’Ensad le sexisme est – de mon point de vue – bien moindre que ce qu’il a été, on peut trouver des similitudes : être vacataire à l’École, être une femme en entreprise. On touche ici à la notion d’intersectionnalité. Y a-t-il un lien entre la position de femme et le statut de vacataire, rien ne le prouve. En revanche j’atteste vivre les deux, et ne pas trouver cela évident.
Silence et parole – la difficulté de prendre la parole pour des femmes est notamment sensible dans certains secteurs ; d’autres espaces de l’École ont permis récemment des prises de parole libres et en particulier le CER [Conseil des Études et de la Recherche] et le nouveau CFVE [Conseil de la Formation et de la Vie Étudiante], pensé pour les étudiant·es.
En fait, toute ma vie, je n’ai jamais levé le pied, je me suis oubliée. Aujourd’hui, c’est compliqué. L’avenir me fait peur. Avec du recul, je me dis que ma vie professionnelle a gâché ma vie « tout court », ma vie de jeune femme, de maman. Avec l’âge, on a un autre regard sur ce qu’on a fait. On analyse plus facilement, largement. Je pense que les femmes sont oubliées dans notre société, rien n’est fait pour elles, et pour leurs enfants. […] On a été mises de côté, toutes les personnes qui ont passé cinquante ans. On est plusieurs dans le même cas : on a le sentiment de ne pas exister. On se débarrasse des « vieux » et on semble privilégier les jeunes. Mais il faut aussi faire avec celles qui sont déjà là, et nous écouter – nous avons de l’expérience, j’ai été quand même à l’École pendant plus de dix ans. Nous, on nous entend quand ? J’aimerais qu’on soit plus entendues, avec des actions derrière, qu’on ait des réponses, notamment sur nos évolutions de carrière. L’idée, c’est de faire avancer les choses dans le bon sens : on est ici dans le même bateau, on a chacun une rame et on fait avancer à notre niveau. Il faut pouvoir dire les choses, il faut écouter tout le monde, nous sommes tous liés. On pourrait organiser des réunions autour de nos interrogations, des étudiants pourraient être présents, des enseignants aussi, pour qu’ils puissent entendre ce qu’on a à dire et, avec leur avis extérieur, nous donner des idées.
J’avais constaté que, lorsqu’on est une femme, il était souvent très difficile de parler des sujets, des situations ou des comportements qui posaient problème. Je m’étais fait une raison, je ne pouvais rien faire, rien dire, sinon je pouvais faire l’objet de remarques, qui revenaient à mes oreilles : « Elle est excessive », « elle parle trop », des choses comme ça. Dans les cas où j’ai pu parler de cela aux intéressé·es, il m’a parfois été dit qu’ils ou elles s’en voulaient de leur jugement et savaient que ce jugement était erroné – le plus souvent car d’autres personnes étaient intervenues pour leur parler. Le mot « hystérique » est revenu et revient toujours à l’École pour les femmes qui tentent de parler de sujets qui remettent en question l’ordre établi – un mot qu’on entend plutôt dans la bouche de femmes. Le mieux qu’on pouvait faire, c’était d’essayer d’ouvrir des sujets de temps en temps, tout en sachant que c’était quasiment impossible. Selon mon expérience, il fallait se taire. C’était la norme d’être dans ces situations-là. Les choses ont évolué car plus de femmes sont arrivées dans le corps enseignant. Mais pour qu’il puisse y avoir une évolution réelle là où les problèmes restent globalement figés, il faut qu’une parole se réinstalle, que de vrais échanges soient possibles.
L’assistant de prévention de l’époque était exceptionnel, il avait une formation de psy. Il utilisait toujours l’expression « il faut libérer la parole », et « la parole se libère ». C’était un homme révolté par les injustices. Il m’a dit, un jour, qu’en travaillant sur certains sujets à problème de l’École, et du fait qu’il était chargé de mission directement auprès du directeur, il s’était rendu compte que la parole d’un homme avait beaucoup plus de poids et de valeur que celle d’une femme : il comparait, entre autres, sa parole à la mienne, et cela l’a convaincu d’utiliser plus encore sa propre parole pour porter avec un grand courage certaines causes dans l’École.
À quelques exception près de « grandes gueules » (ou jugées alors comme telles), les filles étaient en cours plus réservées et gardaient plutôt le silence, comme un respect tacite dû aux plus forts. Je me réjouis chaque année de voir à quel point cela a évolué.
Déséquilibres hommes/femmes parmi les enseignant·es, manifestes en particulier dans certains secteurs, et mandarinat dans la conduite des secteurs, longtemps tenus par des hommes avec des pratiques de domination affirmées – les recrutements récents ont permis de faire rentrer de nombreuses femmes dans l’École (qui ne représentent cependant que 34,3% de l’effectif), alors que des femmes sont aujourd’hui présentes à la tête de la plupart des secteurs (seuls deux secteurs sont aujourd’hui représentés par deux hommes, Design graphique et Cinéma d’animation).
Durant mes études, je dirais que les Arts Déco étaient marqués par la prédominance des hommes, à tous les étages. Mes enseignants étaient des hommes. Sur mes six années d’école (dont post-diplôme), j’ai reçu seulement six cours en tout assurés par des femmes, dont certains d’1h30 sur un trimestre ou semestre uniquement. J’ai grandi avec cette idée que le savoir (et le pouvoir) était (naturellement) détenus par des hommes, cela ne m’a donc aucunement alertée à l’époque, et dans un premier temps cela m’a confortée dans cette idée.
À mon époque, c’était vraiment la bataille pour garder ce champ [mon secteur] le plus fermé possible, avec des « élus » et avec des gens qui méritaient ou pas. Souvent, c’étaient des hommes. Là, pour le coup, c’était assez malveillant. En tout cas, pour les femmes. La seule enseignante qui avait droit de cité, elle était assistante. Elle n’assurait quasiment aucun cours seule. Le reste des femmes qu’on pouvait voir, c’était éventuellement dans d’autres sections, sur d’autres disciplines, mais dans mon secteur, pas du tout.
Ce qui ressort si je regarde dans ma promo : ceux qui s’en sortent et qui marchent, ce sont les hommes, alors qu’ils étaient en minorité. Mais c’est le cas dans beaucoup de pratiques artistiques. On est toujours plus ou moins deux tiers de filles dans les classes et, généralement, ceux qu’on retrouve sur le marché comme indépendants et qui réussissent, c’est plutôt les garçons. D’ailleurs, alors qu’il y avait moins de garçons parmi les élèves, j’ai l’impression qu’il y a eu plus de garçons stagiaires chez les profs. C’est logique, c’est un truc de paternité, de filiation. Ils choisissent des fils. Il y a quand même un certain nombre de profs qui étaient là pour, soit recruter des stagiaires, soit faire gaffe à ce qu’on ne leur pique pas leur travail à la sortie de l’École.
À EnsadLab [Laboratoire de Recherche lié à l’École], l’arrivée des femmes commence à se faire sentir, mais il y a une prédominante masculine probablement liée à une vision technologique de la recherche-création.
Parmi les secteurs, de mémoire, le secteur Design objet était le plus égalitaire. L’apport des femmes y était reconnu, il y avait une conscience du nécessaire équilibre d’effectif enseignant hommes-femmes. Par contre, de manière flagrante, d’autres secteurs posaient des sérieux problèmes de domination masculine, c’était le cas du secteur Design graphique multimédia et du collège Expression plastique qui étaient principalement composés d’hommes.
Le secteur graphisme a été fortement ouvert à des présences féminines dans les dernières années grâce à l’action des étudiant·es et au choix de privilégier des femmes lors d’appels à des invité·es extérieur·es.
Avec certains hommes enseignants, dans ce secteur très masculin, on est dans le syndrome du créateur tourné sur son nombril. Tout ce qu’il fait doit servir ses intérêts, et ses relations doivent aussi servir ses intérêts. Ce que je perçois du comportement de certains d’entre eux est la brutalité, la violence sourde.
Dans mon secteur, il y a très peu de collégialité, très peu de réunions. C’est très vertical, ça l’a toujours été et ça persiste. C’est une vieille construction qui n’a pas été remise en question. Il y a une forme de patriarcat qui ne se pose pas uniquement sur les femmes, une espèce de prise de territoire, de prise de pouvoir. C’est une gouvernance paternaliste et patriarcale, d’évidence – c’est posé comme ça, ça ne se discute pas, ce n’est pas agressif en apparence.
Au moment où un nouveau coordonnateur d’un secteur posant problème devait être désigné, un des membres d’un secteur de l’École, un homme, a demandé un rendez-vous à deux élu·es, dont je faisais partie. Il nous a demandé de témoigner en tant qu’élu·es auprès du Ministère de la Culture contre la direction de l’école et de l’accuser de trafiquer les comptes. Nous avons refusé. C’était un procédé hallucinant. Nous pensions qu’il inventait. C’était une demande tellement énorme ! D’ailleurs il n’a produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. Il pensait nous manipuler. Nous n’avions pas d’autre choix que de résister à ces pratiques, d’une grande violence. Notre ligne était de travailler pour l’intérêt général.
Directrice – Geneviève Gallot, directrice de 2008 à 2013, seule directrice à ce jour de l’École mixte (c’est-à-dire depuis 1949), a été confrontée notamment à des comportements misogynes au sein de l’École et a finalement choisi de démissionner, comme Marie Frère de Montizon, première directrice de l’École gratuite de dessin pour les jeunes personnes, l’avait fait moins de deux cents ans auparavant (en 1829). Si les témoignages sur la direction de G. Gallot divergent, de nombreuses enseignantes se sont exprimées positivement à son propos et ont témoigné des attaques sexistes dont elle avait fait l’objet.
Geneviève Gallot, directrice à l’époque, était très heureuse que les coordinations changent de genre. Elle m’a énormément soutenue. Emmanuel Fessy, directeur des études, était également très bienveillant à l’égard des femmes. J’ai particulièrement apprécié la direction de Geneviève Gallot qui a apporté à certaines femmes un vrai soutien. Elle avait une autre écoute sur notre travail.
Je peux vous dire une chose : les remarques sur les vêtements de Geneviève Gallot, c’était tout le temps. Elle avait une veste orange limite fluo. J’ai entendu beaucoup de remarques vestimentaires sur elle, ça pouvait être aussi les femmes qui les formulaient. Et puis on a entendu dire dans l’École dès son arrivée, « ça n’est pas une créatrice », « vous n’êtes pas une créatrice ». J’aimerais savoir pourquoi quand c’est une femme, ça lui est dit, y compris par ses courtisans, et qu’on l’entend régulièrement dans les couloirs de l’École. Je me souviens de profs d’expression plastique qui le disaient tout le temps. Pourquoi pour les directeurs, quand ce sont des hommes et qu’ils ne sont pas des créateurs, on n’entend quasiment jamais cela ? Il est évident que cela visait à la disqualifier.
La directrice nous a rejoints sur un cas précis. Au début, elle n’était apparemment pas très perméable à ces sujets. Par la suite, elle a commencé à prendre conscience de ce qu’il se passait en coulisses. Elle a notamment œuvré pour qu’une enseignante femme, et aussi deux enseignants hommes – qui avaient été carrément mis à l’écart de leur propre secteur – soient réintégré·es dans leur secteur d’origine.
De façon récurrente, j’ai entendu des propos déplacés sur la directrice venant principalement des enseignants-hommes des secteurs qui n’étaient pas en odeur de sainteté auprès d’elle. Femme au pouvoir, elle était perçue comme un obstacle à leur autonomie. Je suis un témoin direct de la violence verbale dont ils étaient capables. Globalement, j’ai pu constater que le sexisme s’exprime avec une violence d’autant plus grande qu’il y a des enjeux de pouvoir, qu’ils soient déclarés ou occultes.
Agissements sexistes et discriminatoires ; harcèlements – il semble qu’ils aient été nombreux jusqu’à récemment ; aujourd’hui une vigilance extrême de la direction sur ces questions (dans les relations entre les différents acteur·rices de l’École et à certains moments clefs comme le concours d’entrée) et la mise à disposition de la Charte éthique de gestion et prévention des violences de l’Ensad, accessible en ligne sur l’intranet de l’École [textes de référence/chartes], doivent permettre d’informer, de faire face correctement à ces situations et de protéger les victimes. Une formation a été proposée à toute l’École en 2021 par le groupe Egae qui a permis de nommer et définir les différents types de violence – agissements sexistes et/ou discriminatoires, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol – et d’indiquer des moyens pour les prévenir et pour réagir.
Je me souviens que savoir se montrer incompétente et docile était le plus efficace pour obtenir de l’aide. Je me réfère ici à certains techniciens.
Dans un secteur et un milieu professionnel assez masculins, il n’est pas évident d’être une femme, car on est souvent soumise à des actes de discriminations symboliques tout autant par les collègues que par les étudiant·es (exemple : la parole d’un homme – star dans son secteur – qui a un grand atelier auprès duquel l’étudiant·e pourrait faire un stage compte plus que la tienne ou la parole du prof x compte plus que celle de x). J’ai le sentiment que les étudiant·es prennent plus au sérieux les hommes, ou alors qu’ils/elles sont sous les effets d’une forme de pouvoir sur lequel se construit l’autorité du prof (homme) ; que les étudiant·es attendent de moi une souplesse qui touche à des attitudes maternelles ou tout simplement qu’ils ne prennent pas au sérieux les devoirs ou dead-lines lorsque cela vient d’une femme.
À l’envie d’apprendre s’oppose une attitude plus nonchalante, dominante et plutôt (mais pas exclusivement) masculine. Je me souviens d’un élève de première année qui était dans cette posture. Il avait joué au foot dans la cour devant la fenêtre (sur cour) de la salle de 1ereannée pendant que nous étions censés être ensemble en cours, narguant ainsi le reste du groupe, comme bien sûr moi-même. Je l’ai pris comme un signal fort de domination et j’ai choisi de ne pas m’y arrêter. Sans surprise, à la fin du module, le rendu de cet étudiant était faible. J’ai trouvé cela triste et attendu.
Alors que je les incitais simplement « à aller voter », un étudiant m’a une fois laissé entendre que je ne devais aucunement prendre parti, qu’il ne voulait pas entendre cela de la part de ses professeurs. Je ne vois pas les choses de cette façon, nous nous façonnons mutuellement, je ne pense pas que l’on puisse dissocier nos enseignements du monde, de l’espace, de la société, des changements qui nous environnent. Je ne pense pas qu’il aurait tenu ce discours à un enseignant.
J’ai subi deux situations de conflit : l’une avec un groupe de professeurs qui a usé de stratagèmes autoritaires auxquels je n’étais pas préparée ; si j’avais été un homme, ils auraient trouvé un autre moyen de pression. L’autre avec un étudiant qui a voulu m’impressionner avec sa masculinité ! Mais j’ai su stopper son état en faisant figure d’autorité.
Un jour je prenais un café avec un enseignant, j’étais jeune enseignante, il m’a dit textuellement (on parlait des élèves) : « Les filles sont très douées pour la typographie, mais au final les garçons sont toujours les meilleurs. »
Dans ce que j’ai pu noter, il y a eu quand même à une époque certains épisodes lors des concours où j’ai eu l’impression que les garçons étaient privilégiés – « Ah, enfin un garçon », « Ah, il est bien ce garçon »… C’était à la limite les enseignantes qui favorisaient le passage des garçons. Certains enseignants, eux, manquaient il me semble un peu de discrétion par rapport à des candidates.
Je me souviens avoir coupé la parole à un enseignant, membre de jury de concours d’entrée, lors de l’audition d’une jeune fille à laquelle il débitait un discours très tendancieux, orienté sur la séduction homme-femme, qui, bien sûr, n’avait rien à voir avec l’entretien de candidature. La candidate était très mal à l’aise face à la tournure de l’entretien. J’ai été témoin de ces dérapages dans les années 2010. Faire bouger les mentalités prend du temps. Un espoir : la récente charte Égalité de l’École. L’avenir de l’égalité des genres à l’École, passe, à mon avis, principalement par l’implication des étudiantes.
Lors de réunions lorsqu’un collègue dit « je t’en prie , la priorité aux femmes », il fait semblant de vouloir me laisser la parole alors qu’il attend juste que j’ai terminé de parler (pour faire semblant devant le directeur qu’il me respecte) pour ensuite dévaloriser tout ce que j’ai dit et rétablir tout de suite le rapport de domination.
À propos d’une enseignante, elle est chercheuse et son domaine de recherche, c’est la nutrition, la cuisine. On souhaitait la faire entrer dans l’équipe. Un enseignant m’a dit dans une réunion à l’oreille : « Mais on ne va quand même pas prendre une bonne femme qui fait des cuisines ? ». Je n’ai rien dit…
À deux reprises j’ai subi des humiliations de la part de deux collègues hommes, lors d’une réunion et lors d’un jury de recrutement, qui a eu lieu devant la direction qui a pris ma défense, mais c’était très gênant (énervant et blessant). Sans compter les manières méprisantes d’un enseignant en particulier dans mon secteur qui au quotidien, depuis plusieurs années, dévalorise toute prise de parole de ma part, ainsi que toute activité pédagogique que je porte (tout comme celles portées par d’autres femmes).
À mon arrivée, j’ai repris le poste d’une femme très sexy (micro jupe, talons hauts…) et j’ai bien évidemment senti le regard de certains enseignants déçus par ce remplacement. J’ai entendu : « Ah c’est vous qui prenez la suite, ce n’est pas le même genre »… long regard de la tête au pied tel un scan ! J’ai aussitôt rétorqué « Et oui, moi ce sera pantalon, chaussures plates ; cela pose un problème ? »
Généralement les réponses du tac au tac refroidissent et calment les choses. On m’a également dit que j’étais une petite bourge… J’ai toujours tenu tête à un petit groupe d’enseignants proche de la retraite (post soixante-huitards attardés) et j’ai répondu à leur humour déplacé, utilisant le même langage fleuri. Cela n’a pas duré trop longtemps et ils ont vite renoncé. En arrivant à l’École, j’ai eu un drôle de sentiment, l’impression étrange d’être arrivée dans « un relais de routiers », je n’avais jamais ressenti cela auparavant. Cela ne correspondait pas à l’idée que je me faisais d’une école d’art. Dans tous les lieux professionnels où j’ai évolué, les gens étaient plus policés et respectueux. Ici on oubliait toute convenance (le vivre ensemble), parce qu’on était dans une école d’art donc il fallait être cool. Mais cool ne veut pas dire grossier. Heureusement les choses ont évolué avec les années, ce type d’enseignants est parti. Une nouvelle génération d’enseignants a pris le relais, un autre esprit s’est installé.
Je me souviens du cas d’une vacataire. Elle était musulmane, elle avait un turban. Je dis bien : « un turban » : un foulard autour des cheveux. Son visage n’était pas caché. Moi, si j’avais mis un turban comme ça, on ne m’aurait fait aucune réflexion, pas de problème. J’ai eu l’impression que certaines personnes avaient été horribles avec elle parce qu’elle avait son turban – aussi bien des hommes que des femmes. J’ai trouvé ça très, très désagréable – même si je ne pense pas qu’elles lui disaient en face. Elles n’ont pas cessé de la critiquer et de critiquer son travail alors qu’à mes yeux elle bossait très bien. C’était une fille consciencieuse, efficace, vraiment très bien. Extrêmement discrète.
Il y a quelques années, j’étais en jury de concours, on était sur de toutes petites tables, côte à côte. J’arrive, je m’assieds, et sans me dire bonjour un enseignant se met à me hurler dessus, il m’accuse d’ « attaques sous la ceinture », avec une grande agressivité, sans se tourner vers moi. Assis juste devant lui, il y avait le secrétaire de jury, un surveillant, c’est donc lui qui s’est pris toute l’agressivité physique qui m’était destinée. Je ne comprends pas ce qui se passe, je dis à l’enseignant : « De quoi tu parles ? ». Il ne me répond pas. Le jury démarre, et l’enseignant se tourne sur le côté, me tournant le dos et se met à consulter les dossiers avec le troisième membre du jury, de sorte que je n’avais aucun accès aux dossiers ni à ce qu’ils se disaient. Je ne voyais que son dos, qui m’empêchait toute visibilité sur les dossiers. Je leur demande de consulter les dossiers. L’enseignant en question prend le dossier suivant et il le jette sur la table. Après la fin de ce jury, le surveillant me dit : « Tu aurais dû partir, tu n’aurais jamais dû accepter de travailler avec eux ». Je me souviens qu’il a employé le terme de « goujat », qu’il m’a dit que cette attitude était liée au fait que je sois une femme, et qu’il avait été profondément choqué, en tant qu’homme, de la scène à laquelle il avait assisté. L’enseignant a été convoqué par la direction, et il lui a clairement été signifié qu’il avait commis une faute professionnelle grave. Reste un compte rendu de cette réunion qui relate très bien tout cela.
Il y a maintenant longtemps, à mon arrivée à l’Ensad, je me suis retrouvée, pendant un an, toute seule dans un bureau avec un homme, qui a pris sa retraite maintenant. Toute la journée, ce n’était que des blagues lourdes, à connotation sexuelle. C’était vraiment très dur, je n’en pouvais plus. Mais, j’avais l’avantage de venir travailler à l’Ensad alors que mes enfants étaient en bas âge, je me suis accrochée.
Pendant les jurys de concours (ceux-ci étaient organisés Porte de Champerret), j’ai eu une altercation avec un enseignant qui après un déjeuner très arrosé revient dans la salle et m’attrape par le cou et me serre la taille. Je l’ai vite recadré, remis sur les rails, soutenue par une enseignante qui était avec moi. Cela lui a fait reprendre ses esprits, il n’a jamais plus réitéré la chose et depuis des années il se tient à distance. Je ne me suis jamais laissé faire, j’ai toujours répondu plus fort. Cela surprend et décourage.
Agressions sexuelles – celles relatées ici sont le fait d’hommes qui aujourd’hui ne sont plus dans l’École ; les femmes les ayant subies ou en ayant eu connaissance ont choisi de parler sans que leur nom soit cité et nous les remercions pour leur courage ; aucune agression sexuelle n’est évoquée ailleurs qu’ici dans le cadre de ce projet, ce qui pourrait indiquer qu’elles sont restées rares. Nous rappelons que toute agression doit faire aujourd’hui impérativement l’objet d’un signalement – une fiche existe, liée à la Charte éthique de gestion et prévention des violences de l’École (sur l’intranet ; textes de référence/charte).
[L’agression évoquée ici a eu lieu il y a quelques années. L’enseignant n’est plus en fonction.]
L’année de mon arrivée, j’ai subi un geste de domination (mettre la main sur les fesses) qui m’a choquée et surtout rendue ridicule devant les étudiant·es. J’en ai été fortement blessée, surtout que c’était quelques mois après mon recrutement à l’Ensad, je ne savais pas avec qui en parler. Quelques années après, j’ai eu le courage d’en parler avec un collègue du secteur qui est toujours bienveillant avec moi, il était dégouté mais il m’a dit « avec… c’est normal, il était connu pour ça par les enseignants dans l’école ». Je n’en ai pas parlé à l’administration.
[L’agression évoquée ci-dessous a eu lieu il y a un certain temps (XXe siècle). L’enseignant n’est plus en fonction.]
Très peu de temps après mon arrivée à l’École, lors du 2e ou 3e cours, un enseignant s’est assis à côté de moi au début du cours, ils faisaient un cours à trois, il y avait une projection, ils ont éteint ou baissé les lumières, et d’un seul coup j’ai senti qu’il y avait sa main sur ma cuisse. Je ne connaissais pas encore son nom, et je n’avais jamais parlé avec lui. Je l’ai repoussé, et je me souviens l’avoir recadré en l’ayant croisé lors de la pause de ce même cours. Depuis ce jour, je me suis mise tout au fond de la classe dans ce cours, je me cachais derrière d’autres élèves, et ça a été comme ça toute l’année. Beaucoup savaient mais personne ne disait rien. Et c’était impossible d’en parler, je ne pouvais pas en parler aux enseignants ou au personnel, car je savais que ce serait vite balayé, et surtout que cela ne pouvait que se retourner contre moi – ce qui est presque l’aspect le plus important de la situation. Mais, cet enseignant n’est pas allé plus loin. C’était quand même assez pénible. Une fille qui était dans ma classe m’a attrapée après le cours et m’a dit en se marrant qu’ils et elles savaient très bien comment cet enseignant procédait, et qu’ils se mettaient dans les rangs au milieu ou derrière et qu’ils regardaient ce qui allait se passer. Ces élèves connaissaient l’École car ils y étaient entrés en 1ere année, alors que je venais tout juste d’y arriver. Par la suite, je n’ai pas pris l’ascenseur, et j’évitais tous les fonds de couloir à certaines heures après la fin d’après-midi, et les autres endroits où il pouvait n’y avoir personne. Ensuite, quand j’ai été dans l’une des instances de l’École, j’ai constaté qu’il s’asseyait en face de moi (à l’époque, il y avait une salle tout en longueur réservée aux grandes réunions, avec une table très oblongue), et qu’il ne décollait pas son regard de moi. J’ai pris l’habitude d’arriver en retard à ces réunions, pour choisir l’endroit où j’allais m’asseoir. Un jour je me suis retrouvée à prendre un café avec cinq ou six personnes dont il faisait partie, puis je me suis retrouvée seule avec un enseignant que je connaissais très bien et qui m’a alors dit : « C’est un démon avec les femmes ». Je n’ai jamais envisagé de porte plainte et je n’y ai même jamais pensé, tu es la première à m’en parler. On ne pouvait rien dire. Il était connu pour agir comme ça.

Questionnaire test
de
Lucile Encrevé
enseignante depuis 2013

- Déséquilibres
- Dévalorisation
- Enfants
- Directrice
- Accueil
- Actions féministes
- Sororité
- Agissements sexistes
- Aura masculine
- Relation aux étudiant·es
- Violences
Questionnaire test de
Lucile Encrevé
enseignante depuis 2013
Ce questionnaire (rempli, comme test, par Lucile Encrevé en 2020) a été envoyé en amont de leur entretien aux interviewées (enseignantes et agentes) qui demandaient plus de précision sur l’esprit du projet. Ici, les parties entre crochets sont des ajouts écrits en 2021.
Quelle est votre expérience de l’Ensad ? Est-elle à vos yeux liée à votre genre ?
Mon genre n’a pas eu je crois d’impact lisible sur mon parcours (je suis entrée dans l’École comme contractuelle en 2013) mais a déterminé, en partie, certains de mes choix (féministes). [Le fait d’avoir cherché, progressivement et dès mon arrivée, à m’opposer à la violence à l’Ensad peut être ressenti comme genré féminin]. Être dans un secteur, Design textile (DTM), majoritairement féminin (enseignant∙es/étudiant∙es) ne me permet sans doute pas d’être vraiment représentative de ce qui est vécu par de nombreuses femmes à l’École.
Avez-vous constaté que des secteurs étaient à l’École moins accueillants que d’autres pour vous en tant que femme ou pour les femmes ?
L’École se présente a priori comme ouverte, on a une sensation de parité aujourd’hui (alors que les femmes ne représentent qu’un tiers du corps enseignant). Certains secteurs restent très masculins (pour les enseignant∙es), par exemple l’ancien méridien Expression plastique – quand je les voyais partir déjeuner il y a peu encore, c’était visuellement une masse d’hommes assez sombre (c’est une image qui me reste, comme un corps unique, et étrangement c’est une violence). D’autres sont très féminins, comme DTM (que j’ai souvent entendu être nommé « secteur chiffons » avec rires à l’appui). Le corps des techniciens me semble aussi masculin, la Recherche également : c’est un territoire à conquérir (vers lequel je pousse les étudiantes).
[fig.52]Avez-vous le sentiment qu’on attend de vous à l’École un investissement spécifique lié à votre genre ?
J’ai « choisi » de me positionner dans des rôles perçus comme genrés (notamment au service du collectif), ce que j’assume. Ce qui est sûr c’est qu’étant dans un certain type de position (la mère de famille), je sens bien que ça rassure. Un enseignant âgé m’appelait régulièrement « maman » (on ne changera pas les hommes du XXe siècle). Roxane Jubert [enseignante depuis 1997] m’a dit que j’étais la première femme enseignante enceinte qu’elle ait vue dans l’École (je me souviens du regard d’un enseignant sur mon ventre, il avait l’air affreusement gêné, j’ai cru qu’il allait vomir d’un coup).
L’École est-elle un espace qui vous semble différent par rapport au monde extérieur ?
J’ai été bien accueillie par la directrice lors de mon arrivée (Geneviève Gallot [directrice ; 2008 à 2013]), puis ma grossesse a été très bien accompagnée par la direction (notamment Emmanuel Fessy, alors directeur des études). [Je me souviens cependant avoir fait cours dans des conditions difficiles, venant à l’École en taxi et à demi-allongée puis, après la naissance de mes enfants, souvent malades, ne buvant que du coca-cola mes journées de cours par peur de me trouver mal devant les étudiant∙es – je me suis souvent dit qu’ils et elles ne pouvaient pas imaginer les difficultés qu’une femme, qui leur fait cours en amphi, peut traverser dans ces moments-là – ce sont bien sûr des conditions que je me suis imposée à moi-même, le fait d’être alors en CDD ayant sans doute joué par ailleurs]. L’École est aujourd’hui un espace protégé parce que la direction est correcte. Mais elle reste un espace dur, c’est la raison pour laquelle j’y emmène mes enfants – pour défaire une image (masculine à mes yeux – impersonnelle). Quand ma fille aînée ne pouvait pas aller à l’école, elle a plusieurs fois passé la journée à la bibliothèque (grâce à la conservatrice de la bibliothèque de l’époque, Catherine Geoffroy) et c’était un grand bonheur de la savoir là. [La bibliothèque comme la cafétéria, où Régine Pouy avait toujours des sucettes pour mes enfants et des petits mots amicaux à chacun de mes passages, sont des lieux d’accueil précieux dans l’École].
Connaissez-vous des parcours d’anciennes étudiantes, enseignantes, membres du personnel qui vous inspirent ?
Oui, évidemment, je connais l’histoire des femmes dans l’École. [J’ai une forme d’affection pour les toutes premières, pour la famille Montizon, mère et filles, qui, méprisées et méconnues, ont construit une école gratuite de dessin pour filles au XIXe siècle, comme pour la jeune femme qui a écrit en 1920 un formidable courrier au directeur d’alors pour que les modèles hommes puissent poser sans caleçon [fig.52]. Mais elle n’est pas assez valorisée (et je me sens parfois seule sur ces questions). J’ai été très inspirée par les femmes de l’École des Beaux-Arts de Rouen dans laquelle j’enseignais auparavant (Béatrice Cussol [qui est intervenue à l’Ensad en mars 2021 pour orchestrer le workshop d’écriture Certaines [fig.53], en lien avec le projet « Chères Toutes »], Dominique De Beir et Florence Chevallier, artistes qui ont changé ma vie).
Vous êtes-vous sentie en minorité dans votre secteur/espace de travail ou lors de réunions/commissions/jurys ? Y a-t-il eu une évolution au cours de votre carrière ?
En HTC (Histoire Théorie Critique), il y a eu une vraie évolution [même si je m’y suis toujours sentie soutenue]. Quand nous sommes arrivées comme référentes avec Francesca Cozzolino [enseignante depuis 2013], et que j’ai pris la parole pour la première fois, certains hommes souriaient (comme s’il se passait quelque chose d’attendrissant). Lorsque j’ai soulevé le problème de l’absence d’ouvrages écrits par des femmes au programme du concours depuis dix ans, personne n’a pris en compte ma remarque – je suis passée par Emmanuel Fessy qui a imposé la présence d’une autrice : et Virginia Woolf, avec Une chambre à soi [fig.54], a été choisie, sur une proposition de Catherine Strasser [enseignante depuis 2003 ; cf. mail retrouvé du 12 oct. 2014 : « Bonjour à tous, je n’ai proposé qu’un livre parce qu’il s’impose à moi comme une priorité : tous parmi vous connaissent Une chambre à soi de Virginia Woolf. C’est à la fois un essai et un écrit d’artiste, et un pilier de la littérature féministe qui s’inscrit dans un registre différent de nos précédents choix. Les candidats garçons peuvent aussi s’approprier ce texte sur les conditions sociales de la création. Mais il y a de nombreuses propositions intéressantes dont nous parlerons le 27. À bientôt donc Catherine »]. [Comme référentes, avec Francesca, nous avons mis notamment en place des cours liés au féminisme et au genre parmi les enseignements théoriques du jeudi – ce qui, je le crois, répondait vraiment à une attente]. Dans l’École aussi, les choses ont changé. La distinction Mlle/Mme existait dans les documents administratifs quand je suis arrivée et personne ne voyait le problème : quand j’en ai parlé à Simon Garcia, alors directeur des services, il a tout de suite modifié ce « détail » – avec Emmanuel Tibloux, l’actuel directeur, il a vraiment soutenu l’écriture de la Charte égalité des genres. [J’ai dû me battre davantage pour que soit rédigée et partagée avec tous·tes la Charte contre les violences, qui reste encore trop peu visible et utilisée, alors que c’était un projet antérieur.]
[fig.54]Pensez-vous que travailler dans vos équipes avec d’autres femmes est un atout ? Pourquoi ?
Oui. Quand ça bascule (une présence trop masculine) dans une réunion ou en instance, je le sens tout de suite [et je compte les femmes], quelque chose ne va pas, comme une solitude qui pèse d’un coup. Il y a une complicité avec certaines femmes qui est essentielle (je pense à Francesca) ; avec des hommes aussi on peut avoir une relation dépourvue de séduction, il y a à l’École des hommes remarquables, féministes même, chez les enseignants comme chez les responsables d’atelier [-l’un d’eux nous a particulièrement soutenus pour que des distributeurs de protections hygiéniques soient mis en place dans l’École].
Une direction masculine entraîne-t-elle des relations spécifiques ? L’arrivée de femmes à des postes de direction a-t-elle entraîné des changements pour vous ?
A priori ça ne change pas grand-chose car à ce poste il s’agit plutôt de la manière dont la direction gère le fait d’être au pouvoir et d’accepter quand même une forme de dialogue égalitaire. L’enjeu est pour les femmes de sortir de la séduction, pour aller vers la complicité.
Lors des réunions ou de discussions à l’École, votre parole est-elle entendue à l’égal de celle d’un homme ?
En HTC, au départ les femmes étaient minorées, mais cela a vraiment changé – j’ai tout de même entendu des phrases comme « On ne peut rien leur refuser, à ces blondes » . Bien sûr, j’ai vécu des épisodes de mansplaining (un technicien qui m’explique qui est Giotto…), ce qui est toujours très amusant.
Avez-vous déjà eu la sensation que l’on répondait positivement à vos demandes, parce que vous étiez une femme ?
Je ne crois pas. Mais je remarque que j’obtiens davantage de réponses positives des hommes (de tous lieux) que des femmes.
Les étudiant·es vous considèrent-ils/elles à l’égal d’un homme ?
Je crois vraiment que les étudiantes ne me respectent pas tout à fait comme un homme (elles placent certains sur des piédestaux [et commencent seulement à s’en apercevoir, repérant les « gourous »]) – je suis sur un pied d’égalité et avec certaines une vraie relation se noue, c’est ce qui compte pour moi ; c’est le cas notamment avec le suivi de mémoires (je pense en 2019 à Alexandra Piat – Sexisme aux Arts Décoratifs, lutter pour l’égalité, à Elise Ory – Pouvoir(s) du textile, textiles du pouvoir ou à Victoire Gonzalvez – Zohar : anatomie(s) d’un monochrome, trois femmes étonnantes pour leur maturité, leur liberté et leur sensibilité). Ensuite tout dépend des années, parfois quelque chose se passe avec tout un groupe et c’est très beau.
Avez-vous été victime à l’École d’un sexisme bienveillant ?
Rien de trop important, mais oui, régulièrement. Par des enseignants que je peux apprécier par ailleurs (eux-mêmes ne le sentent pas comme problématique – et ma génération s’en sort en riant, parfois en son for intérieur).
Avez-vous été l’objet de remarques sexistes ou de traits d’humour déplacés liés à votre genre ?
J’en ai entendu, sur une autre professeure (une grossièreté, par un professeur dont le sexisme est bien connu, et très problématique – en gros, cette femme était une « mal baisée »). Un autre enseignant célèbre pour son sexisme m’a fait lors d’un jury une remarque étrange (sur la beauté de ma ceinture pourtant minimale, avec un sourire), j’ai fermé la discussion et il a dit… que je manquais d’humour. On m’a raconté qu’à une époque il fallait éviter de prendre l’ascenseur avec lui, donc en vieillissant il s’était tout de même vraiment calmé. Je me souviens aussi d’une autre histoire. Une ancienne personne à responsabilités dans l’École a dit à une professeure qui avait alors les cheveux courts en la voyant dans une salle (entourée d’étudiant∙es) : « Oh, quel joli garçon », elle était choquée mais n’a pas su comment réagir (et je n’ai pas su la conseiller).
Avez-vous été victime au sein de l’École d’agressions liées à votre genre ?
Avec Francesca, nous avons été victimes d’une agression verbale très violente, et je me dis souvent qu’elle n’aurait pas eu lieu si nous n’avions pas été des femmes (mais ce n’était pas le point de départ). [J’ai par ailleurs été menacée verbalement par un enseignant à qui j’avais signalé que des étudiantes s’étaient plaintes de phrases sexistes de sa part – mais je ne crois pas avoir pris cette menace très au sérieux, venant d’un homme du XXe siècle que je sentais démuni. Je me souviens aussi, l’année de mon arrivée, avoir été en copie d’un mail très violent envoyé à une femme : ce qui était scandaleux c’était bien sûr le contenu du mail, mais surtout l’impunité absolue qui l’entourait ; personne n’avait réagi ; cette violence par mails n’existe plus heureusement aujourd’hui à ma connaissance.] Il y a aussi des gestes qu’on ne sait pas comment nommer et qui restent – lors d’une instance mon voisin, un enseignant connu pour ses violences, a saisi d’un coup mon bras (nu), pour marquer une complicité (qui n’existait pas), et j’avoue qu’il était impossible de savoir comment réagir : ce n’était pas une agression mais ce n’était pas normal.

[fig.1] — Une élève devant un ordinateur pendant un atelier informatique, 1988, ph. Marc Pialoux © Ensad.
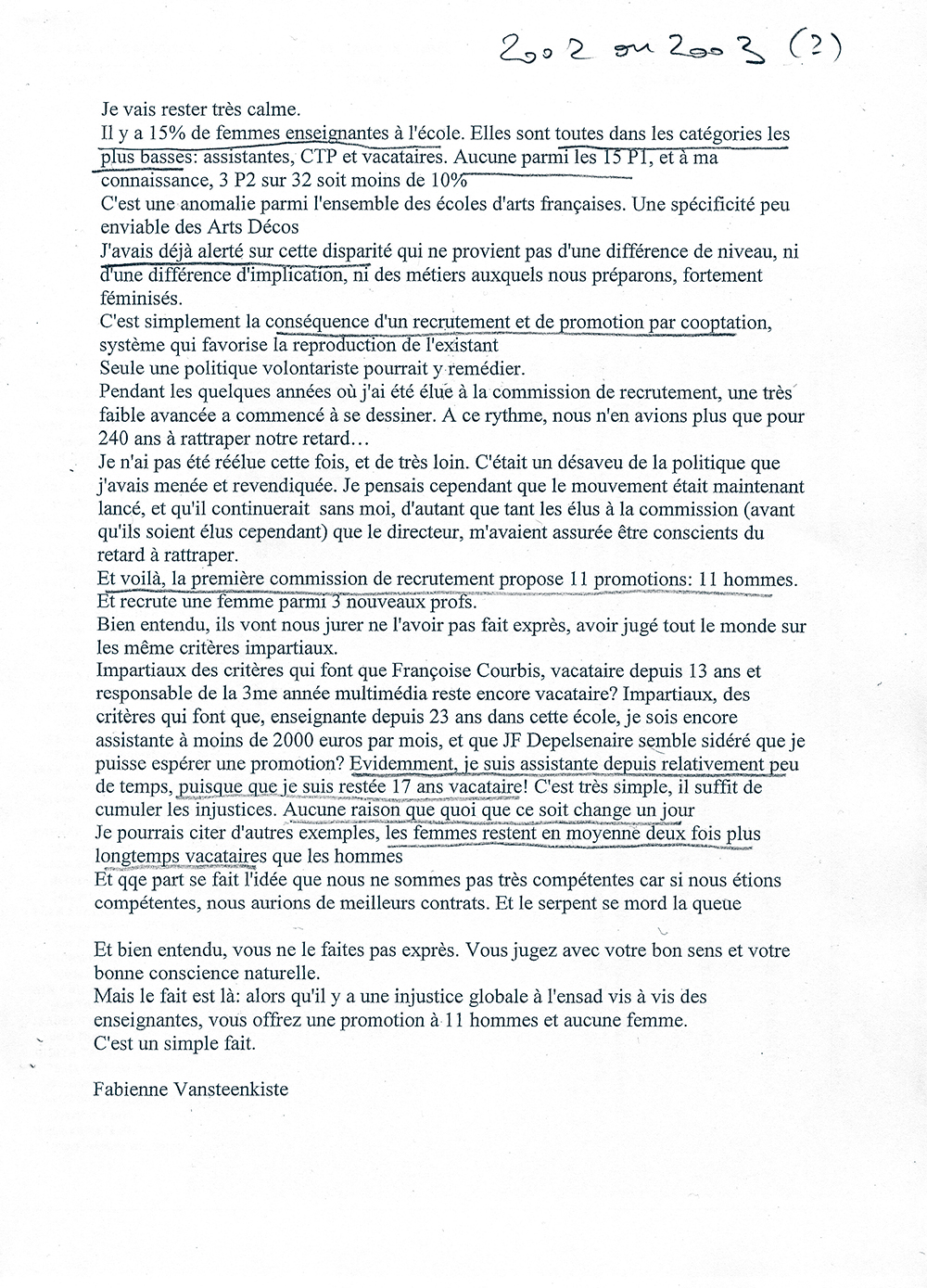
[fig.2] — Fabienne Vansteenkiste, tract distribué dans les boîtes à lettres des enseignant·es fin 2002.
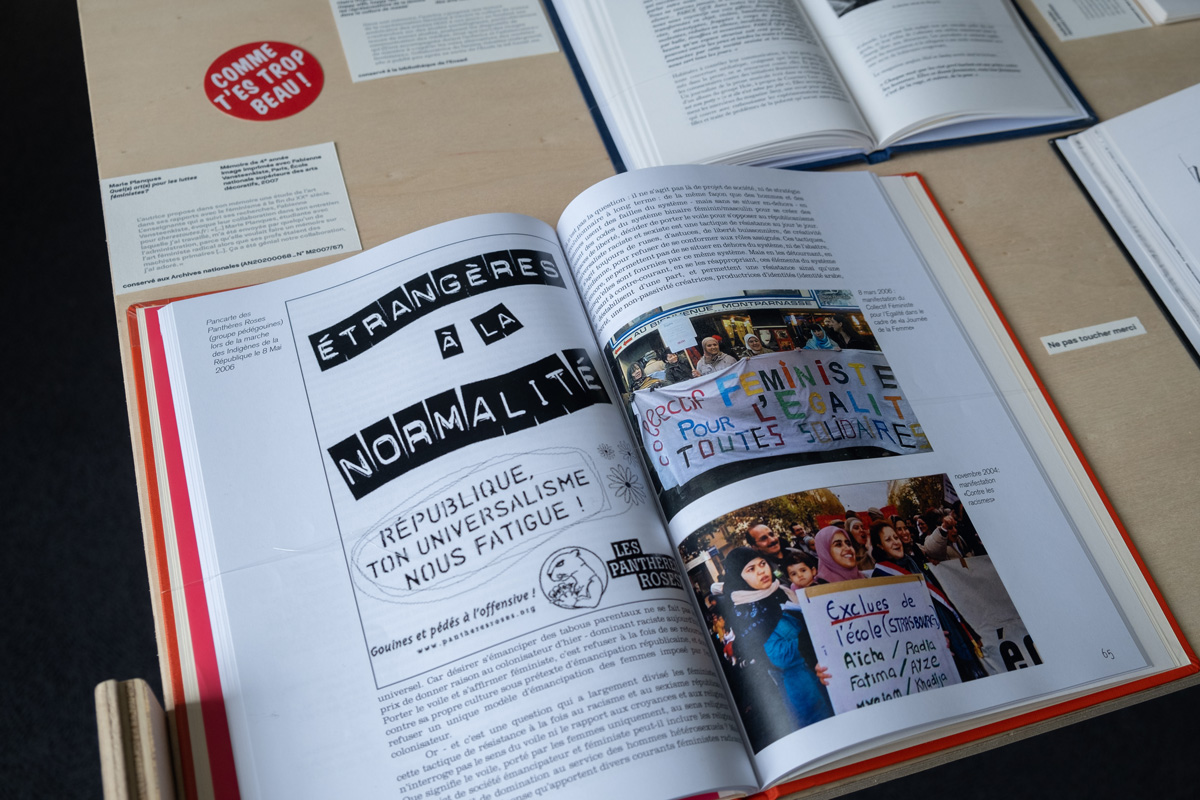
[fig.3] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – au premier plan, Quel(s) art(s) pour les luttes féministes ? , mémoire de Marie Planques, suivi par Fabienne Vansteenkiste (2007, conservé aux Archives nationales - AN20200068 N° M2007/57).
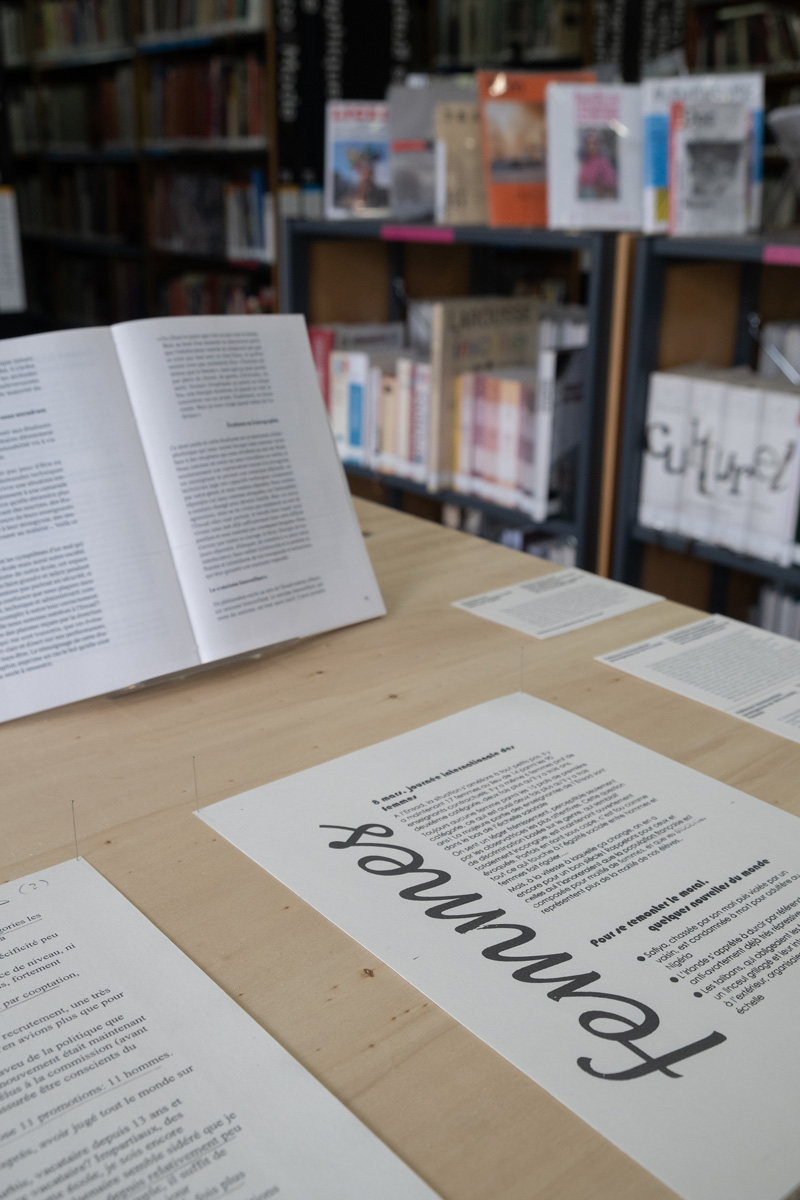
[fig.4] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – au premier plan, Femmes tract de Fabienne Vansteenkiste, distribué le 8 mars 2002.
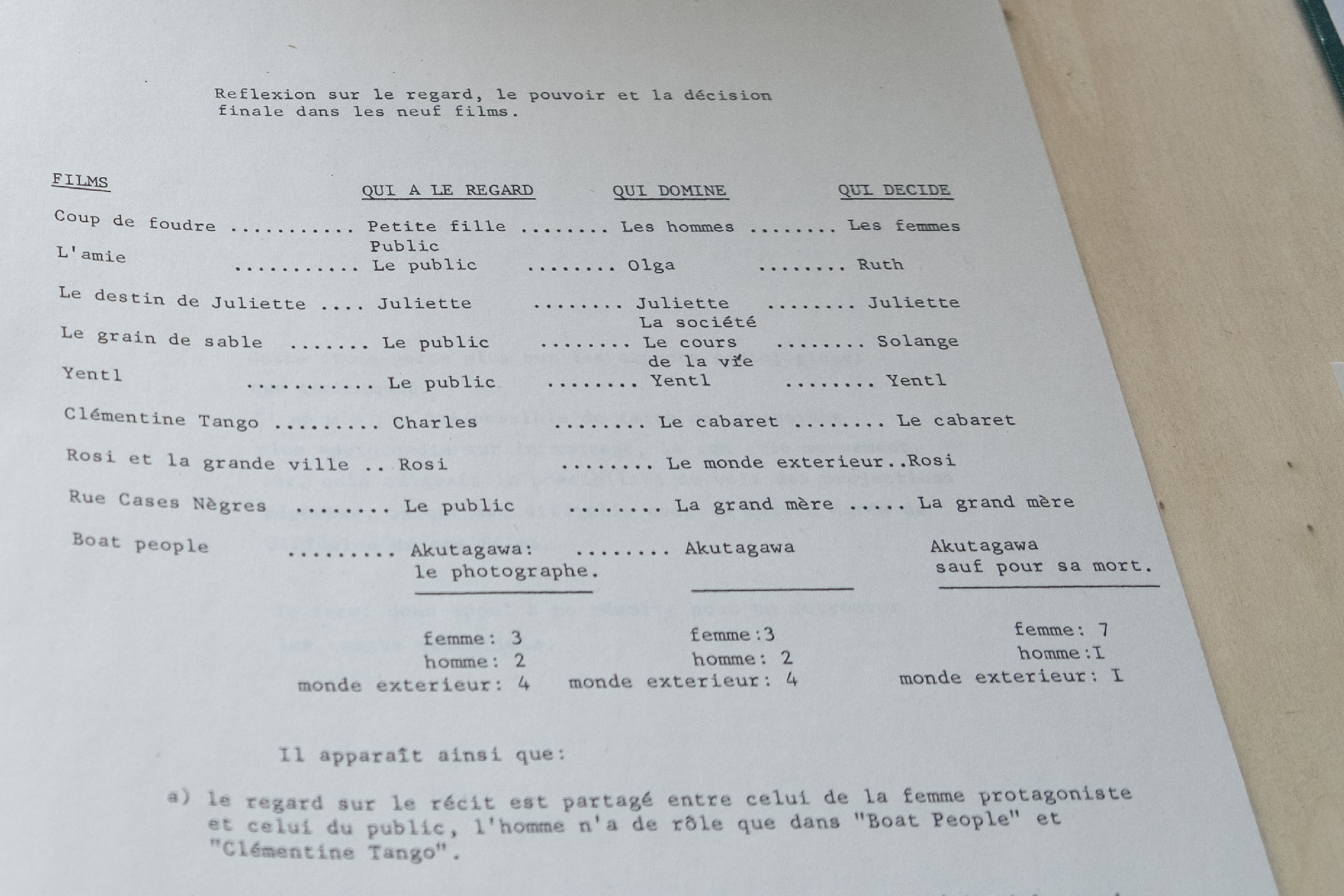
[fig.5] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – au premier plan, Femmes Cinéastes mémoire de Kalinka Weiler, suivi par Fabienne Vansteenkiste (1984, conservé aux Archives nationales- AN20080171 _ N° M1984/JUI/22).

[fig.6] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – Mona Hackel et Chloé Delchini, bb, fanzine féministe, n°1, 2021.

[fig.7] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – affiche, suspendue, réalisée par Mona Hackel et Charlotte Genser, 2021.

[fig.8] — Dépliant présentant l’association féministe pro LGBTQIA+ (textes : Léna Martinez et Alexandra Piat, graphisme : Camille Boubals)

[fig.9] — Roxane Jubert, Graphisme, Typographie, Histoire, Paris, Editions Flammarion, 2005.

[fig.10] — Marque-pages « Chères toutes » présentant la phrase de Roxane Jubert : « Le sujet commence dans la parole qui n’a pas lieu. » (design graphique : Après la pluie), distribué à l’Ensad, 2021, ph. Alexandra Piat.

[fig.11] — Atelier tissage et maille, Ensad, 2021, ph. Alexandra Piat.

[fig.12] — Un cours de tissage spécialisation Textile assuré par Nathalie Brès, 1988, ph. Marc Pialoux © Ensad.

[fig.13] — Atelier tissage et maille, Ensad, 2021, ph. Alexandra Piat.

[fig.14] — Atelier sérigraphie, Ensad, 2021, ph. Alexandra Piat

[fig.15] — Natacha Nisic, How to be a woman, missing faces, 8th March 2021 - http://crownproject.art/natacha-nisic-artist-and-film-maker-initiator-of-the-crown-letter/
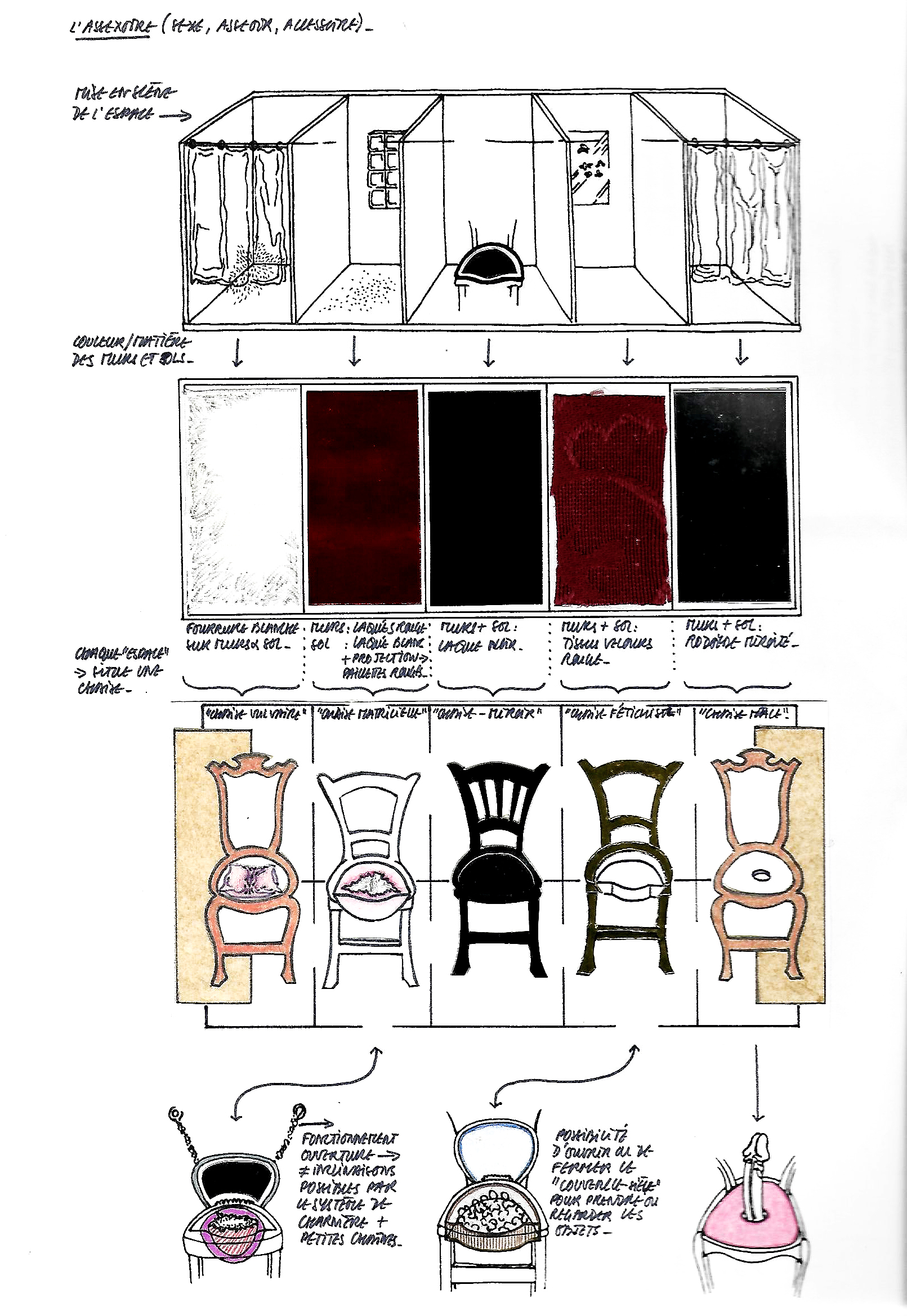
[fig.16] — Autrice anonymisée, croquis préparatoire à l'installation L’Assexoire et objets liés, 1982.

[fig.17] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – au premier plan, Quand les femmes portent des métiers d'hommes. Rencontres, 2021, supplément au mémoire Quand les femmes portent des métiers d'hommes de Coraline Chancibot suivi par Lucile Encrevé.

[fig.18] — Couverture du premier numéro du fanzine Les Vulvettes underground, fondé par Bérénice Motais de Narbonne, 2016.
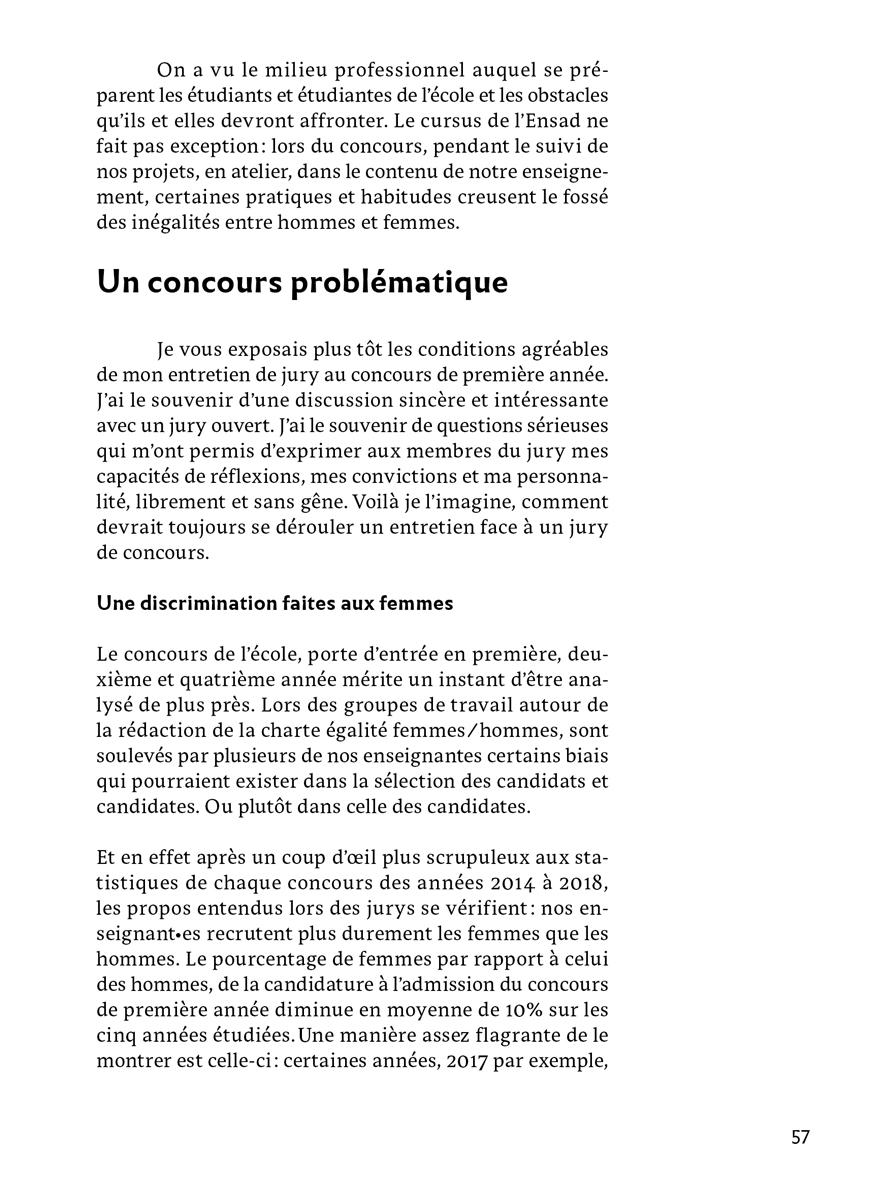
[fig.19] — Alexandra Piat, Sexisme aux Arts Décoratifs, lutter pour l’égalité suivi par Lucile Encrevé, 2019, bibliothèque de l’Ensad.

[fig.20] — Margaus Ballagny, c’est bon j’ai pris le pouvoir, Grand Projet en Image imprimée, 2020, ph. Amélie Canon.
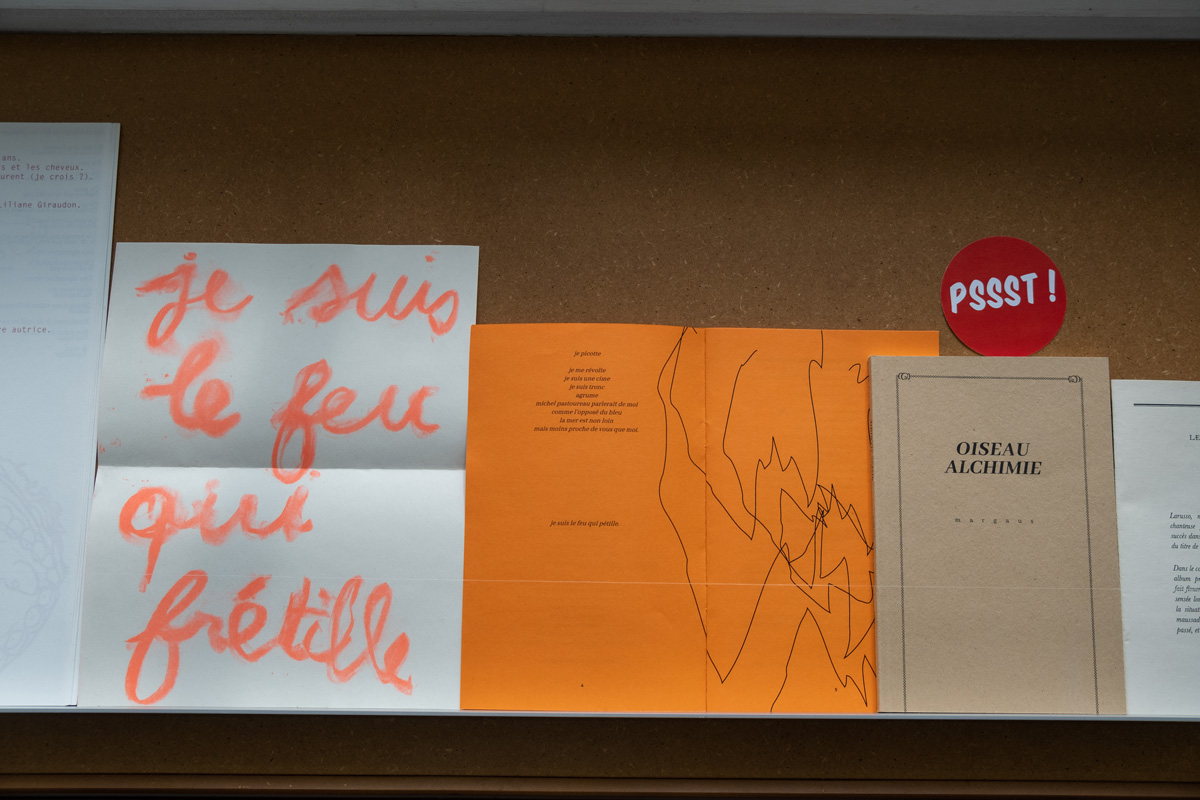
[fig.21] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – Éditions de Margaus Ballagny.

[fig.22] — L’une des affiches disposées dans l’école par Margaus Ballagny, annonçant sa fermeture définitive, 2020, ph. Margaus Ballagny.
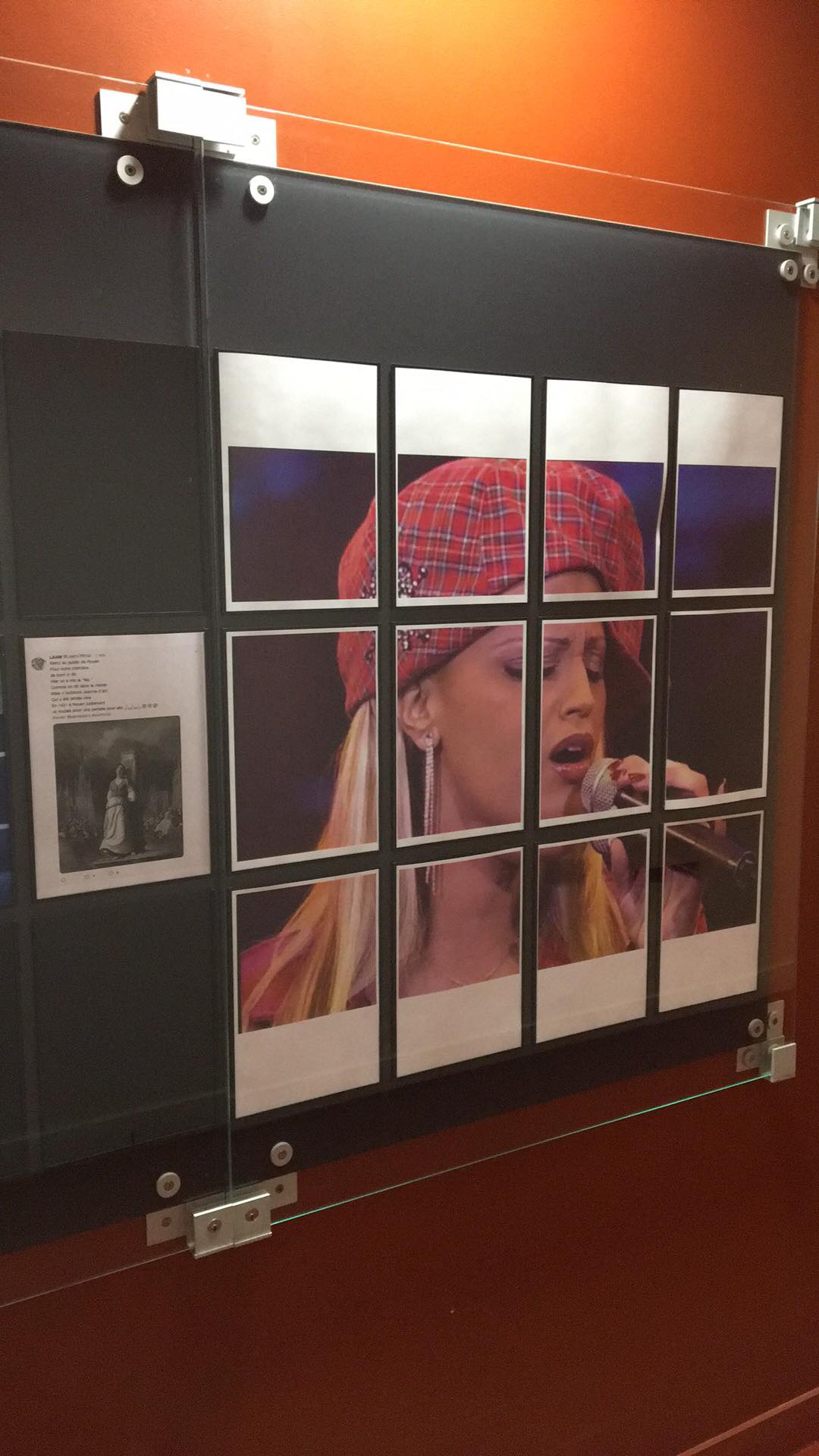
[fig.23] — Images de la chanteuse Lââm disposées dans le couloir de la bibliothèque par Margaus Ballagny, 2020, ph. Margaus Ballagny.
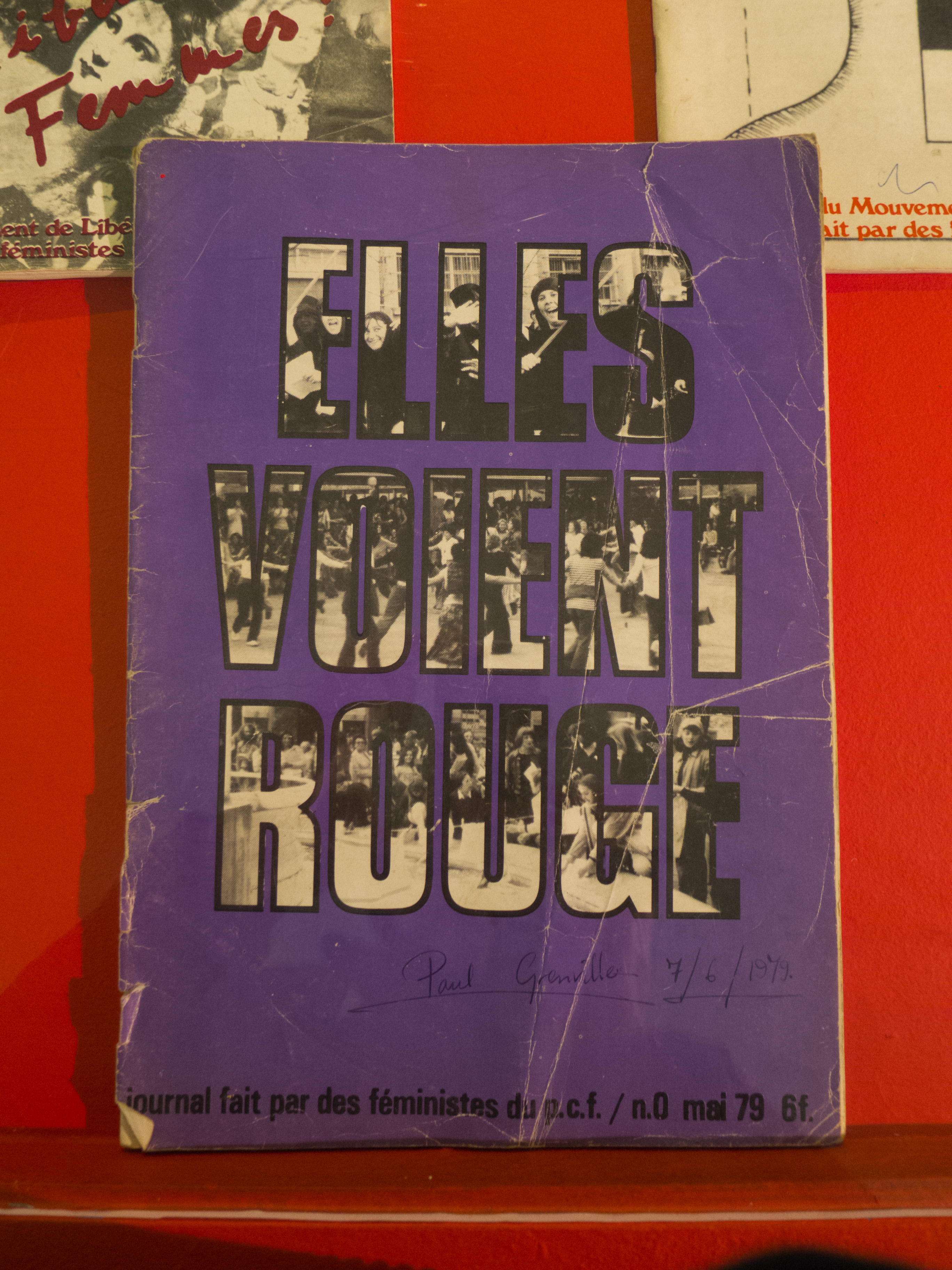
[fig.24] — Elles voient rouge, journal féministe du PC, mai 1979, ph. Étienne Pouvreau, 2016.

[fig.25] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – au premier plan, Les Femmes en noir : ou le noir, métaphore du patriarcat, mémoire de Dominique Pierçon, suivi par Michèle Guenoun (1984, conservé aux Archives nationales - AN20080171 _ N° M1984/NOV/72)

[fig.26] — Camille Boubals affichant une production réalisée dans le cadre du cours « Discours politique » donné par Françoise Courbis et Benoît Montigné en 2016.

[fig.27] — Charte de l’Ensad pour l’égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle, janv. 2019 (design graphique : Camille Boonen et Clémence Rivalier)
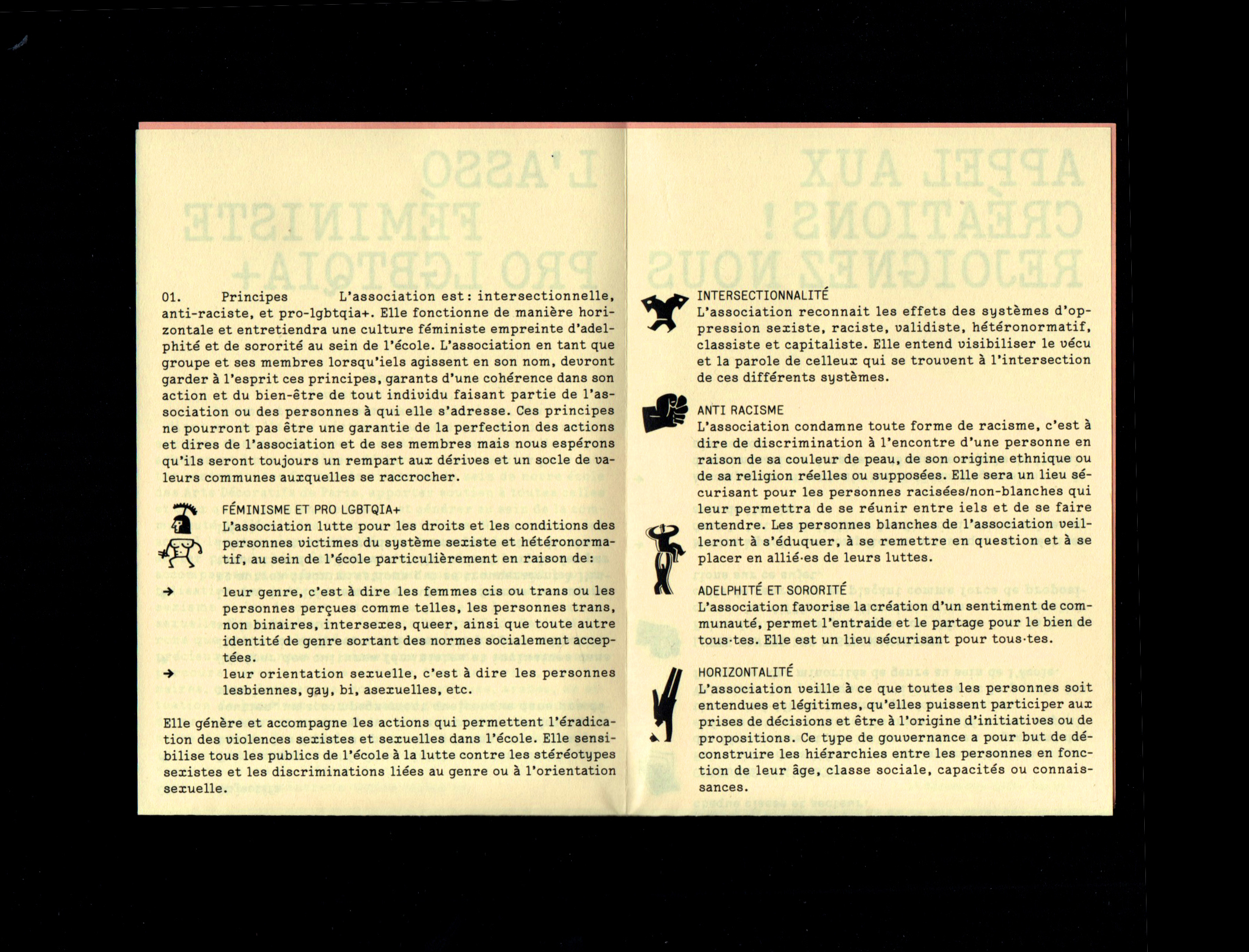
[fig.28] — Dépliant présentant l’association féministe pro LGBTQIA+ (textes : Léna Martinez et Alexandra Piat, graphisme : Camille Boubals)

[fig.29] — Un cours de tissage spécialisation Textile assuré par Nathalie Brès, 1988, ph. Marc Pialoux © Ensad.
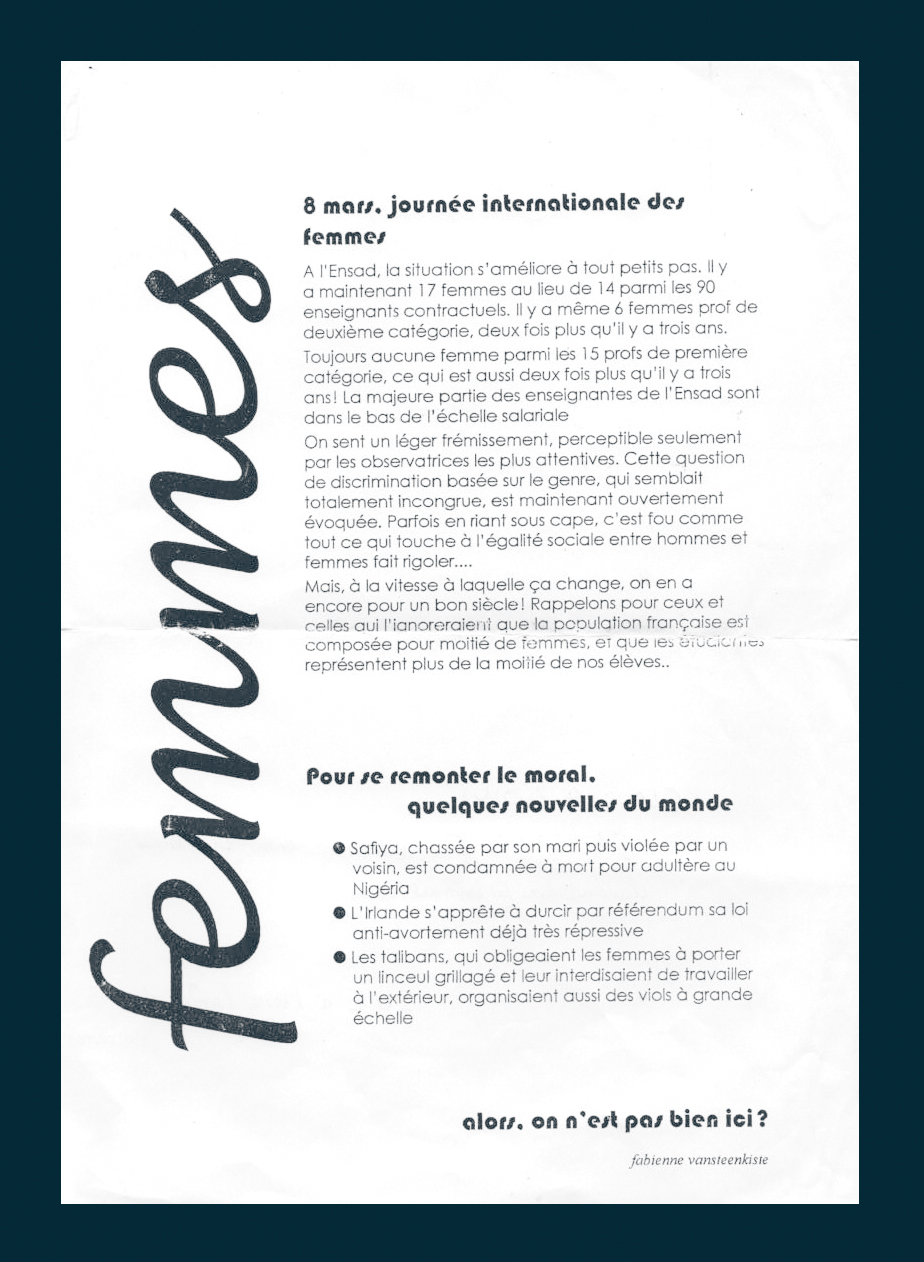
[fig.30] — Fabienne Vansteenkiste (enseignante de 1979 à 2015), Femmes, tract distribué le 8 mars 2002.

[fig.31] — Cours à la Manufacture des œillets d'Ivry-sur-Seine en 1994, ph. Jean-Claude Pattacini - l'École des Arts Décoratifs y déplaça une partie de ses activités entre 1994 et 2004 © Ensad.
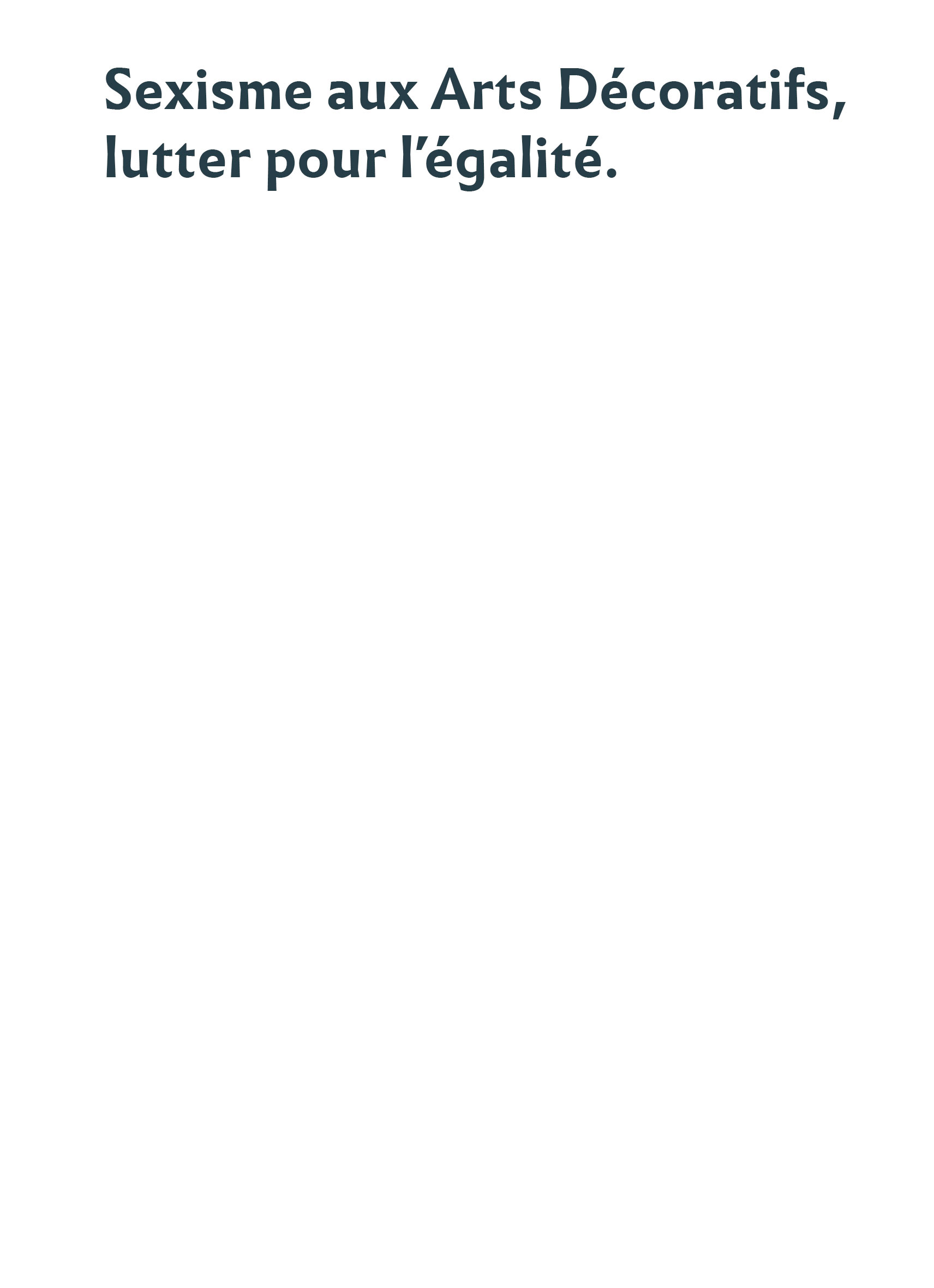
[fig.32] — Alexandra Piat, Sexisme aux Arts Décoratifs, lutter pour l’égalité, mémoire suivi par Lucile Encrevé, 2019, bibliothèque de l’Ensad.

[fig.33] — Un cours de graphisme spécialisation Textile assuré par Béatrice Saalburg, 1988, ph. Marc Pialoux © Ensad.

[fig.34] — Lucile Cornet-Richard, jwá (arbre en bambara), Grand projet en Architecture intérieure, 2020, ph. Béryl Libault.

[fig.35] — Lauren Januhowski, The repossession of grammatical gender = Se réapproprier le genre grammatical, mémoire suivi par Marie Canet, 2019, conservé à la bibliothèque de l’Ensad.

[fig.36] — Annabel Vergne (création et photo), Discours sur le poil, d’après Antonin Artaud, 1992. Forme courte présentée en Salle noire à l’Ensad dans le cadre du cours « Evénements spectaculaires ». © Annabel Vergne

[fig.37] — Image extraite d’Aucune excuse ne vous sera présentée, mémoire de Léonore Camus-Govoroff suivi par Kristina Solomoukha, 2020.

[fig.38] — Page extraite du premier numéro du fanzine Les Vulvettes underground , fondé par Bérénice Motais de Narbonne, 2016

[fig.39] — Félicie Parent, Parfois, je me sens pancarte, Grand Projet en Scénographie, 2019, ph. Mathieu Faluomi.
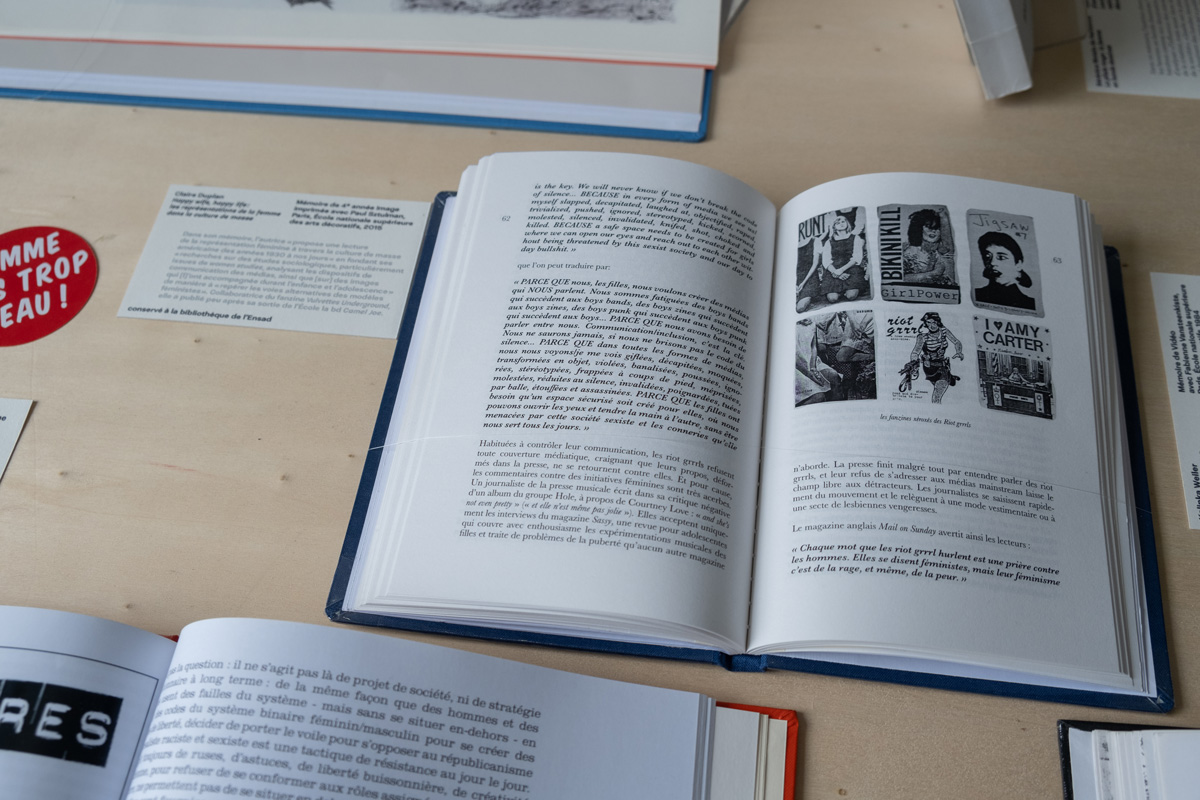
[fig.40] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – Happy wife, happy life : les représentations de la femme dans la culture de masse, mémoire de Claire Duplan suivi par Paul Sztulman (2015, conservé à la bibliothèque de l’Ensad).

[fig.41] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – Espaces féminins ambigus, mémoire de Amélie Burg suivi par Paul Sztulman (2015, conservé à la bibliothèque de l’Ensad).

[fig.42] — Un cours de graphisme spécialisation Textile assuré par Béatrice Saalburg, 1988, ph. Marc Pialoux © Ensad.

[fig.43] — Workshop « Performance : conscience du corps en action » à l’Ensad, mars 2019 - http://lacache.greneta.fr/category/travaux/

[fig.44] — Préambule, charte de l’Ensad pour l’égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle, janv. 2019 (design graphique : Camille Boonen et Clémence Rivalier)
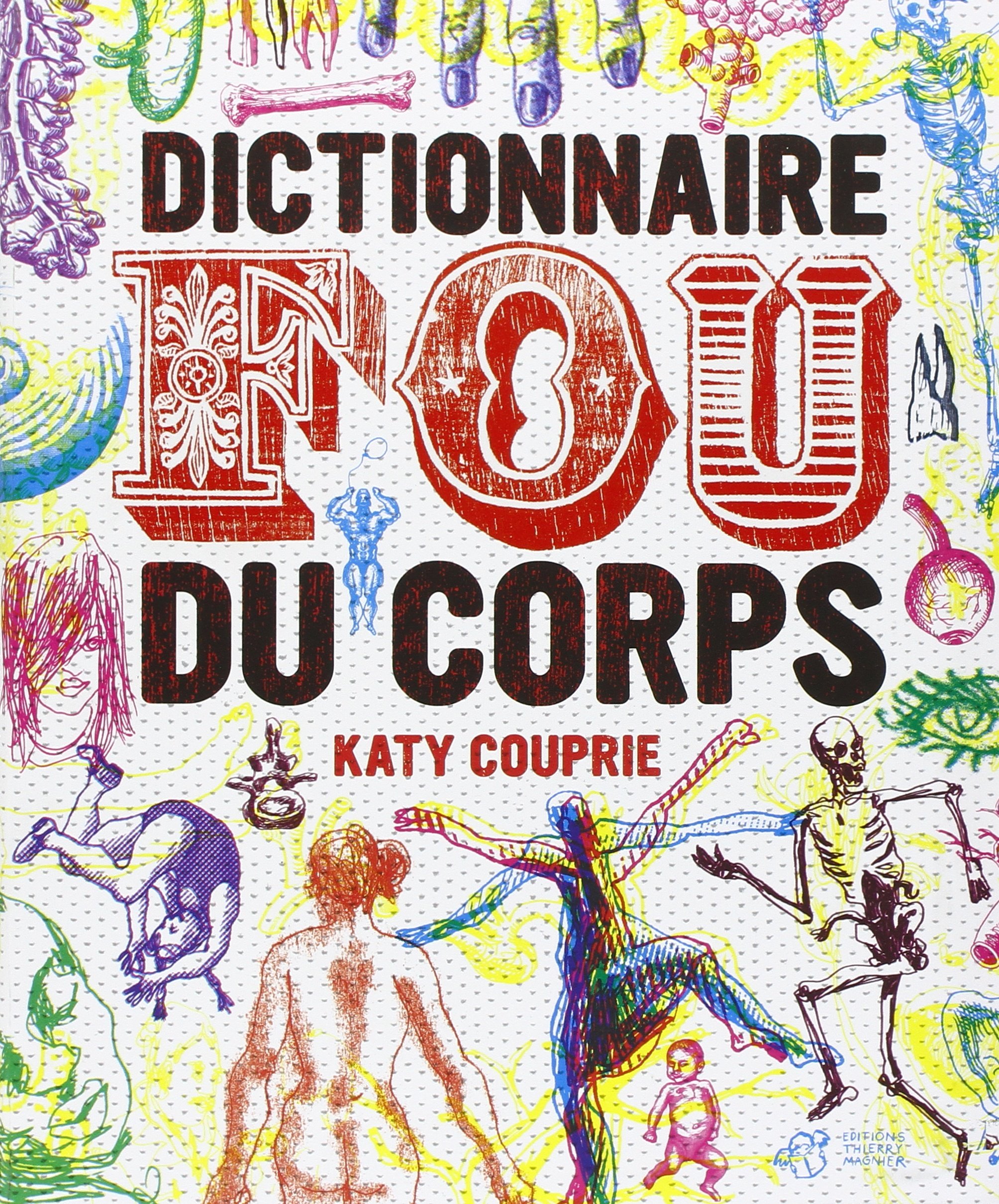
[fig.45] — Katy Couprie, Dictionnaire fou du corps, Paris, Editions Thierry Magnier, 2012.
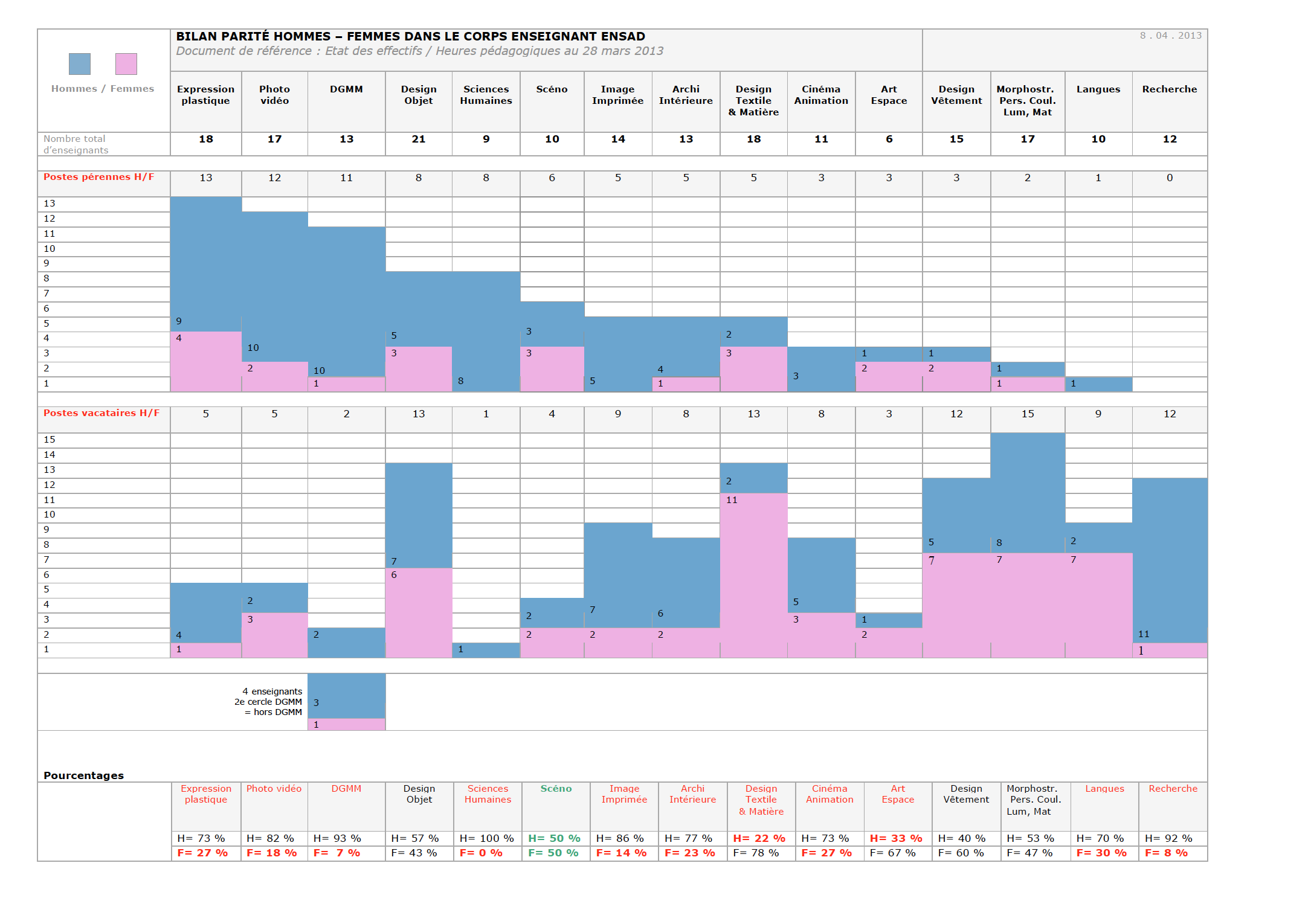
[fig.46] — Vonnik Hertig, document de travail élaboré en 2013.

[fig.47] — Double page extraite du second numéro du fanzine Les Vulvettes underground, fondé par Bérénice Motais de Narbonne, 2017.
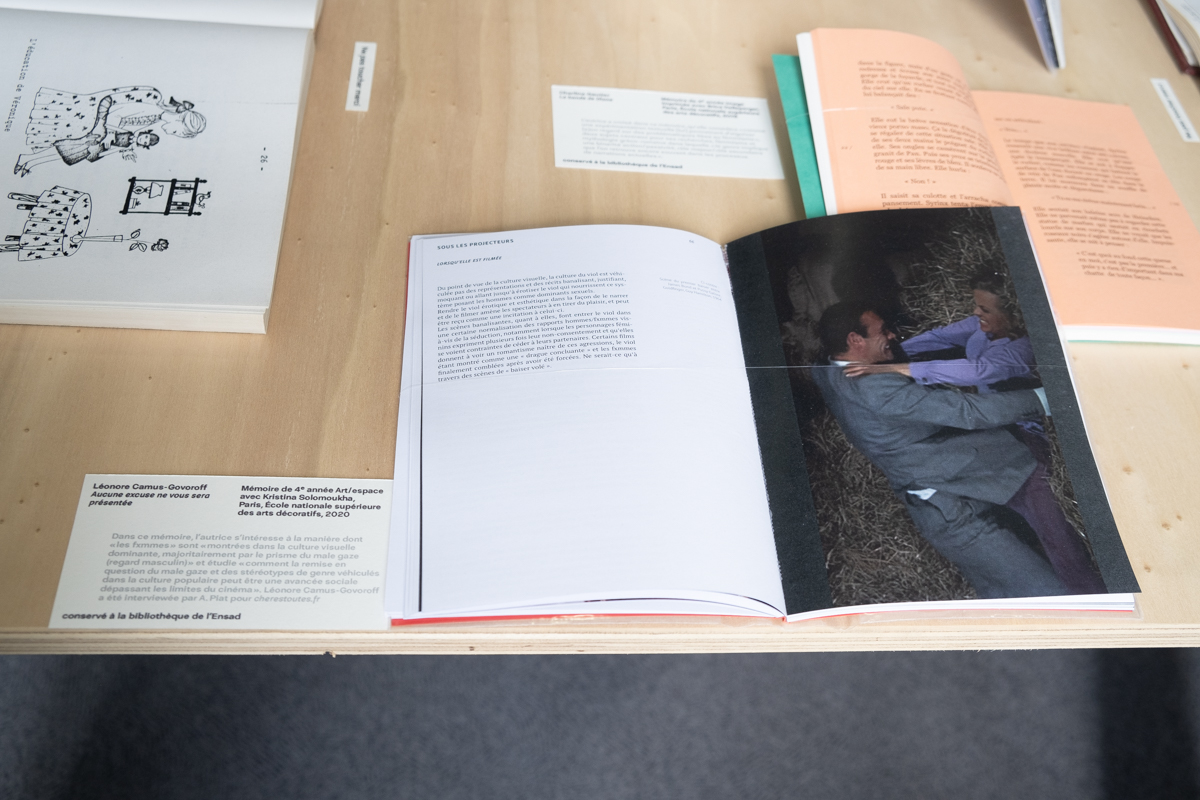
[fig.48] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – au premier plan, Aucune excuse ne vous sera présentée, mémoire de Léonore Camus-Govoroff suivi par Kristina Solomoukha, 2020.

[fig.49] — Vues de l’exposition « elles@centrepompidou. Artistes femmes dans les collections du Musée national d’art moderne », Paris, Centre Pompidou, 27 mai 2009 - 21 févr. 2011 - https://www.du-ma.fr/fr/pages/ellescentrepompidou

[fig.50] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – au premier plan, Bienvenue Mesdames, les femmes et l'espace public, livre, stickers et éditions associées, Grand projet, Design graphique - Multimédia, 2013

[fig.51] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – charte de l’Ensad pour l’égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle, janv. 2019 (design graphique : Camille Boonen et Clémence Rivalier).

[fig.52] — Lettre attribuée à Louise Bouvier (étudiante de la section des jeunes filles de l’École nationale des Arts Décoratifs alors située au no 10 bis, rue de Seine), à Eugène Morand, directeur de l’École, datée du 18 octobre 1920, conservée aux Archives Nationales (AJ/53/100)
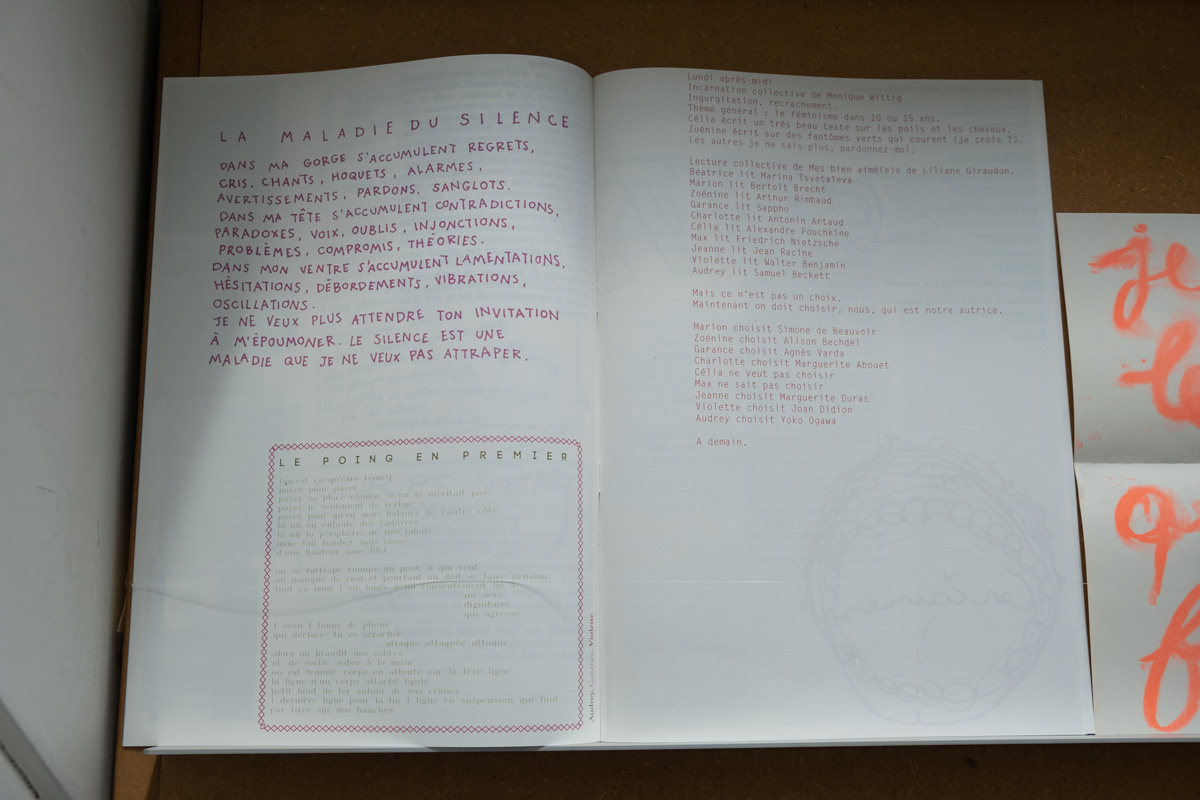
[fig.53] — Présentation « Chères toutes » à la bibliothèque de l’Ensad, 17 au 26 mai 2021, ph. Alexandra Piat – Certaines, fanzine collectif réalisé dans le cadre d’un workshop de Béatrice Cussol à l’Ensad, 2021.
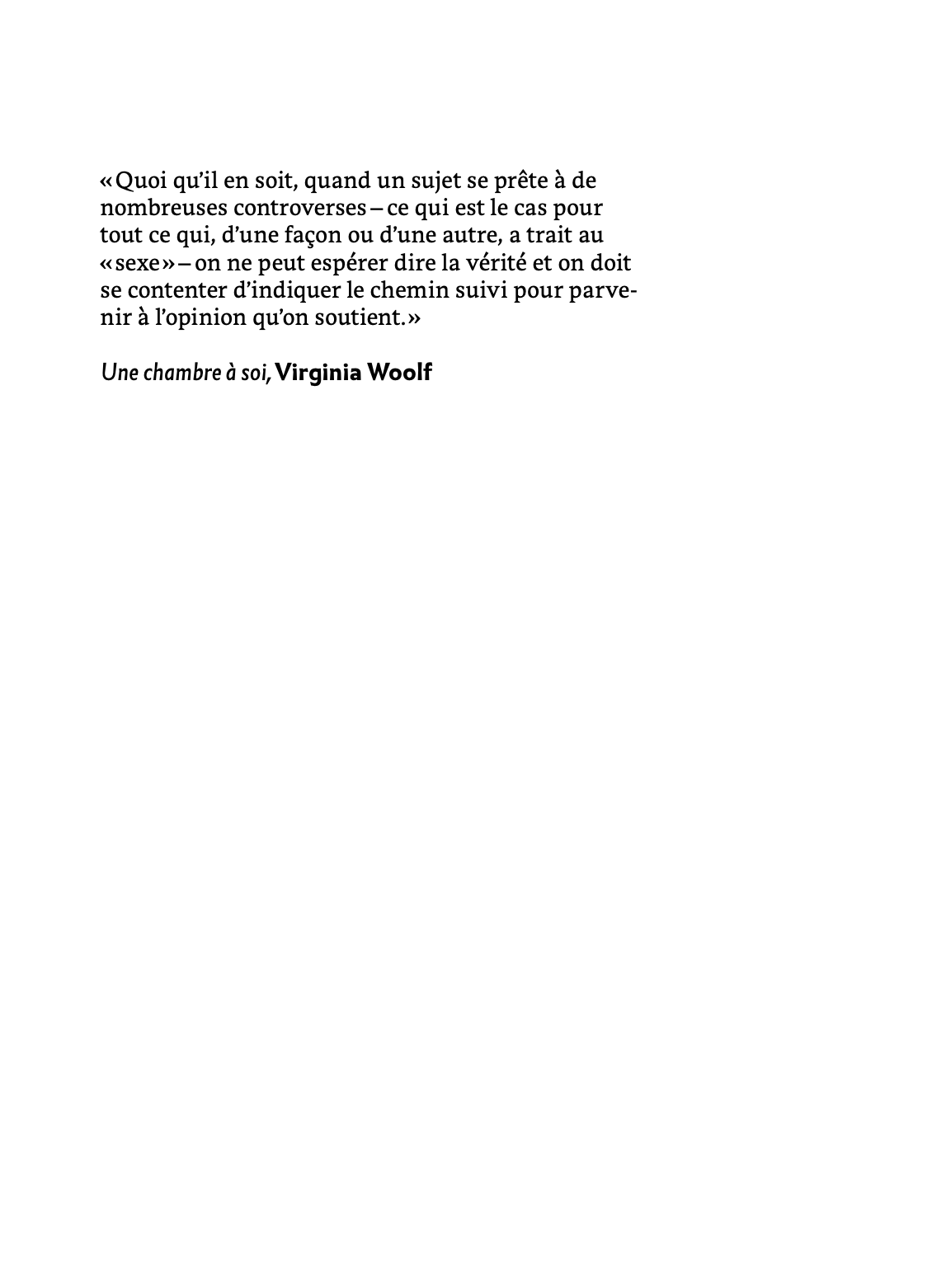
[fig.54] — page extraite de Sexisme aux Arts Décoratifs, lutter pour l’égalité, mémoire d'Alexandra Piat suivi par Lucile Encrevé, 2019, bibliothèque de l’Ensad
